|
|
Tamura Toshiko
田村俊子
Entre Tokyo et Shanghai, 1884-1945
par Brigitte
Duzan, 9 mars 2024
| |

Tamura Toshiko |
|
De son vrai
nom Satō Toshi (佐藤とし),
Tamura
Toshiko
est née en avril 1884 dans le quartier populaire d’Asakusa à
Tokyo où son père était marchand de sacs de riz. À 17 ans, elle
entre à l’université des femmes du Japon Nihon Joshi Daigaku.
mais doit vite abandonner. Elle commence à écrire et devient
vite célèbre, participant à l’émergence d’un courant de
littérature féminine en rupture avec la tradition.
Elle a été la
première écrivaine japonaise à vivre de ses droits d’auteur,
mais elle reste encore relativement méconnue.
L’écrivaine et
traductrice
Mo Yin (默音)
l’a découverte lors de ses recherches sur la littérature
féminine japonaise du début du 20e siècle, et s’est
inspirée de sa vie autant que de ses premiers récits pour écrire
une novella où se mêlent fiction et non fiction, comme dans les
récits de Tamura Toshiko elle-même. D’où l’intérêt de mieux
connaître une écrivaine qui offre par ailleurs un parallèle
intéressant avec
le monde littéraire féminin qui émerge en Chine dans les années
1910.
Sa carrière d’écrivaine passe par trois étapes :
- dans
les années 1910 : elle devient la « femme nouvelle » de la
littérature japonaise ;
- de
1918 à 1933 : elle fait l’expérience de l’immigration japonaise
à Vancouver, puis passe trois ans à Los Angeles avant de rentrer
au Japon ;
- de
1942 à sa mort en 1945 : elle édite une revue féminine sous
auspices japonais dans Shanghai occupée.
1910-1918 : Femme nouvelle, écrivaine à succès
Elle fait ses premières armes en littérature dans un Japon
encore dominé par l’idéologie typiquement confucéenne dite
ryōsai kenbo (良妻賢母),
bonne épouse, mère avisée. Mais cette fin de l’ère Meiji
(1868-1912) est en même temps une période d’émancipation
féminine qui voit émerger une « femme nouvelle » (atarashii
onna
新しい女),
revendicatrice et turbulente, qui a exercé une influence
déterminante sur l’image de la « femme nouvelle » chinoise (新女性)
dans les années 1910-1920 ; dans les deux cas, cette « femme
nouvelle » est inspirée par la Nora de la « Maison de poupée »
d’Ibsen et le phénomène sera de même étouffé dans l’œuf par la
guerre.
Publiant nouvelles et essais presque tous les mois de 1911 à
1918,
Tamura Toshiko
devient alors l’une des écrivaines représentatives de ces
« femmes nouvelles ». Mais, en même temps, elle est née dans un
quartier traditionnel de Tokyo, dit shitamachi (下町),
la ville basse, celui des vieux théâtres et d’une culture
populaire ancienne, d’où son surnom un rien péjoratif d’Edokko
(江戸っ子),
enfant d’Edo
.
Ce surnom, c’est Hiratsuka Raichō qui le lui a donné, l’une des
fondatrices en 1911 d’une revue emblématique : Seitō (青鞜),
c’est-à-dire « Bas bleu »
,
première revue littéraire féministe au Japon. Elle n’en
demandera pas moins à
Tamura
Toshiko de
contribuer à la revue lors de son lancement, ce qui montre bien
que Toshiko avait déjà une certaine notoriété dans les
cercles littéraires.
| |

Seitō, couverture du
premier numéro
(illustration de
Takamura Chieko) |
|
La nouvelle
qu’elle publie dans ce premier numéro de
Seitō,
en septembre 1911, est « Sang chaud » (Ikichi
生血) :
les sentiments mitigés ressentis par une femme après avoir passé
une nuit avec un homme quasiment inconnu dans une auberge. On
trouve là quelques motifs récurrents dans l’œuvre de
l’écrivaine, et en particulier une description sans concession
du corps de la femme en parallèle avec celle des rues saturées
d’humidité du quartier de Yoshiwara (吉原),
le quartier d’Edo célèbre pour ses courtisanes, ses « maisons
vertes » et ses artistes. Quartier aussi du théâtre kabuki où
son grand-père l’entraînait et dont sa mère était passionnée,
plaisir qui se fit rare quand la famille se retrouva en proie à
des difficultés financières.
En fait, selon une tradition que l’on retrouve aussi en Chine,
son père avait été « adopté » par la famille de sa mère, pour
aider au commerce familial des sacs de riz. Satō était le nom de
famille de sa mère. Ses parents se sont séparés quand elle était
enfant et elle a vécu un temps avec son père, avant de revenir
vivre avec sa mère parce que son père s’était remarié et avait
un enfant. Toshiko avait une petite sœur née en juillet 1889
qui, elle, était jolie, mais elle est morte en 1902. Finalement,
le sentiment qui ressort des premiers récits de Toshiko, à
partir de 1903, est celui d’une enfant en manque d’affection,
une impression de solitude, aux côtés d’une mère absente,
froide, préoccupée de sa propre carrière plutôt que du bien-être
de sa fille. Car sa mère était artiste et, après le départ de
son mari, a enseigné le chant ; mais elle a eu aussi de jeunes
amants.
En 1901,
Toshiko est
envoyée à l’Université des femmes du Japon (Nihon Joshi Daigaku
日本女子大学)
qui venait juste d’être fondée par Naruse Jinzo, un pionnier au
Japon de l’enseignement universitaire pour les femmes ; malgré
une approche très conservatrice, l’université a malgré tout
formé un premier contingent de « femmes nouvelles », dont les
cinq fondatrices de
Seitō.
Toshiko a cependant abandonné dès la première année, pour
des raisons contestées : problème de santé, manque d’intérêt
pour les cours, ou simplement faute d’avoir les moyens de payer
l’université, son père n’ayant plus les moyens de continuer à
l’aider.
C’est aussi ce
qui l’a poussée à écrire : seule de ses paires à venir d’une
famille modeste, sans père ou mari qui puisse payer ses
factures, elle a alors écrit pour vivre, et d’abord en entrant
dans le cercle de
l’écrivain Kōda
Rohan (幸田露伴)
dont elle est restée proche pendant plusieurs années. C’est
sous son égide, et le pseudonyme de Roei (露英),
qu’elle publie sa première nouvelle en février 1903, juste avant
son 19e anniversaire, dans la revue littéraire
Bungei kurabu (文芸倶楽部)
ou Club des arts littéraires
.
Intitulé Tsuyuwake goromo, soit « Vêtements trempés par
la rosée », le récit était écrit en japonais classique, dans le
style de la célèbre écrivaine du début de l’ère Meiji Higuchi
Ichiyō (
樋口一葉)
.
Toshiko
y dépeint les
efforts d’une jeune orpheline qui tente désespérément de
convaincre son frère de ne pas divorcer, la mort des parents
l’ayant laissée à sa charge ; mais elle meurt de tuberculose
après avoir vainement supplié son frère, sous la pluie, de ne
pas abandonner sa femme pour aller vivre avec une chanteuse.
L’atmosphère est sombre et, proche de l’autofiction, le récit
semble être porteur d’un lourd symbolisme.
Cependant, trois ans plus tard, en 1906, Toshiko rompt avec Kōda
Rohan car le style classique sur lequel il insistait ne lui
permettait pas d’exprimer les sentiments d’une Japonaise moderne
comme elle voulait le faire. Et en 1909, elle épouse Tamura
Shōgyo qu’elle avait rencontré dans le cercle de Kōda Rohan mais
qui avait dix ans de plus qu’elle. Elle va dès lors connaître un
grand succès contrairement à son mari qui continue à écrire dans
le style classique conseillé par Kōda Rohan, ce qui créera de
profondes tensions dans le ménage.
Pour sa part, elle se rapproche d’un cercle d’artistes liés à un
mouvement du nouveau théâtre dit shingeki (新劇)
dont l’un des principaux représentants était
Hōgetsu
Shimamura,
dramaturge qui,
en 1911, joua un rôle de premier plan dans la production au
Théâtre impérial de Tokyo de « La maison de poupée » d’Ibsen –
production qui défia la chronique car le personnage de Nora
devint une icône féministe, représentante de la « nouvelle
femme », et le rôle était en outre interprété pour la première
fois par une actrice, Matsui Sumako (松井
須磨子)
.
Cette même année 1911 marque le début de l’« âge d’or » de
Tamura Toshiko : son roman Akirame (あきらめ)
ou « Résignation » remporte le prix littéraire du journal Asahi
Shimbun. C’est une histoire d’infidélité, d’amour lesbien, et du
désir d’une jeune femme de devenir célèbre en dépit des
objurgations du directeur de son école ; à la fin, cependant,
elle ne peut supporter les rumeurs que l’on fait courir sur
elle, et elle « se résigne » à aller vivre à la campagne avec sa
grand-mère âgée et souffrante en abandonnant ses rêves de gloire
théâtrale – conclusion typique des récits de Toshiko. Elle-même
avait tenté une carrière d’actrice avec la troupe de
Shimamura,
mais, n’étant pas assez belle pour cela, dut « se résigner » à
ne pas être actrice mais écrivaine.
| |

Un de ses premiers
recueils de nouvelles (1913) |
|
Elle poursuit en 1912 avec un récit qui dépeint son expérience
du théâtre : Chōshō (嘲笑)
ou « Moquerie », puis, en 1913, Onna Sakusha (女作者)
ou « L’écrivaine », tout aussi autobiographique (une écrivaine
en panne d’inspiration en fait porter la faute sur son mari et
se retourne contre lui), et le recueil de neuf nouvelles
Miira no Kuchibeni (木乃伊の口紅)
ou « Le rouge à lèvres de la momie » où un couple d’écrivains
rivalisent et se disputent. On retrouve le thème de
l’homosexualité féminine dans une nouvelle parue en 1914,
Haru no ban (春の晩)
ou « Soir de printemps », qui décrit les deux relations d’une
jeune femme, l’une hétérosexuelle, l’autre homosexuelle.
| |

Le rouge à lèvres de la
momie |
|
C’est cette
année-là que Tamura Toshiko rencontre le journaliste Suzuki Etsu
(鈴木悦)
qui travaillait pour l’Asahi Shimbun. En 1916, elle se
sépare de son mari. Ses publications ont de plus en plus de
succès, en particulier auprès de tout un lectorat féminin jeune.
Ses récits
paraissent dans les revues littéraires populaires comme Chūō
Kōrōn ou Revue centrale (中央公論) et Shinchō
(新潮)
.
Elle fait partie de tout un groupe de jeunes écrivaines
indépendantes et professionnelles qui vivent de leur plume et
expriment leurs émotions intimes. Elles vont être à la source
d’une véritable sous-culture que l’on a appelée
shôjo bunka
et qui s’est développée au début des années 1920. Mais Tamura
Toshiko ne sera plus là.
En 1918, en
effet,
elle part
avec Suzuki à Vancouver
où elle va rester jusqu’en 1933, ne rentrant au Japon qu’en
1938, après deux années à Los Angeles.
1918-1936 : l’expérience de l’étranger
o
1918-1933 : Quinze ans au Canada.
Ces années au
Canada sont relativement difficiles. Elle ne pouvait que
difficilement s’intégrer dans la communauté japonaise, étant une
écrivaine capable de vivre de sa plume, alors que la majorité
des immigrants japonais appartenaient aux couches pauvres de la
population et avaient émigré pour des raisons économiques ; ils
étaient en outre très conservateurs. Maîtrisant mal l’anglais,
Toshiko s’est retrouvée marginalisée dans un monde où elle
n’avait pas sa place, tandis que Suzuki, de son côté, tentait de
créer un syndicat des travailleurs japonais pour défendre leurs
droits
Toshiko
recommence cependant à écrire, pour des journaux japonais de
Vancouver, mais sous le pseudonyme significatif de Tori no ko
(鳥の子),
c’est-à-dire « Petit oiseau », montrant bien qu’elle se sentait
fragile « comme un oiseau sur la branche ». Elle écrit des
haiku, mais aussi quelques nouvelles, la première, en 2019,
intitulée Bokuyōsha
(牧羊者),
ou « Bergers », symboliquement inspirée de l’histoire de David
et Goliath.
Elle rend
compte dans la cinquantaine d’articles publiés dans la presse
japonaise au Canada de la vie des immigrants japonais à
Vancouver, et surtout le racisme auquel ils étaient confrontés.
Elle n’a écrit que neuf nouvelles pendant toute cette période.
Et c’est juste avant son retour au Japon qu’elle publie une
novella décrivant l’histoire du mouvement ouvrier japonais à
Vancouver, à la suite des émeutes antijaponaises de 1907, la
communauté blanche s’étant alarmée du nombre croissant
d’immigrants qui menaçaient à leurs yeux l’intégrité de toute la
province de British Colombia. La novella est intitulée
Chiisaki ayumi (小さき歩み),
soit « Petits pas », et elle est publiée en trois parties, dans
les numéros d’octobre et décembre 1936 et mars 1937 du journal
Kaizō
(改造).
Le 25 février
1932, cependant, Suzuki était rentré au Japon, pour ce qui
devait être un voyage rapide. Un an plus tard, il y était
toujours. Le 11 septembre 1933, il meurt d’une appendicite à
l’hôpital dans sa ville natale de Toyohashi. Il vivait en
réalité à Tokyo avec une autre femme qui était rentrée du Canada
au Japon avec lui.
o
1933-1936 : trois ans à Los Angeles
En novembre
1933, au bord du suicide
,
Toshiko part à Los Angeles. Son premier contact est une actrice,
épouse d’un célèbre acteur japonais de Hollywood, qu’elle avait
connue à Tokyo et qui lui aurait inspiré le personnage de Tomie
dans Akirame. Mais, quand elle arrive à Los Angeles,
l’actrice est séparée de son mari, gagne tout juste sa vie en
vendant des produits de beauté, continue de militer pour les
idées de gauche et qui plus est son fils a la tuberculose.
Autant de raisons pour l’éviter.
Toshiko trouve
cependant très vite un éditeur : elle publie dans le Rafu
shimpō
(羅府新報),
ou Los Angeles (Japanese) Daily News, un journal qui publiait
depuis sa création en 1903 des nouvelles d’écrivains et
écrivaines japonais (es) célèbres.
Elle finit par
rentrer au Japon en 1936. Mais c’est un tout autre Japon que
celui qu’elle avait quitté dix-huit ans auparavant. Ce n’est pas
non plus la même personne ni la même écrivaine qui remet les
pieds sur le sol natal.
1936 : bref
retour au Japon
Fini l’âge
d’or de l’ère Taishō.
Elle reprend son nom Satō
Toshiko et désormais les histoires de ses héroïnes, dans ses
nouvelles, sont mêlées à des problèmes de classe et des
questions politiques dans le Japon nationaliste de cette fin des
années 1930.
Après
Chiisaki
ayumi,
elle publie
trois nouvelles qui se passent au Japon, dont Mukashi gatari
(昔がたり),
« Histoire d’autrefois », publiée dans la revue Bungakukai
(文学界)
ou « Monde des lettres », en janvier 1937. Ce que reflète la
nouvelle, c’est l’angoisse des écrivains obligés de se conformer
à l’idéologie nationaliste et militariste en renonçant à leurs
idées pour se prononcer en faveur du tenkō
(転向),
littéralement « conversion dans la (bonne) direction ». Le récit
est conté à la première personne, par la narratrice interrogée
sur une étudiante qu’elle a connue dans le passé, sans que soit
précisée l’identité de son interlocuteur – il est désigné par le
démonstratif « ce », sono ko (其の子),
qui pourrait vouloir dire quelqu’un dont on a déjà parlé. Mais
cette volontaire imprécision, ce doute, donne un sens inquiétant
au personnage et à la nouvelle.
Fini les
personnages féminins en lutte pour leur indépendance dans une
société patriarcale, contre l’idéal confucéen des bonnes épouses
et mères (il n’y a d’ailleurs jamais d’enfants dans les récits
de Tamura Toshiko). Les personnages sont maintenant comme
étouffés dans une atmosphère irrespirable, quasi
claustrophobique.
Avant de
quitter le Japon, elle publie encore deux nouvelles. L’une,
parue en novembre 1938 dans Chūō kōron, est intitulée
Yama michi
(山道) :
« La route de montagne ». De manière semblable à sa première
nouvelle publiée en 1911 dans le numéro inaugural de la revue
Seitō, ce récit dépeint les émois intérieurs d’une femme
qui, marchant avec son amant sur un chemin de montagne, est en
fait en train de lui faire ses adieux, ainsi qu’à son pays. Ici
cependant, plus de description de scènes sexuelles ; ne restent
que la tristesse de la perte prochaine et la persistance du
désir,
et en toile de fond la menace destructrice de la montée du
nationalisme.
En décembre 1938,
Toshiko publie une dernière nouvelle avant son départ:
Bubetsu (侮蔑),
« Mépris ». Le récit est centré sur deux jeunes
Nippo-Américains, un jeune garçon et sa petite amie, qui tentent
de trouver leur place entre Japon et Amérique, mais sont en fait
ostracisés des deux côtés. En cause sont les notions de nation
et de race, et de ce qui définit la culture, avec tout ce que
cela peut avoir d’arbitraire et d’imaginaire, au service du
nationalisme.
Avant cette nouvelle, elle avait exprimé son dédain du
nationalisme, justement, dans un article publié en juin 1937
dans le Miyako Shimbun (都新聞) :
Nihon fujin undō no nagare o miru (日本婦人運動の流れを観る),
« Regard sur les courants actuels du Mouvement des femmes ».
Elle y critique l’utilisation des femmes par le gouvernement
japonais pour soutenir l’effort de guerre après en avoir fait
des ouvrières sur le front industriel, en soulignant la
contradiction qu’il y a à vouloir que les femmes donnent
naissance à une nombreuse progéniture si c’est ensuite pour
l’envoyer se faire tuer sur le front. Mais son propos va au-delà
du nationalisme japonais : elle attaque l’idée même de race
pure, de suprématie culturelle, d’Etat-nation unifié et en
revient en contrepoint à la beauté de la nature en dépit des
faiblesses humaines.
Dans les articles et récits de ces années 1930, elle apparaît
non plus comme la « femme nouvelle » des années 1910, mais comme
une écrivaine aux styles multiples nés de son expérience
internationale
.
Et puis, fin 1938, elle part à Shanghai.
1938-1945 : Shanghai
Depuis la fin de la bataille de Shanghai, le 26 novembre 1937,
la majeure partie de la ville est occupée par les troupes
japonaises, hors concessions internationales d’abord, les
concessions étant finalement occupées elles aussi le 8 décembre
1941.
| |

Toshiko à Shanghai |
|
Toshiko part comme correspondante du Chūō Kōrōn. Puis, en
1942, après l’occupation totale de la ville, elle devient, sous
le nom de
Zuo Junzhi (左俊芝)
,
rédactrice-en-chef d’une revue féminine chinoise, « La Voix des
femmes » (《女声》),
sous-titrée en anglais « Woman’s Voice », sous l’égide des
autorités japonaises et financées par elles. Cependant, comme
elle ne lisait ni n’écrivait le chinois, elle avait pour
assistante de rédaction une Chinoise nommée Guan Lu (关露).
| |
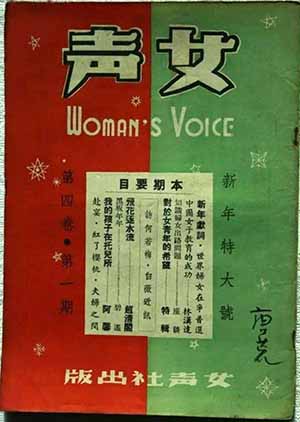
La voix des femmes /
Woman’s Voice |
|
Or cette Guan Lu était en fait membre du Parti communiste, et
chargée par le Parti d’espionner sur les collaborateurs des
Japonais, le journal servant de couverture. En juillet 1943,
elle est même envoyée par le journal pour participer à une
conférence sur « la littérature de la Grande Asie orientale »
qui se tient en août à Tokyo. Elle est chargée par son supérieur
dans le Parti, Pan Hannian (潘汉年),
de remettre une lettre à un ami japonais pour tenter de renouer
les liens avec les membres du Parti communiste japonais. Il y a
une douzaine de Chinois à la conférence et chacun doit faire une
allocution à la radio. Guan Lu choisit pour sujet « les échanges
culturels entre les femmes chinoises et japonaises », en
insistant sur le rôle des écrivains pour faciliter la
communication.
Elle sera par la suite considérée comme traître, condamnée deux
fois à la prison et finira misérablement sur un lit d’hôpital.
Bien qu’elle ait été réhabilitée juste avant sa mort, c’est
l’image d’elle qui est longtemps restée. Elle était pourtant
écrivaine, poétesse et traductrice,
amie de
Ding Ling (丁玲)
et de
Yang Mo (杨沫) ;
de 1947 à 1951, elle a même travaillé comme scénariste au bureau
du cinéma. Elle avait donc toutes les qualifications requises
pour être la rédactrice de
« La Voix des femmes ».
Ce qui reste obscur, c’est le rôle véritable de Tamura Toshiko
dans cette aventure. Il semble évident qu’elle ait dû faire son
tenkō
et que le journal lui ait permis d’échapper à l’atmosphère
pesante du Japon. Mais elle semble s’être bornée à répondre au
courrier des lectrices, en se le faisant traduire.
Cependant, « La Voix des femmes » est resté le seul magazine
féminin publié à Shanghai pendant l’occupation japonaise, et en
tant que tel offre une perspective inédite sur la complexité de
la communication culturelle dans la ville à l’époque. C’est le
sujet de recherche d’une professeure de l’Université des
communications de Chine qui a également étudié au Japon : Tu
Xuhua (涂晓华).
Elle a publié en 2014 un résultat exhaustif de ses recherches,
en faisant ressortir la politique éditoriale, les différentes
rubriques, les contributeurs : « Recherches sur la revue "La
voix des femmes" dans la Shanghai sous occupation japonaise » (《上海沦陷时期《女声》杂志研究》).
On peut aussi replacer la revue dans la continuité des
revues littéraires féminines à Shanghai au début du 20e
siècle,
y compris celle, portant le même nom, fondée en 1932 par une
militante féministe chinoise …
Quant à Tamura Toshiko, elle est décédée d’une hémorragie
cérébrale le 16 avril 1945, peu de temps avant la capitulation
du Japon et la libération de Shanghai. Sa tombe est à Kamakura,
près du temple bouddhiste Tōkei-ji (東慶寺).
Après sa mort, en 1946, a été créé un prix de littérature
féminine financé par ses droits d’auteur.
| |

La tombe de Tamura
Toshiko à Kamakura |
|
Au Japon, la spécialiste de Tamura Toshiko est
Kurosawa Ariko
(professeure à l’université d’Okinawa, née en 1952) qui poursuit
la publication de ses œuvres complètes : Tamura Toshiko
sakuhinshū (田村俊子作品集),
Après l’avoir rencontrée au Japon et avoir fait elle-même des
recherches à Shanghai, Mo Yin a écrit un article sur
l’écrivaine, illustré des photos des divers lieux où elle a
vécu :
https://mp.weixin.qq.com/s/X6xlKis_LHnZU-S0zQux2Q
Bibliographie en anglais
-
The Body, Migration and the Empire :
Tamura Toshiko’s Writing in Vancouver from 1918 to 1924. by
Noriko K. Horiguchi, US-Japan Women’s Journal, n° 28 (2005), pp.
49-75. University of Hawai’i Press.
-
From New Woman Writer to Socialist: The Life and Selected
Writings of
Tamura Toshiko from 1936-1938, by
Anne E. Sokolsky, Brill, 2015.
| |

From New Woman Writer to
Socialist |
|
-
Tamura Toshiko, the Modern Murasaki, by Edward Fowler, Columbia
University Press, 2006.
Aucune
traduction en français.
Première écrivaine professionnelle du Japon moderne
(1872-1896), et autre écrivaine issue d’un milieu très
modeste, affectée elle aussi par la faillite de son
père.
Elle a
été prise dans les purges des débuts du régime
maoïste car impliquée dans « l’affaire Pan Hannian »,
arrêté en 1953 pour trahison, et condamné en 1955 à la
prison puis envoyé en camp de rééducation. Elle fera dix
ans de prison, puis huit à nouveau à partir de 1967.
Elle finira tristement sa vie dans la solitude. En 1980,
une thrombose cérébrale la laisse paralysée. Le 5
décembre 1982, après avoir terminé ses mémoires, elle
se suicide en avalant des somnifères. Elle avait été
réhabilitée sur son lit d’hôpital le 23 mars. On la
redécouvre aujourd’hui.
Elle a
laissé des poèmes, des histoires pour enfants et un
roman, ainsi que des essais publiés après sa mort :
1936 "Chants sur le Pacifique" (recueil de poèmes)《太平洋上的歌声》(诗集)
1940 "Hier et aujourd’hui" ( roman autobiographique )《新旧时代》(长篇自传体小说)
1951 "Le verger" (littérature pour enfants)
《苹果园》(儿童文学)
1986 "Troubles dans la ville" (recueil d’essais )《都市的烦恼》(散文集)
|
|

