|
|
« La Guerre des
bulles », de Kao Yi-Feng : quand les enfants prennent le pouvoir
par
Brigitte Duzan, 22 octobre 2017
|
« Roman d’initiation collectif », « violente satire
sociale », « interrogation sur les rapports de pouvoir
et la volonté de puissance », « dystopie poétique »,
c’est en ces termes qu’est présenté « La Guerre des
bulles » sur la quatrième de couverture de la première
traduction en français de ce roman de l’écrivain
taïwanais
Kao Yi-Feng (高翊峰).
« La Guerre des bulles » (《泡沫戰爭》)
est paru en 2014 à Taïwan. Le roman commence par une
petite phrase en exergue qui résume l’esprit du récit :
Sauf à mourir durant l’enfance, aucun choix ne se
présente à nous que celui de grandir. Lentement. Et,
petit à petit, de devenir adultes. Des adultes
incapables de résoudre les problèmes…
Un jour, donc, dans un faubourg pauvre d’une ville
lambda, |
|
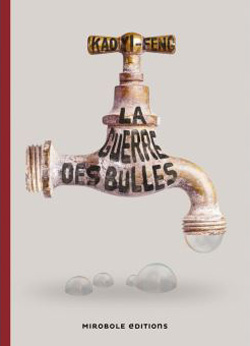
La guerre des bulles (traduction
française) |
et dans la chaleur d’un été caniculaire, un groupe d’enfants
guidés par ce principe décide de virer les adultes et de prendre
le pouvoir pour résoudre les problèmes les plus urgents qui les
concernent : ceux nés d’une sécheresse qui les prive d’eau
depuis longtemps, faute d’eau courante. Ils veulent affirmer en
même temps leur désir de modeler leur destin autrement que selon
la ligne qui leur est immuablement fixée par la société et la
famille, en se constituant en micro-société se voulant autonome.
Un putsch d’enfants pour un monde meilleur
|

Les chiens sauvages comme des monstres
d’un bestiaire mythique sur la couverture
de l’édition originale taïwanaise |
|
On pense bien sûr tout de suite à William Golding et son
« Lord of the Flies » (sorti en France en 1956 sous le
titre « Sa Majesté des mouches), sauf que, dans le cas
du roman de Kao Yi-Feng, ce n’est pas poussés par la
nécessité, après un accident qui les a laissés seuls sur
une île déserte, que les enfants entreprennent de
recréer une organisation sociale, mais mus par leur
seule volonté de gérer eux-mêmes leur quotidien : ils se
démarquent donc – ou tentent de se démarquer – des
structures existantes.
C’est un coup d’Etat, qui revêt même des aspects de coup
d’Etat militaire, un putsch mené par un « général » et
sa clique de gamins instaurés en Etat-major. Ils
éliminent le délégué en chef du Comité de gestion
municipale, bouclent le faubourg et se rendent maîtres
des lieux. Commence alors la phase deux de l’opération :
organiser le patelin pour, surtout, résoudre le problème
du manque d’eau chronique, en amenant l’eau courante.
|
Mais, dès l’abord, le récit se place dans une approche
totalement différente de celle de William Golding : l’action des
enfants se veut rationnelle, mais leur mentalité et leurs
réactions sontcelle d’enfants nourris de contes et récits
fantastiques : leur monde est ouvert sur l’imaginaire et
l’irrationnel, avec une ambivalence constante entre la nécessité
et la volonté de gérer le quotidien au mieux et l’intrusion du
fantastique dans cet univers.
Irruption du fantastique mais retour à la normale
Le fantastique apparaît dès les premières pages : le général
putschiste élimine l’adulte chef du Comité de gestion du
faubourg, mais le fait avec un fusil à air comprimé qui est en
fait un jouet d’enfant. Il « tue » le délégué en chef comme les
enfants se tuent en jouant à la guerre, mais avec une invention
supplémentaire qui forme l’un des thèmes principaux du récit et
une clé de son déroulement : le corps de l’homme est mort,
étendu à terre, mais son spectre, lui, est debout et bien
vivant.
Le monde du faubourg tel qu’il se reconfigure peu à peu sous
l’administration du petit régiment d’enfants est ainsi peuplé
d’adultes fantomatiques qui survivent dans une sorte de limbe
parallèle au monde des enfants, et qui peuvent leur rendre des
services au besoin.
Mais, sous la pression de la sécheresse et des problèmes
d’alimentation qu’elle engendre, le faubourg est de plus en plus
menacé par des hordes de chiens sauvages qui attaquent les
enfants et tentent de venir boire à la fontaine de la place
publique. C’est l’une des inventions les plus intéressantes du
roman, car elle fait remonter des peurs séculaires et
ancestrales qui ancrent le récit dans la tradition tout en la
recréant totalement sur un mode dystopique de
quasi-science-fiction. Car les chiens eux aussi ne meurent que
physiquement, mais survivent comme spectres, tout aussi
menaçants, surtout quand ils se transforment, finalement, en
« chiens-démons ».
Dès lors, les enfants doivent faire « l’apprentissage de la
peur », et c’est peut-être là ce qui conditionne leur passage à
l’âge adulte. Car la révolte des enfants n’a qu’un temps, et se
termine aussi pacifiquement qu’elle a commencé. Il n’est pas
question de bain de sang, juste de retour à l’âge doré de
l’enfance, où les gamins peuvent tranquillement recommencer à
« jouer à la guerre » en laissant aux adultes les travaux
fastidieux de gestion du faubourg. Celui-ci, cependant, aura
gagné dans l’intervalle la bataille de l’eau courante, non grâce
aux enfants, mais parce que le dossier aura fini par être réglé
par la municipalité.Retour à l’ordre banalement normal des
choses.
Beaux portraits et récit captivant malgré quelques longueurs
Le récit est l’occasion de très beaux portraits d’enfants, dans
ce faubourg pauvre, en marge d’une ville qui reste très
lointaine, inconnue, comme mythique, voire inexistante. On sait
juste que, là-bas, il y a l’eau courante, et que c’est de là que
viennent les camions citernes qui viennent parfois apporter un
peu d’eau aux familles démunies dans les pires périodes de
sécheresse.
C’est un faubourg en marge de la civilisation, celle que semble
symboliser l’eau courante, et c’est cette situation de pauvreté
et de marginalité qui offre un lieu idéal pour la naissance
d’une utopie. Mais celle-ci se transforme vite en dystopie sous
la pression de l’imagination, bien plus que des circonstances.
Les personnages sont forcément marginaux eux aussi, comme le
vieillard aux chiens ou la sorcière du four à pains. Mais ce
sont les enfants dont les portraits sont les plus frappants et
contribuent à donner sa force au roman : ils sont réels, vivants
et bien campés.
Le général en chef est fils de plombier, comme les empereurs
fondateurs de dynastie, dans la Chine ancienne, étaient
autrefois fils de paysans sans terre, et chaque enfant est un
cas social en soi. Mais ils constituent aussi des figures
emblématiques rappelant d’autres figures littéraires, y compris
le petit frère du général, qui est un orphelin, adopté, dont on
ne sait trop d’où il vient, le métis comme figure imposée dans
le monde taïwanais d’aujourd’hui, ou la jeune étudiante
brillante, seul élément féminin du petit régiment, qui rappelle
les personnages intrépides de nüxia d’autrefois…
Il est vrai que Kao Yi-Feng s’est parfois laissé entraîner par
sa faconde et la prolixité de sa plume, en particulier dans la
description minutieuse du détournement de l’eau par les enfants
au milieu du livre. Mais, ce qui prime, au final, et reste gavé
dans la mémoire, ce sont les descriptions des hordes de chiens
menaçant l’ordre humain du faubourg, et, finalement, l’image du
« faubourg inversé », de l’autre côté du miroir de l’eau de la
fontaine, où restent les chiens démons et les enfants qu’ils ont
emportés, sans que jamais les deux faubourgs puissent être
réunifiés… on n’en finit pas de songer à tous les murs et pays
coupés en deux dans le monde que suggère cette image.
« La Guerre des bulles » résonne encore longtemps après que le
livre a été refermé.
La Guerre des bulles, traduit du chinois (Taïwan) par
Gwennaël Gaffric,
Mirobole éditions, collection « Horizons pourpres », octobre
2017, 352 p.
Extrait de la traduction (les vingt premières pages)
http://www.harmoniamundilivre.com/revue_nouveautes/17_10_mro_guerre_bulles_extrait_RN.pdf
|
|

