|
|
Langue vernaculaire et
littérature
par Brigitte
Duzan, 19 juillet 2025
Une langue
vernaculaire est une langue locale communément parlée au sein
d’une communauté, souvent en opposition à une langue classique,
voire liturgique, limitée à un cercle de lettrés, religieux,
professionnels et autres.
En
France
Le terme
français vient du latin vernaculus qui désignait d’abord
ce qui était relatif aux esclaves nés dans la maison du maître (verna),
puis tout ce qui était élevé, cultivé, confectionné dans la
maison, et par extension ce qui est indigène, autochtone. C’est
l’écrivain et magistrat romain Varron (- 116/+ 27), dont les
écrits apportent des éclairages sur l’étymologie des mots
latins, qui a utilisé le premier cet adjectif dans le contexte
linguistique en parlant de vocabula vernacula, les
vocables de la langue nationale.
C’est le 9e
siècle qui voit les débuts de la langue romane, que l’on peut
qualifier de vernaculaire. Au début de ce siècle, en effet, dans
l’Empire de Charlemagne, le latin n’était plus ni parlé ni
compris si bien qu’au Concile de Tours, réuni en 813 par
Charlemagne, les évêques ont décidé que, dans les territoires
qui correspondent à la France et à l’Allemagne actuelles, les
homélies ne seraient plus prononcées en latin, mais d’un côté en
« langue romane rustique » et de l’autre en « langue tudesque »,
« afin que tous puissent plus facilement comprendre ce qui est
dit » (quo
facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur).
Il faut
cependant attendre les « Serments de Strasbourg », en février
842, pour que soit attesté le premier texte complet écrit dans
une langue issue du latin et qui en soit distincte : c’est une
alliance militaire entre deux fils de Louis le Pieux contre leur
frère aîné, Louis le Germanique prononçant son serment en langue
romane pour être compris des soldats de Charles le Chauve et
celui-ci le prononçant en langue tudesque pour être entendu des
soldats de son frère. Le texte en roman de ces « Serments » a
une portée autant philologique que symbolique car il est
considéré comme l’acte de naissance de la langue française, mais
c’est aussi, selon le médiéviste Philippe Walter, « l’accession
à l’écriture de la langue dite "vulgaire" »
- ou vernaculaire.
Quant au
premier texte littéraire dans cette langue vernaculaire, c’est
la « Séquence de sainte Eulalie », composée vers 880 ou 881,
dans une langue vraisemblablement proche de la langue courante
dans le nord du domaine gallo-roman à l’époque. Il y aurait eu
« osmose entre la langue savante et la langue quotidienne à
travers un bilinguisme individuel. »
La séquence,
ou cantilène, raconte le martyre de Sainte Eulalie de Mérida.
La première
grammaire d’une langue vernaculaire en Europe date ensuite du 14e
siècle : c’est « Las Leys d’Amors », traité de grammaire et de
rhétorique de langue occitane publié en 1356 à Toulouse, œuvre
de la compagnie des troubadours toulousains. C’est alors qu’elle
atteint son apogée que la langue d’Oc, grâce aux Leys d’Amors,
se dote d’un système de codification comme aucune autre langue
en Europe ne l’avait fait jusqu’alors.
En
Espagne, en Italie, en Angleterre et ailleurs
En France,
« La Chanson de Roland », poème épique en vieux français, est le
premier exemple de chanson de geste, composée vers 1040 (avec
des additions jusque vers 1115). Le plus ancien des neufs
manuscrits qui nous sont parvenus est le manuscrit d’Oxford qui
date du 12e siècle et qui est en anglo-normand. Selon
un document de la BnF, à Paris, au début du 12e siècle,
l’historien Guillaume de Malmesbury assurait qu’un jongleur du
nom de Taillefer entonna la Cantilena Rolandi lors de la
bataille de Hastings en 1066, pour galvaniser les troupes
normandes qui combattaient aux côtés de Guillaume le Conquérant.
Il s’agit de la première manifestation recensée de la Chanson
de Roland, presque trois siècles après les faits.
| |
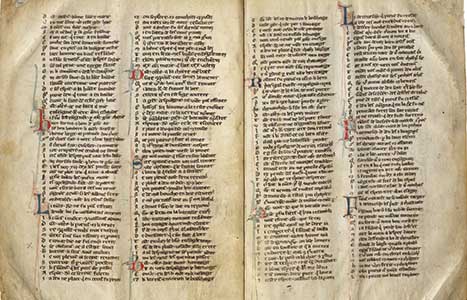
La
Cantilena Rolandi (Chanson de Roland),
manuscrit sur parchemin conservé à la BnF
|
|
Elle est
suivie, un siècle plus tard en Espagne, d’« El Cantar de mio
Cid », chanson de geste anonyme composée entre 1140 et 1207.
Dans les deux cas, les poèmes ont fait l’objet de performances
orales aux variations multiples, ensuite harmonisées en passant
à la version écrite.
En Italie,
Dante s’est fait le champion de l’utilisation de l’italien
vernaculaire en littérature : la « Divina Commedia »,
achevée vers 1321, est l’un des premiers chefs-d’œuvre de
littérature vernaculaire en Europe.
En Inde, c’est
aussi au 12e siècle, quand le mouvement Bhakti s’est
étendu vers le nord, qu’il a entraîné la traduction de textes
sanscrits en langues vernaculaires. Un peu de la même manière,
le protestantisme a été une force de première importance pour
l’utilisation du vernaculaire dans l’Europe chrétienne, avec des
traductions de la Bible en diverses langues locales à partir du
16e siècle.
En Angleterre,
d’après Merriam-Webster, le terme « vernacular », avec la même
étymologie latine, est apparu dans la langue anglaise au début
du 17e siècle, en opposition à la lingua franca
que continuait à être le latin, surtout dans le domaine
scientifique.
Un phénomène
linguistique similaire s’est produit en Chine, en lien avec la
littérature orale.
En Chine
On a souvent
tendance à considérer que l’usage du vernaculaire - baihua
(白话)
- s’est développé dans la littérature chinoise dans le cadre du
mouvement du 4 mai 1919
et de la Nouvelle Culture,
sous
l’impulsion de grands penseurs et lettrés comme
Liang Qichao (梁啓超),
Hu Shi (胡適)
ou
Lu Xun (魯迅),
en rupture avec la langue classique. Mais ce mouvement était lié
à la revendication de démocratisation, celle de la langue étant
considérée comme la « clef de voûte de la transformation des
sujets impérieux en citoyens ».
Cependant, ce
projet politique était fondé sur une langue vernaculaire qui
était déjà utilisée en littérature. C’est en effet au fur et à
mesure que la langue parlée s’éloignait de la langue classique
écrite que, à partir des Tang, on a commencé à écrire dans des
formes dialectales vernaculaires pour être mieux compris du
public populaire : ainsi sont nées sont les formes narratives
dites biànwén (變文
/
变文),
avec alternance de passages versifiés et passages en prose ;
certains de ces textes avaient un contenu bouddhique, visant à
populariser la religion, d’autres étaient profanes, mais dans
les deux cas ils étaient récités et chantés, devant un auditoire
auquel on présentait en même temps des rouleaux peints servant
de support illustré (des images peintes bianxiang
变相). Ce
sont les passages en prose qui étaient en langue vernaculaire.
Adaptés à des sujets non bouddhiques, ils ont peu à peu été
tirés de l’histoire ou de légendes chinoises comme le montrent
des documents découverts à Dunhuang et conservés au British
Museum et à la BnF
.
| |
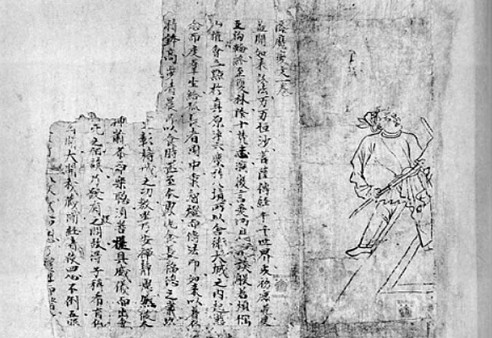
Un
bianwen provenant de Dunhuang |
|
De là est née
la littérature chinoise en langue vernaculaire qui s’est
développée surtout à partir du 14e siècle et s’est
épanouie sous les Ming, avec les grands romans populaires que
sont
« Le Roman des Trois Royaumes » (Sānguó Yǎnyì《三国演义》),
et « Au
bord de l’eau » (Shuihuzhuan《水浒传》),
eux-mêmes influencés par le théâtre zaju des Yuan qui était un
théâtre populaire.
La langue
vernaculaire chinoise – opposée à la langue classique wenyan
(文言)
- a donc une double appellation : le baihua ancien (古代白话)
et le baihua moderne (现代白话).
Mais, dans la Chine ancienne, il n’y avait pas un vernaculaire
unique ; il y en avait quatre formes plus ou moins
standardisées – d’une part une forme dite rimée yunbai (韵白),
ou zhongzhouyun (中州韵)
d’après un ouvrage de la dynastie des Song du Sud, qui a donné
une prononciation standard dans beaucoup d’opéras traditionnels,
et d’autre part trois formes fondées sur des dialectes
régionaux :
- le dialecte
de Pékin (北京话),
utilisé dans les dialogues de l’opéra de Pékin et les grands
romans classiques ;
- le subai
(苏白)
fondé sur le dialecte de Suzhou (苏州话),
une forme de langue Wu (吴语)
utilisée dans les régions du Zhejiang et du Jiangsu, également
langue littéraire renommée comme en témoignent l’opéra kunqu
et le roman « Les Fleurs de Shanghai » (《海上花列传》)
de Han Bangqing (韩邦庆) ;
- enfin le
guangbai (广白)
ou yuebai (粤白)
fondé sur le dialecte cantonais (guangzhouyu广州话
ou yuèyu
粤语),
qui était utilisé surtout dans la région de Lingnan (岭南)
et qui s’est longtemps développé à l’écart du nord.
| |
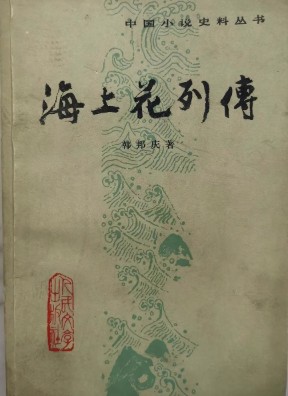
Les
Fleurs de Shanghai, roman en langue wu |
|
Il s’agit là
bien sûr d’une standardisation simplificatrice car il existait
bien d’autres langues vernaculaires, surtout dans le sud
:
le minbai (闽白)
fondé sur le dialecte min (minyu
闽语) ou
le kebai (客白)
fondé sur le dialecte hakka (kejiayu
客家语),
par exemple. En outre, une même forme vernaculaire pouvait avoir
des prononciations différentes : ainsi, l’opéra
Yue (Yueju
越剧),
né dans le district de Shengxian (嵊县),
aujourd’hui Shengzhou (嵊州),
utilise une forme de subai, mais avec la prononciation du
dialecte de Shengzhou.
Cependant se
posait la question de l’unité nationale de la langue, qui
tendait à disparaître derrière la diversité des formes
dialectales. Pour pallier le problème, au début de la République
de Chine est apparu le « chinois standard » (汉语标准音)
et le terme de vernaculaire (baihua
白话) a
été remplacé, dans l’usage courant, par celui de « dialecte » (fangyan
方言).
Ces dialectes
ont longtemps été interdits au profit du putonghua
standard, mais elle tendent aujourd’hui à renaître, au cinéma
comme en littérature, dans une sorte de recherche des racines
locales dans leur diversité.
|
|

