|
|
Lin Shu
林紓
1852-1924
Présentation
par Brigitte Duzan, 19
septembre 2022
| |
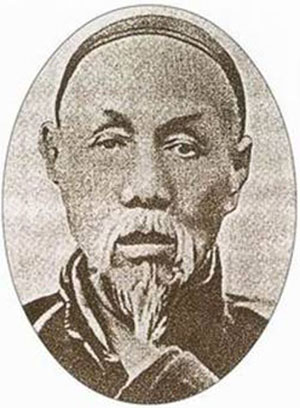
Lin
Shu |
|
Écrivain et premier traducteur
chinois de Dickens, Shakespeare, Hugo et Dumas fils, Lin Shu est
l’auteur d’environ cent quatre-vingt traductions en chinois
d’œuvres occidentales alors qu’il ne connaissait aucune langue
étrangère : il se faisait traduire oralement les œuvres et
transcrivait l’histoire qu’on lui racontait ainsi dans un
superbe chinois classique.
Or, dès les débuts de la
réflexion sur la traduction, un théoricien comme Étienne Dolet,
au 16e siècle, mettait l’accent en premier lieu sur
la nécessité que le traducteur ait une parfaite connaissance de
la langue de l’auteur qu’il a choisi de traduire. Les
compétences linguistiques, et la maîtrise de la langue source,
restent la condition fondamentale du travail de traduction, à
laquelle on peut ajouter le souci de respecter le style de
l’auteur.
Lin Shu est pourtant l’un des
plus célèbres traducteurs chinois : auréolé de gloire de son
vivant, il a été surnommé « roi des traducteurs » (yijie zhi
wang
译界之王). Il a contribué à
faire connaître le genre romanesque occidental en Chine et
témoigne d’une ouverture sur le monde et d’un intérêt pour la
littérature occidentale qui est le propre des grands lettrés du
début du 20e siècle.
Un lettré traditionnel,
des « traductions » historiques
Il est né dans le district de
Min, aujourd’hui Fuzhou, dans le Fujian. Malgré la pauvreté de
sa famille, aimant beaucoup la lecture, il a suivi le parcours
des lettrés pauvres de l’époque, travaillant dur pour passer les
examens impériaux. En 1882, il a réussi à obtenir le titre de
juren (举人),
celui obtenu par les lauréats de ces examens au niveau
provincial. Il avait trente ans et, en cette fin de dynastie des
Qing, partageait le courant d’idées progressistes tournées vers
l’Occident comme un modèle à émuler.
Jusqu’en 1897, il se rend sept
fois à Pékin pour passer les examens au niveau national. C’est
un échec chaque fois, mais ces voyages dans la capitale sont
l’occasion de prendre conscience des problèmes qui se posent
alors au pays. Cependant, cette année-là, il perd son épouse et
en est très affecté.
Pour le tirer de ses idées
sombres, son ami Wang Shouchang (王壽昌),
qui avait fait des études en France pendant six ans, lui propose
de traduire avec lui « La Dame aux camélias » d’Alexandre Dumas.
Le roman avait été publié en 1848, puis adapté au théâtre, par
l’auteur lui-même, en 1852, et à l’opéra par Verdi l’année
suivante : la pièce avait défrayé la chronique. Ils se lancent
ainsi dans un travail à deux, l’un interprétant-racontant,
l’autre notant illico la traduction en chinois.
La « traduction » paraît deux
ans plus tard, en 1899, sous le titre « Histoire transmise à la
postérité de la dame aux camélias de Paris » (《巴黎茶花女遺事》).
C’est un succès immédiat. Le roman frappe d’autant plus les
esprits qu’il est publié dans le contexte du mouvement
réformiste de la fin des Qing – un an après l’échec de la
Réforme des Cent Jours (戊戌变法).
Toute espoir de réforme politique est mort, mais la littérature
occidentale continue d’attirer les lettrés.
| |
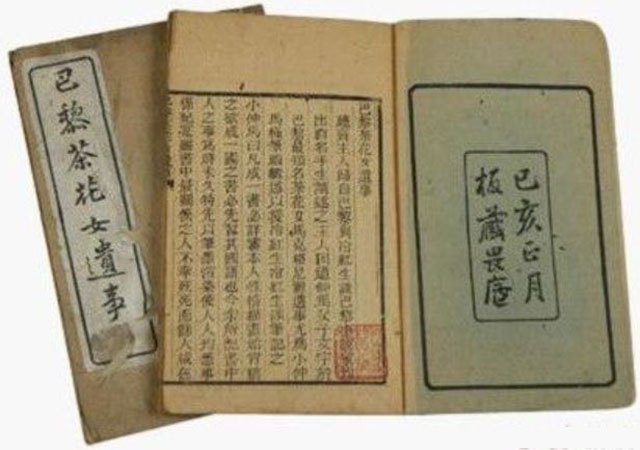
La
Dame aux camélias, traduction Lin Shu, 1899 |
|
Le succès est en grande partie
à porter au crédit de la qualité du travail de Lin Shu qui était
un maître de la prose classique à l’ancienne (guwen jia
古文家). Il est dû d’abord
à l’élégance raffinée de son style. Mais Lin Shu, suivant Wang
Shouchang, a en outre adapté la narration, en la simplifiant au
besoin, pour qu’elle réponde aux traditions narratives
chinoises, et donc aux habitudes des lecteurs chinois. Il a
expliqué sa méthode de travail dans la préface à sa traduction
du roman de Dickens « The Old Curiosity Shop » (en français « Le
magasin d’antiquités »), sous le titre « Biographie d’une fille
d’une grande piété filiale nommée Nell » (《孝女耐兒傳》)
– préface qui est aussi
le reflet de son style recherché :
予不審西文,其勉強廁身于譯界者,恃二三君子,為余口述其詞,余耳受而手追之,聲已筆止,日區四小時,得文字六千言。其間疵謬百出,乃蒙海內名公,不鄙穢其徑率而收之,此予之大幸也。
Je ne connais aucune langue
occidentale et ne participe donc que très modestement aux
traductions, dépendant totalement pour ce faire de deux ou trois
nobles personnages qui m’interprètent les textes oralement ; je
note ainsi leurs traductions au fur et à mesure, reposant ma
plume quand ils ont fini. En quatre heures, nous pouvons
produire quelque six mille caractères. À voir mon travail prisé
par les lettrés les plus honorables en dépit des centaines
d’imperfections et erreurs commises, je m’estime
particulièrement fortuné.
Au moment du
mouvement de la Nouvelle
Culture suivant
celui du 4 mai, au début des années 1920, alors que se
développait la littérature en baihua sous l’égide de Lu
Xun, Lin Shu ne s’est pas opposé au baihua et a même
écrit des poèmes dans cette nouvelle langue vernaculaire ; il
s’est cependant désolidarisé d’un mouvement qui voulait
totalement abolir le chinois classique, qu’il tenait pour
l’essence du chinois littéraire. Il s’est donc trouvé
marginalisé dans son époque.
Un traducteur remis à
l’honneur
En Chine
Au milieu du 20e
siècle, Lin Shu était oublié quand il a été redécouvert, grâce
surtout à l’écrivain
Qian Zhongshu (钱钟书).
Célèbre pour avoir lu et étudié dans leur langue d’origine les
œuvres des grands auteurs classiques mondiaux, de l’Antiquité
grecque au Sonnets de Shakespeare ou au Faust de Goethe, il
s’intéressait aux traductions et a publié en 1963, à un moment
de relative ouverture, un essai assez long intitulé « Les
traductions de Lin Shu » (《林纾的翻译》) :
il les critique bien sûr, reconnaissant les nombreuses
modifications apportées à l’original, mais en distinguant les
traductions d’une première phase de la carrière du traducteur,
jusqu’en 1913 : jusque-là, selon Qian Zhongshu, le style est
vivant et le texte d’une grande qualité littéraire, même s’il
comporte de nombreuses erreurs de traduction. Par la suite, donc
dans les dix dernières années de sa vie, Lin Shu a traduit pour
vivre, et cela se ressent dans son écriture : il peine sur ses
traductions.
Qian Zhongshu leur trouve malgré tout, dans
l’ensemble, des qualités indiscutables, célébrant le travail de
Lin Shu comme celui d’un entremetteur inspiré entre littérature
occidentale et lectorat chinois. Aujourd’hui, il est étudié
comme un cas d’école
.
À l’étranger
Hors de Chine, il est peu de
voix qui se soient élevées pour prendre sa défense. L’un des
rares qui l’aient fait est le grand orientaliste, sinologue et
traducteur britannique Arthur
Waley, traducteur du japonais aussi bien que du chinois
classique. Il célèbre même le travail de Lin Shu dont il trouve
le style, finalement, meilleur que l’original : sous la plume de
Lin Shu, dit-il, Dickens devient un bien meilleur écrivain !
L’humour est toujours là, mais transcrit de manière plus sobre,
en atténuant les excès de « l’exubérance incontrôlée » de
l’original.
L’histoire de la littérature
moderne ne manque pas d’exemples semblables. Le jeune Isaac
Bashevic Singer a ainsi traduit Knut Hamsun, Romain Rolland et
Gabriele d’Annunzio en yiddish sans connaître le norvégien, le
français ou l’italien : il est parti des traductions en allemand
qu’il a pu trouver en Pologne avant la guerre. Mais cela fait
partie de l’histoire des « traductions relais » qui ont
longtemps permis d’avoir des traductions de langues rares,
l’albanais par exemple, en un temps où il n’y avait pas de
traducteurs capables de traduire de l’original.
De manière plus intéressante,
exilé en Argentine, l’écrivain polonais Witold Gombrowicz a
réécrit en espagnol son « Ferdyduke » (publié en 1937) avec
l’aide de deux écrivains cubains qui n’avaient aucune notion de
polonais. C’est dans cette version en espagnol qu’Albert Camus a
découvert le roman. Gombrowicz a ensuite traduit cette version
espagnole en français avec l’aide d’un professeur de l’Alliance
française de Buenos Aires. Et cette édition française a été
publiée par Maurice Nadeau en 1958.
Ce sont cependant des exemple
historiques, des cas d’école qui reflètent des pratiques d’une
autre époque. Dans l’ensemble, les traductions de Lin Shu
fournissent plutôt des contre-exemples des critères de
traduction à retenir aujourd’hui car on a parfois du mal à
retrouver l’original dans le texte chinois. L’un des cas
désormais célèbres est sa traduction du « Don Quichotte » de
Cervantès.
Une histoire de chevalier
enchanté : Don Quichotte
Sous la plume de Lin Shu, le
« Don Quijote » de Cervantès a été rebaptisé « Histoire du
chevalier enchanté » (《魔侠传》),
donc évoque aussitôt une traduction sur le mode chuanqi (传奇),
dans la grande tradition du fantastique chinois et du
roman de wuxia (武侠小说).
En fait, Lin Shu est parti d’une traduction en anglais datant de
1885. Son assistant, Chen Jialin (陈家麟),
avait fait des études universitaires en Angleterre et semblait
donc compétent pour lire l’histoire à Lin Shu. Mais il a en fait
inventé des dialogues et raccourci le texte de plusieurs
chapitres, dont le prologue.
Il est à noter que le « Don
Quijote » rapporte les tribulations d’un vieil homme passionné
de romans chevaleresques, et qu’il était censé être la
traduction d’un texte écrit en arabe attribué par Cervantès à un
historien musulman, stratagème devenu courant au 14e
siècle parmi les écrivains de ce genre de littérature. Il y
avait donc, en un sens, une certaine logique pour le traducteur
chinois à traduire ce roman à partir d’une version traduite en
anglais de la version espagnole de 1605 qui était censée être
une traduction de l’arabe.
| |
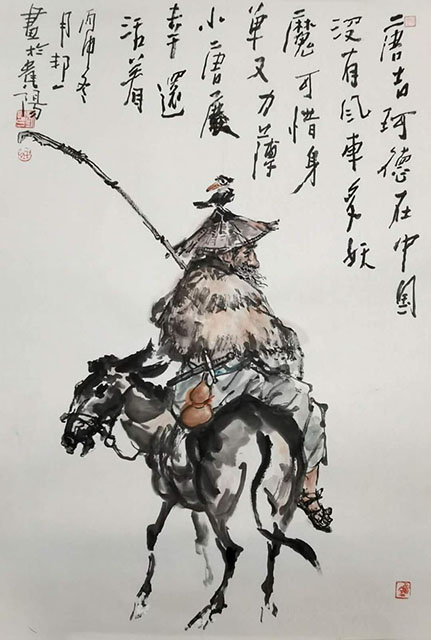
Don
Quichotte en chevalier errant chinois |
|
Lin Shu a entrepris la
traduction en 1921 et elle a été publiée en 1922, par la
Commercial Press (上海商务印书馆)
de Shanghai, deux ans avant sa mort. Un collectionneur chinois
qui, pendant vingt ans, avait collectionné les traductions de
Cervantès en chinois en a fait une exposition en 2013 à
l’Institut Cervantès de Pékin. C’est ainsi qu’a été redécouverte
l’édition originale de la traduction du Quichotte par Lin Shu.
Pour le 100ème anniversaire de sa publication,
avec le concours d’Alicia Relinque, professeure de littérature
classique chinoise à l’université de Grenade, la version
de Lin Shu a été retraduite en espagnol, sous le titre traduit
littéralement du chinois « Historia del Caballero Encantado ».
Le livre a été présenté à l’Institut Cervantès de Madrid le 22
avril 2021. Et la maison d’édition qui a publié la traduction
originale, la Commercial Press de Shanghai, a annoncé une
édition bilingue espagnol/chinois.
| |
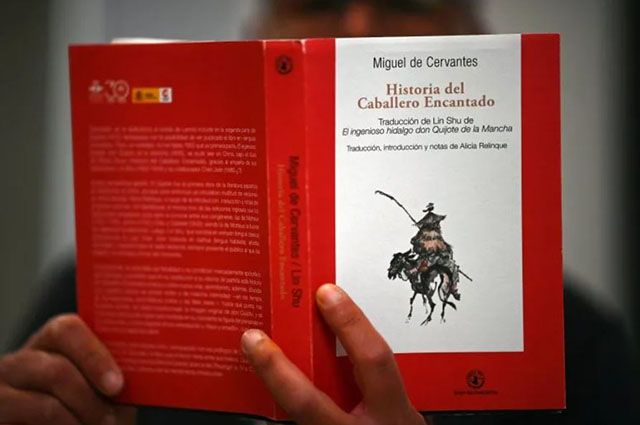
Historia del Caballero Encantado (photo Liu Bangyi) |
|
Don Quichotte est rebaptisé
Quisada, et il est devenu un maître éclairé au lieu d’être un
pauvre hère un peu fou qui prend ses fantasmes pour des
réalités. Il est instruit et cultive les traditions comme tout
lettré chinois qui se respecte, sans aucun ridicule. Dulcinée
s’est muée une jeune femme nommée Dame de Jade. Même Rossinante
est devenu un fringant coursier. En fait, ce n’est pas Quisada
qui est fou, c’est le monde autour de lui, et cette pagaille
ambiante est bien chinoise, dont Dieu a disparu.
La traduction acquiert dans ces
conditions une aura singulière, en devenant un reflet de
cultures croisées et d’époques différentes. Don Quichotte alias
Quisada est ainsi entré dans l’histoire des traductions et on se
demande si on ne pourrait pas faire subir le même sort à la Dame
aux Camélias, par exemple…
À lire en
complément
-
An Analysis of Lin
Shu’s Translation Activity from the Cultural Perspective,
par Chen Weijong et Cheng Xiaojuan, in : Theory and Practice
in Language Studies, Vol. 4, No. 6, pp. 1201-1206, June 2014
-
The Oral
Translator’s “Visibility”: The Chinese Translation of David
Copperfield by Lin Shu and Wei Yi,
par Rachel Lung (Lingnan
University, Hong Kong), revue TTR,
volume 17, numéro 2, 2e semestre 2004,
p. 161–184
|
|

