|
Mythe, légende, épopée … et roman
classique dans la tradition chinoise
par Brigitte
Duzan, 19 septembre 2025
Tentative de définition
Selon la
définition du Robert, un mythe, au sens premier, est un « récit
fabuleux, le plus souvent d’origine populaire, qui met en scène
des êtres incarnant sous une forme symbolique des forces de la
nature, des aspects du génie ou de la condition de l’humanité »,
le Robert soulignant ensuite l’importance du mythe dans les
religions primitives. C’est d’ailleurs cet aspect que Claude
Lévi-Strauss a souligné en disant : « Le mythe est la forme
imagée que prend la science pour se communiquer aux hommes dans
les phases primitives de la société. »
,
une forme de la « pensée sauvage », en quelque sorte.
Ou encore,
comme le dit
Lu Xun
au chapitre II, « Mythes et légendes » (神话与传说), de
sa « Brève histoire du roman chinois » (《中国小说史略》)
:
« C’est en des
temps très reculés, au sein de peuples primitifs faisant face au
monde et à ses étranges transformations et voyant tous les
phénomènes naturels ne procédant d’aucune force humaine, que se
sont formées diverses idées (众说)
pour tenter de les expliquer. Et ces explications, c’est ce que
l’on appelle aujourd’hui « mythe » (神话).
Ces « mythes » sont généralement centrés (中樞)
sur une « figure divine » (神格)
autour de laquelle est déroulée la narration… ».
Cependant,
poursuit Lu Xun, ces « idées » premières ont été altérées et
« enjolivées » par les écrivains et les poètes, si bien que ce
que nous en avons « est le fruit d’une pensée relativement
avancée, que l’on peut difficilement attribuer à un peuple
primitif ».
C’est donc en
ce sens que l’on peut parler de mythes chinois, mais sans qu’il
y ait vraiment une mythologie chinoise. Les textes sont
disséminés dans des sources très diverses, demandant de longues
recherches. Le sujet est aujourd’hui d’une brûlante actualité.
Mythes
et légendes chinois, de Pan Gu à Qin Shi Huang, par Yuan
Ke, éd. révisée 2016
https://book.douban.com/subject/26851513/
Pas de
mythe fondateur unique, textes dispersés
Il n’y a pas
en Chine de mythe (shénhuà
神话) de
création de l’univers par un dieu, mais plusieurs mythes. Il
existe des légendes populaires d’individus qui ont contribué à
créer le monde à partir du chaos ou à le réparer dans des
périodes de troubles, mais ce sont des êtres légendaires (chuánqí
rénwù
传奇人物),
non des êtres divins, des héros à caractéristique humaines,
comme dit Lu Xun, et il en existe de nombreuses variantes ;
c’est le cas de Pan Gu (ou Ban Gu
盤古), né
de l’œuf cosmique du chaos Hundun (混沌)
en le scindant en deux et en séparant ainsi le ciel de la terre,
de Nüwa (女媧)
et de son frère et/ou mari Fuxi (伏羲),
ou encore de l’archer Houyi (后羿)
qui abattit neuf des dix soleils qui brûlaient la terre pendant
le règne de Yao et permit à la civilisation humaine de
s’épanouir.
|
|
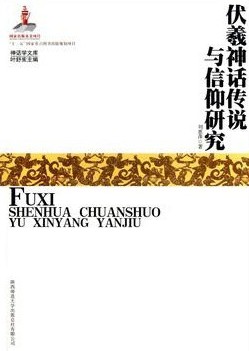
Recherche sur les mythes, légendes et
croyances
associés à Fuxi, par Liu Huiping, 2013 |
|
Les autres
figures mythiques sont des inventeurs : Sui Ren (燧人),
le premier à utiliser le feu (mais sans l’avoir volé aux dieux
comme Sisyphe), Shennong (神農/神农),
fondateur de l’agriculture et des herbes médicinales, Chi You (蚩尤)
inventeur de la métallurgie et des armes de guerre, Can Cong (蠶叢/蚕丛)
inventeur de la sériciculture, ou encore Cang Jie (倉頡/仓颉)
scribe de l’empereur Jaune et créateur de l’écriture chinoise.
|
|

Shennnong ramassant des simples
(peinture anonyme de la dynastie des Liao) |
|
Cependant,
comme le souligne Lu Xun dans le même chapitre II de sa « Brève
histoire du roman chinois » : « De nos jours, mythes et légendes
chinois ne sont toujours pas réunis dans un ouvrage unique qui
leur serait spécifiquement consacré. On ne peut les trouver que
disséminés dans les livres anciens. » C’est-à-dire dans les
classiques.
Interprétation des classiques : mythe et histoire
La mythologie
chinoise se fonde sur l’interprétation des grands textes
classiques qui forment pour la plupart le canon confucéen :
|
|

Peinture murale illustrant des animaux mythiques
du Shanhai jing (musée du Shanxi) |
|
- Le
« Livre
des monts et des mers » (Shanhai jing《山海经》),
vaste compendium d’animaux et de figures mythiques, et des
sacrifices à leur offrir, dont la plus connue est sans doute la
« Reine mère de l’ouest » (Xiawangmu
西王母)
résidant au mont Kunlun (崑崙/昆仑/山),
dans les « montagnes de l’ouest » ;
- Les
chapitres liminaires du « Classique des documents » (Shangshu
《尚書》/《尚书》) :
le Canon de Yao (Yao dian
尧典) et
le Canon de Shun (Shun dian
舜典) qui
relatent l’histoire des règnes des souverains mythiques de
l’Antiquité chinoise et sont aujourd’hui considérés comme
« pseudo histoire »
;
- Le
« Classique des changements » (Yijing
《易經》),
- Certains
des
Commentaires de Zuo (Zuozhuan
《左傳》),
- Des
passages des « Discours des Principautés » (Guoyu
《國語》/《国语》)
dont une discussion à l’époque du roi Mu des Zhou (Zhou
Mùwàng
周穆王)
évoquant la séparation du ciel et de la terre.
On peut
également citer les références à diverses figures mythiques qui
émaillent le
Zhuangzi,
mais surtout :
- Les
« Questions au Ciel » (Tianwen
《天問》/《天问》)
des « Chants de Chu » (Chu ci
《楚辭》/《楚辞》),
long poème posant une série de questions concernant la
mythologie (anciennes croyances, contradictions et énigmes) : il
aurait été écrit par Qu Yuan (屈原)
alors que le poète avait contemplé des scènes représentant des
dieux et des figures ancestrales sur les murs du temple
ancestral de Chu après son exil et il aurait inscrit ses
questions sur les murs mêmes du temple – poème énigmatique
empreint d’un sens du mystère. Il évoque en particulier
l’origine de l’univers en affirmant que personne n’en sait rien.
|
|
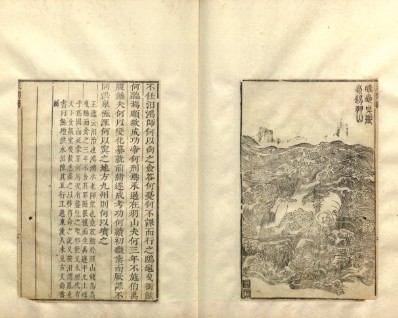
Questions au ciel, éd. illustrée du Li Sao
de Qu Yuan (1645) |
|
Pour reprendre
les analyses d’Anne Birrell, et en particulier son « Introduction
à la mythologie chinoise »
de 1993 et son « atelier
sur l’étude des mythes chinois »
,
les Chinois « n’ont eu ni Hésiode, ni Homère, ni Ovide », et les
recherches sur les mythes par les spécialistes chinois ont
stagné pendant longtemps, pour des raisons politiques. L’étude
des mythes chinois en Europe est longtemps restée fondée sur les
œuvres de
Marcel Granet
et du sinologue suédois Bernhard Karlgren à qui l’on doit une
collation et classification des textes mythiques (en 1946), mais
sans cadre théorique. Les études ont progressé avec l’émergence
dans les années 1980 des sinologues américains et de chercheurs
chinois.
Il est vrai
que la fonction du mythe opère dans une tradition sacrée qui
n’est pas celle des textes chinois. Mais le mythe peut être
étudié dans son rapport à l’histoire, dans son
interaction avec l’histoire.
S’appuyant sur
les études de Paul Cartledge et plus spécialement «
The Greeks : A Portrait of Self and Others »
,
Anne Birrell en dégage plusieurs thèmes applicables à l’étude
des mythes chinois : les mythes portant sur les « barbares »
(chapitre 3 : « Alien Wisdom ») ou ceux sur les rapports entre
divinités et genre humain (chap.7 : « Knowing Your Place : Gods
vs Mortals ») ; mais c’est surtout le chapitre 2 « Inventing the
Past : History vs Myth » qui lui semble le plus applicable aux
études sur les mythes chinois. Cartledge y trace une évolution
chronologique allant du mythe comme histoire, au mythe
dans l’histoire, et au mythe opposé à l’histoire. Il
s’appuie sur Hérodote et Thucydide, mais le schéma pourrait
aussi bien s’appliquer au développement du discours historique
en Chine.
Cartledge
montre comment les mythes (au sens de muthoi, histoires
transmises oralement) furent les seules sources d’Hérodote dans
son analyse des origines des guerres médiques : « L’atmosphère
dans laquelle les Pères de l’Histoire se mirent au travail était
saturée de mythe. Sans mythe, ils n’auraient certainement jamais
pu commencer leur travail ». En ce sens, les points développés
par Cartledge pourraient servir de point de départ pour un
sinologue désirant comparer, et contraster, le développement des
principes historiques de Thucydide et de
Sima Qian (司马迁).
Le rôle et
la fonction du divin dans l’histoire est un autre
thème pour une discussion comparative des historiens grecs et
chinois. Tandis que Sima Qian fait allusion à sa « compréhension
approfondie de la manière dont fonctionnent les affaires divines
et humaines » pour sa connaissance du processus historique,
Thucydide se réfère à « la chose humaine » signifiant que
l’histoire devait être présentée en termes humains et non divins
et que les humains contrôlent leur propre destinée. En général,
malgré son clin d’œil au divin, l’histoire de Sima Qian est elle
aussi orientée vers le pouvoir propre à l’humanité de déterminer
ses propres affaires. Comme Thucydide, il ressent le besoin
d’adopter une attitude sceptique à l’égard de ses sources, « les
fragments épars des anciennes croyances ».
Origines
méridionales, voire « barbares », des mythes chinois
De manière
générale, on a pu noter qu’une bonne partie des mythes et
légendes chinois sont originaires du sud : des royaumes
méridionaux comme ceux de Chu (楚),
de Wu (吳)
et de Yue (越).
Ce sont en effet des zones riches en eau, où la prévention des
inondations était vitale pour la survie des populations, d’où
les mythes de contrôle des eaux (sans qu’il y ait vraiment de
mythe du déluge) par des démiurges comme Gun (鯀),
Gong Gong (共工)
et surtout Yu le Grand (大禹)
et Shun (舜),
dans des récits qui mêlent le mythe à l’histoire et sont
inscrits dans les premiers documents littéraires.
Ces récits
mythiques comme celui de l’empereur Jaune (Huang di
黃帝),
des vertueux souverains modèles Yao (堯/尧)
et Shun (舜)
ainsi que de Yu le Grand (大禹), légendaire
fondateur de la dynastie des Xia (夏)
qui contrôla les eaux et divisa l’empire en neuf provinces (jiuzhou 九州)
ne remontent guère plus loin que la période des Printemps et
Automnes (770-5e siècle avant J.C.). Et la
classification des anciens souverains de l’Antiquité en « Trois
Augustes et Cinq Empereurs » (San Huang Wu Di
三皇五帝)
ne date même que des Royaumes combattants (5e
siècle-220 avant J.C.), voire de la dynastie des Han, soutenue
par les Confucéens qui ont érigé Yao, Shun et Yu en saints
modèles. Mais c’est sur ces récits mythiques que se fondent les
prétentions actuelles à une « civilisation de 5 000 ans », voire
une « culture de 7 000 ans », se poursuivant en ligne continue
jusqu’à aujourd’hui, sans faire de distinction entre le mythe et
l’histoire.
Quant aux
mythes fondateurs, la Chine a bien le mythe de Nüwa, par
exemple. Mais les principaux se trouvent dans les mythologies
des ethnies dites « minoritaires », c’est-à-dire en fait
relevant d’une autre culture. Il en est ainsi du mythe fondateur
du peuple Ba (巴)
dans la ville de Yicheng (夷城),
dans le sud-ouest de la Chine. Pour déterminer la migration et
la colonisation, c’est la divination qui désigne ici la cité
mythique, comme l’oracle d’Apollon chez les Grecs pour la
fondation de Cyrène. L’histoire est transformation du récit
mythique, de même que pour la fondation de Rome. Mais la
fondation des Ba, par un mythique seigneur Lin (Lin jun
林君)
transformé en tigre à sa mort, est relatée dans le « Livre des
Han postérieurs » (Hou Hanshu 《後漢書》/《后汉书》) ;
on est donc à la limite du mythe, de l’épopée et de l’histoire –
mais la Chine n’a pas connu l’épopée ou poème épique (shǐshī
史诗),
qui mêle, justement, légende et histoire pour célébrer un héros
ou un événement extraordinaire.
En fait, tout
en analysant la création des mythes en termes de luttes tribales
et de divinités ancestrales, les historiens chinois ont intégré
les récits mythologiques dans l’histoire en les rattachant à
trois sphères culturelles : Huá (華/华)
à l’est, Xià (夏)
à l’ouest, et les « barbares » (Miáo 苗, Mán 蠻/蛮, Chǔ 楚)
au sud.
Le récit
mythologique est également intégré dans la littérature
populaire, de tradition orale.
Les
mythes dans les romans classiques
Ainsi, le
mythe de « Nüwa réparant le ciel » (女娲补天 )
se trouve dans le récit-cadre du premier chapitre du « Rêve
dans le pavillon rouge » (Hongloumeng《红楼梦》).
Nûwa a fondu 36 501 blocs de pierres pour réparer le ciel, mais
elle n’en a utilisé que 36 500. La dernier bloc de pierre,
abandonné et entendant un bonze bouddhiste et un moine taoïste
qui passaient par là se rire des vanités de ce bas monde, les
pria de les lui faire connaître. Il fut transformé en un jade
très pur et s’incarna en Jia Baoyu (贾宝玉),
Jia Jade précieux. Le roman est l’histoire qu’a gravée dans le
jade le moine taoïste, transmise à Cao Xueqin par un autre
moine. D’où le titre alternatif du roman : « Histoire de la
pierre » (Shítóu jì
《石头记》).
|
|
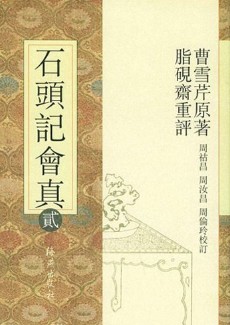
L’histoire de la pierre, version originale,
《石头记会真》
éd. 2004 |
|
« Au
bord de l’eau »
(Shuihuzhuan
《水浒传》)
commence de même par un récit plongeant dans le mythe, et la
cosmologie. Dans son introduction à sa traduction du roman,
Jacques Dars parle bien de mythe, pour en expliquer la
formation, mais au sens dérivé de récit fabuleux d’origine
populaire. Le « mythe » est dans le récit liminaire du roman,
qui relate la libération des 108 démons par un caprice d’un
maréchal en visite d’inspection, officier de l’empereur Renzong
(宋仁宗),
qui ne croit pas, justement, au surnaturel ni aux esprits. Ce
récit introductif est doublé de l’épisode surnaturel de l’Écrit
céleste remis par la divinité Jiutian Xuannü (九天玄女)
pour justifier la réunion progressive des frères jurés et leur
convergence vers le repaire des Monts Liang afin de promouvoir
la loyauté et la justice car ils sont les émanations d’astres de
la Grande Ourse envoyés sur terre dans ce but – astres célestes
pour les 36 premiers, les chefs de la rébellion, et astres
terrestres qui en sont les fidèles lieutenants.
Éléments
bibliographiques
(en français)
- Approches
critiques de la mythologie chinoise,
sous la direction de Charles Le Blanc et Rémi Mathieu,
Presses de l’Université de Montréal, 2008. À lire
sur OpenEdition.
-
Mythe et philosophie à l'aube
de la Chine impériale. Études sur le Huainan zi, sous
la direction de Charles Le Blanc et Rémi Mathieu, Presses de
l’Université de Montréal, 1992. À lire
sur OpenEdition.
De Rémi
Mathieu :
- Étude sur
la mythologie et l’ethnologie de la Chine ancienne, Collège
de France, 1983.
-
Anthologie des mythes et légendes de la Chine ancienne,
Gallimard, 1989.
D’Anne
Birrell :
- Mythes
chinois [Chinese Myths, 2000], trad. Véronique
Thierry Scully, Le Seuil, « Points Sagesses », 2005.
|

