|
|
Les grands sinologues français
Jacques Gernet (1921-2018)
Présentation
par Brigitte
Duzan, 8 octobre 2025
Éminent maître
de la sinologie française, Jacques Gernet est entre autres
l’auteur d’un ouvrage sur l’histoire de la Chine qui reste une
référence : « Le Monde chinois », initialement publié en 1972.
| |
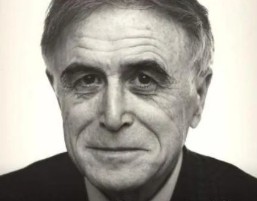
Jacques Gernet (photo Collège de France) |
|
Son père était
l’helléniste Louis Gernet (1882-1962), élève de Durkheim, ami de
Marcel Granet
et de Marcel Mauss, et historien de la pensée juridique et
morale de la Grèce ancienne. Et c’est parce que son père venait
d’être nommé professeur à l’université d’Alger que Jacques
Gernet est né là, en 1921, trois jours avant Noël.
Il suit
d’abord les pas de son père et obtient une licence de lettres
classiques à l’université d’Alger en 1942, mais ses études sont
interrompues par la guerre car il est mobilisé entre 1942 et
1945. C’est son échec à l’agrégation de lettres classiques qui
l’oriente vers les études chinoises, mais il reste fidèle au
modèle paternel en contribuant à introduire une approche
anthropologique dans l’étude de l’histoire chinoise. Il obtient
en 1947 un diplôme de chinois à ce qui était encore l’École
nationale des langues orientales (Langues-O, devenue INALCO),
puis en 1948 à l’École pratique des Hautes Études (EPHE) où il a
été l’élève de
Paul
Demiéville
qui y était directeur d’étude depuis 1945.
Il intègre
alors l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) et réside de
février 1949 à novembre 1950 à Hanoï où il publie son premier
magnum opus : la présentation et la traduction des enseignements
de Shenhui (Heze Shenhui
菏澤神會/菏泽神会),
patriarche du 8e siècle de l’"école du sud" du
bouddhisme Chan. À son retour en France fin 1950, Jacques Gernet
devient chercheur au CNRS.
En 1955, il
est nommé directeur d’études à la VIe section de l’EPHE (future
l’EHESS). Il soutient l’année suivante sa thèse pionnière sur
les aspects économiques du bouddhisme dans la société chinoise
du 5e au 10e siècle. À partir de 1957, il
enseigne également la langue et la civilisation chinoises à la
Sorbonne, d’abord comme maître de conférences, puis comme
professeur à partir de 1959 ; il poursuit sa carrière dans le
même poste à l’université Paris 7 à sa création après Mai 68. En
1968, il y fonde l’Unité d’enseignement et de recherche des
Langues et civilisations de l’Asie de l’Est et la dirige
jusqu’en 1973.
En 1974, Rolf
Stein, titulaire de 1966 à 1981 au Collège de France de la
chaire Étude du monde chinois : institutions et concepts, plaide
pour l’élection de Jacques Gernet au Collège. C’est ainsi que,
le 4 décembre 1975, dix ans après le départ à la retraite de son
maître
Paul
Demiéville,
Jacques Gernet inaugure la
chaire
d’Histoire sociale et intellectuelle de la Chine
(Histoire et archéologie) qu’il occupera jusqu’à son départ à la
retraite en 1992. En juin 1979, c’est encore à Paul Demiéville,
trois mois après son décès, que Jacques Gernet succède à
l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Dans son
hommage
à son illustre prédécesseur, Anne Cheng cite les remarques de
Jean Levi considérant les travaux de Gernet sous une triple
approche : d’une part, la conviction qu’une histoire
véritablement universelle ne peut négliger la spécificité
chinoise et ses apports aux autres cultures ; d’autre part, une
méthode comparative inspirée de
Marcel Granet,
partant du concret et s’inscrivant dans une réalité et une
temporalité spécifiques pour remonter vers le général ; des
travaux, enfin, qui s’inscrivent dans le courant de la
micro-histoire, en particulier à travers l’étude des mentalités.
Mais, sous des
dehors quelque peu austères, Jacques Gernet était profondément
simple et humain comme aiment à le rappeler ceux qui l’ont
connu, et sont encore là, telle Anne Cheng, pour en témoigner.
Il était aussi gentiment provocateur parfois, et certaines de
ses idées n’en finissent pas de résonner comme un rébus à
déchiffrer : « Le monde chinois, bien plus complexe que l’on a
toujours tendance à l’imaginer, a connu différentes humanités
successives. »
À lire en
complément
L’Hommage
d’Anne Cheng à Jacques Gernet
sur le site du Collège de France.
Hommage qui
commence par un bref retour historique sur les éminents
représentants de la sinologie française qui ont précédé Jacques
Gernet au Collège de France depuis 1814, et dont elle est la
dernière héritière, 1814 c’est-à-dire « l’année où fut créée une
chaire Langue et littérature tartares-mandchoues attribuée à
Jean-Pierre
Abel-Rémusat »,
suivi de manière quasi-continue par
Édouard
Chavannes
(1865-1918),
Paul Pelliot
(1878-1945) ou encore
Henri Maspero,
mort en déportation à Buchenwald en 1945. « Le flambeau fut
repris après la guerre par
Paul
Demiéville,
titulaire de la chaire Langue et littérature chinoises de 1946 à
1964, que Jacques Gernet considérait comme son maître et auquel
il vouait une admiration sans borne ».
Jacques
Gernet, leçon inaugurale
de la chaire Histoire sociale et intellectuelle de la Chine du
Collège de France, prononcée le 4 décembre 1975.
| |
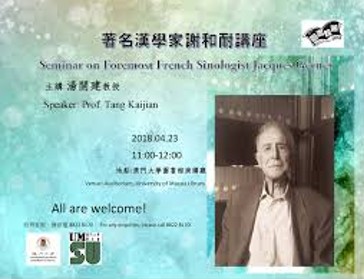
Exposition et hommage à la bibliothèque
de
l’université de Macau, mars-mai 2018 |
|
Principales
publications
Ouvrages
-
Entretiens du maître de dhyâna Chen-houei du Ho-tsö (668-760),
Hanoi, EFEO, 1949 [rééd. 1974].
- Les
aspects économiques du bouddhisme dans la société chinoise du Ve
au Xe siècle,
Saigon, EFEO, 1956 [rééd. 1977].
- La vie
quotidienne en Chine à la veille de l'invasion mongole,
Hachette, 1959 [rééd. 1978, 1990], in :
« Écrit et histoire en Chine », Journal de psychologie
normale et pathologique, janv.-mars 1959.
-
Catalogue
des manuscrits chinois de Touen-houang (Fonds Pelliot-chinois), de
la Bibliothèque nationale,
vol. 1, avec
Wu Chiyu, Paris, Bibliothèque nationale, 1970.
- Le Monde
chinois,
Armand Colin, coll. « Destins du monde », 1972
[rééd. 1980, 1990, 1999], ouvrage abondamment illustré de
planches et de cartes.
Rééd. Pocket
2006, en 3 tomes : I. De l’âge du bronze au Moyen-Âge (2100 av.
JC-Xe s. après JC) ; II. L’époque moderne (Xe-XIXe s.) ; III.
L’époque contemporaine (XXe s.).
| |
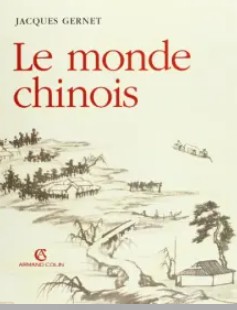
Le
Monde chinois, Armand Colin 1999 |
|
- Chine et
christianisme, action et réaction,
Gallimard, 1982 [rééd. sous-titrée : La première
confrontation, 1991].
- Tang
Zhen, Écrits d'un sage encore inconnu,
Gallimard, 1991
-
L'intelligence de la Chine : le social et le mental,
Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1994.
- La Raison
des choses : Essai sur la philosophie de Wang Fuzhi (1619-1692),
Gallimard, coll. « Bibliothèque de philosophie », 2005.
-
Société et
pensée chinoises aux XVIe et XVIIe siècles (résumés
des cours du Collège de France, 1975-1992), Fayard/Collège de
France, 2007.
- La Vie
quotidienne en Chine à la veille de l'invasion mongole,
1250-1276, Hachette, 1959/1978, Philippe Picquier, 2007.
Articles
- « Être
enterré nu », Journal
des savants, Persée, vol. 1, no 1, janv.-sept.1985, p. 3-16
[Sur
l’importance des rites funéraires, mais aussi la nécessité
d’éviter les excès en « faisant retour à l’authentique].
- « Clubs,
cénacles et sociétés dans la Chine des XVIe et XVIIe siècles », Comptes
rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, Persée, vol. 130, no 4, 1986, p. 676-685
- « L'École
française d'Extrême-Orient et les études chinoises », Comptes
rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, Persée, vol. 144, no 4, 2000, p. 1501-1505
Compte
rendu par Michel Cartier
dans la revue Annales, 1973, 28-2, pp. 464-466
Compte
rendu par Roger Levy,
dans la revue Politique étrangère, 1972, 37-5, pp.
705-708.
Roger
Levy souligne quelques-unes des questions que pose cette
histoire : « La Chine a-t-elle vocation
centralisatrice ? Est-elle sujette à des éclatements ?
A-t-elle été expansionniste, l’est-elle redevenue ? etc.
À ces questions,… parmi d’autres, répondent les
commentaires de M. Gernet qui montre que la Chine fut
centralisatrice et ignora les voies transcendantes »
citant Marcel Granet : « En Chine, ni dieu ni loi. »
Réponses souvent originales et non-conformistes, comme
dans l’analyse des relations de la Chine avec le Japon,
dont Jacque Gernet souligne l’influence positive, et
même pacifique, qu’il a pu avoir.
|
|

