|
|
La littérature chinoise au XXe
siècle
IV. Shanghai années 1920 : la
ville comme laboratoire, entre littérature et cinéma
par Brigitte
Duzan, 14 février 2025
Laboratoire littéraire « exotique »
Dans un livre
publié en 1927, « Ce qui ne s’avoue pas, même à Shanghai, ville
de plaisirs », le « sinologue » Georges Soulié de Morant qui fut
un temps (de 1903 à 1906) élève-interprète au consulat de la
Concession française
dépeint la ville ainsi :
|
 |
|
« Cette foule de gens, prisonniers en fuite, hommes
d’affaires,
militants politiques, banquiers, étudiants et
lettrés, passent leurs journées à clamer à grands
cris la nécessité de se battre contre l’oppression
de la terreur étrangère, en ajoutant qu’il aurait
fallu depuis longtemps récupérer les concessions
étrangères – mais espérant en fait que les étrangers
ne partent jamais. »
|
Soulié faisait
lui-même partie de cette « terreur étrangère » et son ironie un
rien méprisante est un reflet de la mentalité qui régnait à
Shanghai dans les concessions. Un critique d’art nationaliste, à
la même époque, exprime au contraire son admiration pour la
civilisation occidentale : « C’est seulement depuis que les
étrangers sont arrivés à Shanghai que la ville a des parcs, des
rues propres, des grands magasins chic, une saison de concerts
d’octobre à mai, des musées et des bibliothèques… Il faut
reconnaître que, de toutes les nations, celle qui a la
civilisation la plus en avance… c’est l’Europe. »
Beaucoup
d’artistes et intellectuels chinois à l’époque avaient vécu au
Japon, et en avaient rapporté une esthétique nourrie de culture
occidentale, le Japon apparaissant comme une vitrine sur le
monde occidental, et un modèle de création artistique. Dans ce
contexte, c’est la ville qui est le site privilégié et la
précondition de l’art moderne. C’est la ville qui offre les
« temples » de la civilisation, et la communauté nécessaire,
loin de la campagne obscurantiste. Et l’épitome de la ville,
c’est Shanghai.
Dans ces
années 1920, Shanghai était une ville décriée par beaucoup pour
n’être plus tout à fait un village mais pas encore vraiment une
ville, une ville en devenir ayant perdu les beautés de la
campagne sans avoir encore atteint la modernité de la
metropolis. Mais c’est justement ce caractère un peu
hybride, parce que Shanghai offrait l’image d’une ville qui
n’était pas tout à fait la Chine, avec une touche d’exotisme au
sens propre de goût pour l’étranger, que cette ville pouvait
devenir une laboratoire culturel où pouvait être menée, comme en
éprouvette, la restauration et la modernisation de la culture
chinoise.
Le centre de
ce laboratoire, c’était justement la Concession française, et
son avenue Joffre (aujourd’hui partie centrale de Huaihai lu,
en shanghaien Wahae Lu
淮海路)
offrant aux flâneurs et artistes l’image plus ou moins fantasmée
d’une avenue des Champs-Elysées miniature.
C’est un exotisme un rien sensuel qu’affiche là Shanghai,
évoquant l’aspect sulfureux d’Alexandrie dans la « Thaïs »
d’Anatole France :
« Je te hais, Alexandrie, proclame l’ascète Paphnuce, je te hais
pour ta richesse, pour ta science, pour ta douceur et pour ta
beauté. Sois maudit, temple des démons ! »
Thaïs
qu’aimait à citer
Zhang Ruogu
(张若谷)
qui a dépeint Shanghai en termes « exotiques » dans l’un des
essais de son recueil « Yiguo qingdiao » (《异国情调》),
c’est-à-dire « Exotisme ». Zhang Ruogu avait commencé sa
carrière en traduisant et commentant la littérature française,
et ses « histoires urbaines » en sont inspirées, mais en y
mêlant une culture musicale nourrie de la biographie de
Beethoven par Romain Rolland comme de la musique viennoise et de
son esprit fin-de-siècle.
Yiguo qingdiao
Lui aussi émanation de la Concession française où il avait passé
l’essentiel des années 1898-1902 à apprendre le français, Zhang
Ruogu fut le « parrain » des nouveaux salons intellectuels de
Shanghai, selon le modèle des salons de l’aristocratie
littéraire parisienne, suivi en cela par le préfacier de « Yiguo
qingdiao », l’écrivain et éditeur
Zeng Pu (曾朴/曾樸) :
il habitait une superbe résidence rue Massenet et, avec son fils
aîné Zeng Xubai (曾虚白),
il ouvrit en 1927 une librairie qui se voulait « salon à la
française » (“法式沙龙”),
nommée Zhen mei shan (真美善),
le vrai, le beau et le bien.
Avec la revue
éponyme doublant la librairie, Zeng Pu se lança alors dans des
traductions d’œuvres françaises, des pièces de Victor Hugo et de
Molière, mais aussi le roman délicieusement « décadent » de
Pierre Louÿs « Aphrodite » qui lança les éditions du Mercure de
France en 1896 et inspira son propre roman « Fleur sur l’océan
des péchés » (Nie Hai Hua《孽海花》)
– superbe métaphore de l’univers chinois qui pourrait aussi bien
être celle de Shanghai qui en était le microcosme.
Dans le salon
de Zeng Pu se croisait le gratin des écrivains et des
traducteurs de l’époque, les discussions portaient aussi bien
sur les traductions de
Lin Shu (林紓)
que sur les romans d’Anatole France, de George Sand ou de Loti,
et chacun avait son idole. En 1928, Zeng Pu publia sa « Vie
littéraire » (Wenxue shenghuo
《文学生活》)
sur le modèle de celle d’Anatole France. Il se voyait lui-même
comme une réincarnation de Hugo ; lui et son fils Zeng Xubai
étaient considérés par ailleurs comme la version shanghaienne
d’Alexandre Dumas père et fils.
L’autre salon
francophile de Shanghai était celui du poète Shao Xunmei (邵洵美),
rejeton d’une riche famille de la ville : son père avait été un
dandy notoire à Pékin, avant de poursuivre son mode de vie
extravagant à Shanghai. Shao Xunmei avait visité l’Italie,
étudié à Cambridge et aux Beaux-Arts à Paris, puis à son retour
à Shanghai avait fondé la librairie « de la chambre d’or »
Jinwu shudian (金屋书店),
avec sa revue mensuelle, Jinwu yuekan (金屋月刊).
Le but était de publier sa propre poésie « décadente », inspirée
par « Les fleurs du mal » de Baudelaire comme l’indique déjà son
titre (Hua yiban de zui’e《花一般的罪恶》).
Son salon arborait un buste de Sappho qui venait des fouilles de
Pompei, et un manuscrit du poète anglais Swinburne qui était son
idole.
En 1937, il
eut une liaison avec la journaliste américaine Emily Hahn qui
écrivait pour The New Yorker. Il lui acheta une superbe maison
près de l’avenue Joffre, qui fut un autre salon « exotique ».
C’est Shao Xunmei qui la mit en liaison avec les sœurs Soong
dont elle écrivit la biographie. Il l’introduisit aussi à la
pratique de l’opium... Son recueil de nouvelles « Mr
Pan »,
publié en 1942, en regroupe une série écrites pour le New Yorker
concernant un certain « Pan Heh-ven » qui était en fait Shao
Xunmei. Il est désigné sous le nom de Zau Sinmay dans ses
mémoires.
Mr. Pan, 1942
Mais Shao
Xunmei est aussi en filigrane derrière le personnage du « Peng »
de la nouvelle de 1929 de Zhang Ruogu « Symphonie urbaine » (Duhui
jiaoxiangqu《都会都会交响曲》) :
les trois noctambules du récit se retrouvent dans le décor
orientaliste du bar Cairo Nights ou du café Renaissance, passent
devant les néons du New York Café avant de s’engouffrer dans la
semi-obscurité du dancing (japonais) du Trocadéro !
Les titres de
ce genre ont fleuri, en cette fin des années 1920 : « Histoires
d’amours urbaines » (Dushi de nannü
《都市的男女》)
de Xu Weinan (徐蔚南)
également en 1929, ou « Paysages urbains » (Dushi fengjing
xian《都市风景线》)
de
Liu Na’ou (刘呐鸥)
un an plus tard.
Terreau
du néosensationnisme
Imitation
du Japon
Ce qui prime,
alors, c’est la vitesse et une vision fragmentée, comme de
bribes de paysage qui défilent à toute vitesse, comme par la
fenêtre d’un train : le néosensationnisme est né du mouvement
japonais Shinkankakuha (新感覚派)
lancé en 1924 par des jeunes écrivains autour de Kawabata et
Yokomitsu, après le tremblement de terre qui a frappé l’île de
Honshu le 1er septembre 1923 et déclenché des
incendies attisés par le vent d’un typhon concomitant. La
catastrophe fut suivie d’un massacre de Coréens et autres
étrangers. Les conséquences s’en firent sentir dans les années
suivantes, et tout particulièrement dans les écrits de Kawabata.
Dans son roman
paru en 1930, « Le gang rouge d’Asakusa » (Asakusa Kurenaidan
浅草紅團),
il dépeint la vie de toutes jeunes prostituées, et autres
personnages surtout féminins en marge de la société, dans ce
quartier qui était à Tokyo dans les années 1920 l’équivalent de
Montmartre. C’est une narration originale, influencée par le
modernisme occidental, qui va à son tour influencer les jeunes
écrivains chinois venus étudier dans la capitale japonaise.
Frappé depuis
son plus jeune âge par la disparition successive de ses parents,
de sa sœur, de sa grand-mère, puis de son grand-père devenu
aveugle, Kawabata revient constamment dans ses premiers écrits,
de 1916 à 1926, sur son rapport quasi obsessionnel à la mort et
à la solitude : « L’abonné des funérailles », « Les sentiments
d’un orphelin », « Le visage de la morte », « Le Maître des
funérailles », etc. Et c’est en septembre 1924 qu’il fonde avec
Yokomitsu Riichi et une douzaine d’autres amis la revue
d’avant-garde Bungei jidai ou L’époque de la littérature,
qui sera la revue du mouvement Shinkankakuha. Kawabata
publie l’année suivante dans la revue l’article Shinshin
sakka no shinkeikō kaisetsu ou « Notes sur les nouvelles
tendances des nouveaux écrivains » : c’est le manifeste du
mouvement, en rupture avec la littérature traditionnelle, mais
aussi en opposition à la littérature prolétarienne. L’accent est
mis sur les « nouvelles sensations », et le modèle cité … Paul
Morand : logique des sens plutôt que logique rationnelle.
Par ailleurs,
Kawabata était passionné de photographie et de cinéma. En 1926,
il coécrit un scénario pour le réalisateur et acteur onnagata
Kinugasa Teinosuke, pour un film expérimental en noir et blanc
qui se passe dans un asile, entre expressionnisme allemand et
cinéma muet soviétique : « Une page folle » (Kurutta ippēji).
Il est considéré comme le premier film du courant
néo-sensationniste.
Dans la copie existante, malheureusement, il manque près d'un
tiers du film original. En outre, il n’a pas d'intertitres, ce
qui le rend difficile à suivre. Dans les années 1920, les
projections au Japon comprenaient une narration dans la salle,
assurée par un conteur ou benshi, avec une musique
d'accompagnement. Le film est considéré de nos jours comme un
chef-d’œuvre du cinéma muet mondial.
À l’école
de Paul Morand
On voit que
les très courts récits de Kawabata sont proches du montage
séquentiel d’un film et de l’écriture scénaristique. C’est ce
style très particulier qui a inspiré les néo-sensationnistes
chinois, mais sans atteindre à la richesse des thèmes abordés
dans son œuvre, ni leur puissance évocatrice dans leur extrême
brièveté.
Ils adoptent
un style syncopé pour traduire la vitesse qui semble être pour
eux la caractéristique essentielle de la modernité. Et on
retrouve bien là l’influence revendiquée de Paul Morand qui,
entre 1921 et 1935, a publié une série de tableaux urbains
elliptiques : ce sont des images de wagons-restaurants,
d’automobiles vibrant sous l’effet de la vitesse, et toujours de
femmes fatales sans scrupules qui semblent nées de cet univers
en mouvement constant.
Son succès au
Japon était dû en grande partie aux traductions de Horiguchi
Daigaku (堀口
大学),
lui-même poète et traducteur des surréalistes français. C’est sa
traduction de la nouvelle « Ouvert la nuit » (Yo hiraku)
qui a lancé la mode de Morand,
d’abord auprès de Yokomitsu Riichi – nouvelle qui est justement
son coup d’essai et son coup de maître, où d’emblée, comme
le dit si bien Pierre Assouline,
« il
trouve la note juste : vitesse, densité, brièveté. Pas de gras,
une écriture à l’os, un rythme syncopé. » Et justement, il lui
faut la forme courte, quand il tente le roman, pourtant titré
« L’Homme pressé », il s’embourbe, lui-même se dit trop flemmard
pour écrire des sagas. Et tellement imbu de lui-même qu’à sa
mort il lègue sa bibliothèque à l’Institut, mais aussi une somme
d’argent pour doter un prix Paul Morand !
| |
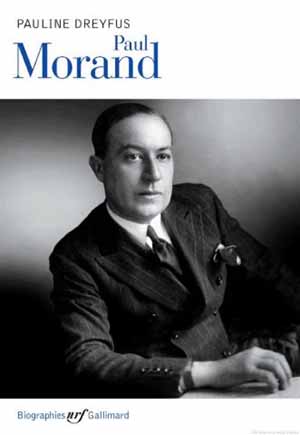 |
|
C’est ce
personnage sulfureux dont les nouvelles et le style ont fasciné
les émules chinois des néosensationnistes japonais. Comme le dit
encore Pauline Dreyfus : « D’emblée, dans ses nouvelles et ses
romans, Morand épouse les prouesses de son siècle en rompant
avec un monde englouti à jamais... Il roule vite, il vole loin.
La Terre a rétréci et il le fait savoir…. » Mais ce n’est pas
seulement son style que ces écrivains ont voulu imiter, c’est sa
vie même, entre divertissements mondains et avant-garde
littéraire et artistique. Et
Liu Na’ou
était sans doute le plus caractéristique, avec son goût pour
l’argent et les femmes… et pour l’opium, ce qu’on dit rarement,
il aura fallu Emily Hahn pour le dire.
Littérature, cinéma… et tradition
Ce mouvement
littéraire était aussi concomitant des premiers balbutiements du
cinéma chinois, l’un nourrissant l’autre. On retrouve dans les
films bien des traits caractéristiques du néosensationnisme tant
dans le style que dans les images, dont l’aspect syncopé est
accentué par les contraintes dues à la technique du muet. Comme
dans les cercles parisiens autour de Cocteau, comme dans le cas
de Kawabata, il y a collusion entre écrivains et cinéastes.
Liu Na’ou,
par
exemple, a dirigé la revue « Cinéma moderne » (Xiandai
dianying《现代电影》)
et il a produit en 1938, à la compagnie Guangming (光明影业公司), un
film réalisé par
Li Pingqian (李萍倩), inspiré
de « La Dame aux camélias » (Chahua nü《茶花女》).
Ce n’est certainement pas anodin : derrière « La Dame aux
camélias » se profilait Alexandre Dumas fils, alter ego du fils
de Zeng Pu, mais surtout c’était la première grande traduction
de
Lin Shu (林紓)
et de son comparse Wang Shouchang (王寿昌),
publiée la 25e année du règne de Guangxu,
c’est-à-dire en 1899. Ce fut ainsi le premier roman occidental
introduit en Chine à devenir populaire dans tout le pays, sous
le titre « Histoire transmise à la postérité de la Dame aux
camélias de Paris » (《巴黎茶花女遺事》).
On a appelé le roman « Le Rêve dans le pavillon rouge
occidental ». Il faut rappeler que c’était un an après l’échec
de la Réforme des Cent jours, alors que tout espoir de réforme
politique était envolé… le roman et le cinéma prenaient le
relais des espérances mortes.
| |
 |
|
La
traduction de Lin Shu
Le roman n’a
cessé de connaître de nouvelles traductions
et de nouvelles adaptations. Il est à noter que la
représentation théâtrale à Tokyo, en 1907, par des étudiants
chinois de la compagnie Chunliu (“春柳社”),
fut aussi l’une des premières représentations de théâtre
huaju sous l’influence du nouveau théâtre japonais,
avec Li Shutong (李叔同)
dans le rôle principal. On était encore dans la tradition de
l’opéra chinois, avec les rôles féminins interprétés par des
acteurs, comme au Japon. Là aussi, les représentations au Japon
de la troupe Chunliu étaient fortement influencées par
les événements politiques en Chine.
Li Shutong
(à g.) dans le rôle de
la Dame aux
camélias en 1907 à Tokyo
On mesure
ainsi tout ce que le néosensationnisme comportait malgré lui,
pour ainsi dire, de tradition indissociable de la culture
ambiante. Mais aussi de volonté affichée et turbulente de s’en
démarquer. Il était le produit d’une époque et ne lui a pas
survécu.
Et
Thaïs montant sur scène s’attire la réprobation des
lettrés alexandrins qui s’offusquent du déclin du
théâtre et du fait qu’une femme ose se montrer sur scène
(« Qu’eussent dit les Athéniens de Périclès ? Il est
indécent qu’une femme paraisse en public. ») –
exactement comme les Chinois qui nourrissaient le même
mépris pour les actrices de cinéma, ou de théâtre en
général.
Le
film (70’) a été projeté à la Cinémathèque à Paris en
1972, au
festival des Trois-Continents en 2012,
et de nouveau à Paris en septembre 2017 dans le cadre de
l’Etrange Festival au Forum des images. Il en existe
maintenant un DVD sous-titré en français.
|
|

