|
|
« Les lignes de
navigation du sommeil » :
première traduction en
français d’un roman du Taïwanais Wu Ming-yi
par Brigitte Duzan, 8 juin 2013
|
« Les lignes de
navigation du sommeil » (《睡眠的航線》) est le premier roman publié, en 2007, par l’écrivain taïwanais
Wu Ming-yi (吳明益),
après plusieurs recueils de nouvelles et deux livres sur
les papillons qui sont autant des réflexions sur les
relations de l’homme avec son environnement naturel.
Ce premier
roman, lui, est une réflexion à la fois sur l’histoire
et la fiction, et le flou qui préside à leur
distinction, surtout quand l’histoire est narrée par le
biais de la mémoire et du rêve. Pour mener à bien sa
réflexion,
Wu Ming-yi
croise, dans un réseau foisonnant, les destins de
plusieurs personnages pris dans une trame de
considérations diverses, apparemment sans rapport entre
elles ni avec eux, comme s’il était impossible de capter
la réalité, imprévisible et fuyante.
Une
narration éclatée entre quelques personnages, une tortue
et Guanyin |
|
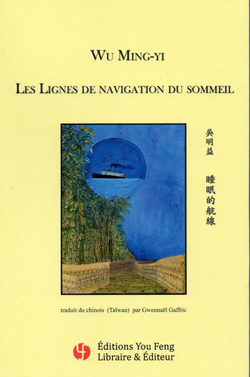
Les lignes de navigation du sommeil |
Sur un fond de
narration historique fragmentaire apparaît un réseau de
personnages humains et non humains qui représentent chacun une
facette de la réalité, si réalité il y a, et qui constituent des
lignes narratives alternées.
Personnages humains…
Il y a d’abord un jeune
garçon du nom de Saburō,
nom japonais choisi quand il lui a fallu se mettre
à l’heure impériale, au début
de la guerre sino-japonaise. Il raconte comment il a fait partie
des jeunes Taïwanais recrutés par l’armée japonaise à partir de
1943, et comment il s’est retrouvé sur un bateau japonais, pour
aller travailler dans une usine d’armement de la marine comme
shonenko,
c’est-à-dire jeune ouvrier.
Le récit de
Saburō
fourmille de détails personnels, sur la formation des noms
japonais à partir des noms chinois, sur les tempêtes et le mal
de mer pendant la traversée vers le Japon, ou sur les conditions
de recrutement des lycéens taïwanais et leur intégration dans
l’armée japonaise, avec pour conséquence leur assimilation dans
l’empire japonais après apprentissage de la langue.
Il y a ensuite un journaliste dont le sommeil s’est déréglé –
d’ailleurs
Saburō,
de son côté, est somnambule. Cela nous vaut des pages entières
de péroraisons pseudo médicales sur les déphasages du sommeil,
mais surtout illustre un malaise existentiel, un décalage par
rapport à la réalité et la vie quotidienne : le sommeil perd son
potentiel de récupération, physique et mentale, pour devenir
phénomène disruptif, condamnant à la solitude dans une société
fondée sur la régularité des cycles diurnes et nocturnes, la
solitude de celui qui veille pendant que tout le monde dort.
Et puis il y a les souvenirs d’enfance de l’auteur, prêtés à
Saburō
mais contés à la seconde personne, comme dans un miroir :
souvenirs du vieux marché et de la boutique du père, des
bicoques de
bambou d’avant le marché qui
laissaient passer la pluie et du cocktail de langues et
dialectes qu’on y parlait, des postes de radio qui diffusaient
des émissions en japonais et en taïwanais… L’image du marché,
liée à celle du père, revient régulièrement, avec des précisions
complémentaires chaque fois,
jusqu’à dresser un tableau
très évocateur, la destruction du marché étant liée à la
cirrhose du père et à sa mort : la fin d’un monde.
La galerie de portraits s’enrichit et se complexifie, dans la
seconde partie du roman, de personnages secondaires qui viennent
apporter une autre illustration de la guerre, vue côté
américain, ou offrent une ouverture vers un Japon mythifié vers
lequel se tourne le journaliste pour aller chercher un remède à
ses troubles du sommeil.
… et figures
emblématiques
Le roman fait une large
place à deux personnages récurrents d’ordre emblématique qui
rattachent le récit à la tradition chinoise, mais en la
détournant.
L’un est une tortue
utilisée pour remplacer un pied de lit vermoulu qui apparaît
comme une sorte de figure totémique, rappelant irrésistiblement
la tortue du mythe chinois des origines (1). Mais, dans le
roman, la tortue a un rôle psychanalytique, dans le décryptage
des rêves des dormeurs au-dessus
d’elle ; mais, une fois
libérée du poids du lit, lorsque celui-ci doit être déménagé à
la veille de la destruction du marché, le poids de la réalité
extérieure lui semble encore plus lourd à supporter.
Quant au second
personnage emblématique, c’est Guanyin, le boddhisattva de la
compassion, à l’écoute de toutes les plaintes du monde, image de
la bienveillance et recours ultime pour les malheureux et les
opprimés (2). Mais, ici encore, le mythe est détourné : Guanyin
est un boddhisattva pathétique qui ne peut pas pleurer au risque
d’inonder l’univers de ses larmes tant les peines du monde
qu’elle perçoit sont immenses. Le rêve, dans son cas également,
prend le pas sur la réalité : frappée d’impuissance devant l’ampleur des
souffrances humaines, elle croit les voir en rêve… Ironiquement,
elle devient aussi image symbolique servant aux échanges de
signes de bonne volonté entre la Chine et le Japon…
Un roman
intéressant, mais inégal
« Les lignes de
navigation du sommeil » apparaît ainsi comme une intéressante
refonte de la manière habituelle, et linéaire, d’envisager
l’histoire et la mémoire. Conté sur plusieurs niveaux, de points
de vue divergents, le récit déstabilise et oblige à laisser de
côté les images préconçues. Le Japon n’est
plus l’envahisseur ou
le colonisateur que les gagnants de l’histoire ont statufié ; Wu
Ming-yi montre le choc et la perte de repères entraînés par la
fin de la guerre et la défaite impériale chez des jeunes qui
avaient été parfaitement assimilés dans l’empire japonais.
Le travail de mémoire,
et ses difficultés, sont très bien illustrés par les évocations
récurrentes du marché et de la vie dans la ville d’autrefois,
images parcellaires qui viennent peu à peu se renforcer, par un
processus cumulatif très bien mené. Le tout est structuré par
une réflexion sur le rêve, la fragilité du souvenir,
l’ambivalence de la mémoire, et le rôle qu’elle joue pour
combler les manques ressentis dans la vie, qui forme un
leitmotiv majeur du roman.
Malheureusement, pour
asseoir son propos, Wu Ming-yi parsème son texte de longues
digressions qui se veulent scientifiques ou médicales, ce qui
est non seulement inutile, mais en outre très lourd (surtout
tout ce qui concerne les longues théories sur le sommeil) ; cela
vient rompre le charme de son texte et la virtuosité de sa
construction par ailleurs. S’il tenait beaucoup à ces idées, il
aurait pu, au moins, les intégrer dans son texte, au lieu d’en
faire des sortes de "copier coller" indigestes qui donnent
certes une impression d’encyclopédie, comme le souligne le
traducteur dans sa préface, mais au détriment de la narration,
comme des lectures régurgitées au fil de la plume.
Ce défaut vient sans
doute de l’influence des autres écrits de l’auteur, ses essais
de nature writing, marqués par une propension à toucher
indifféremment à tous les sujets et tous les genres. Ce qui peut
être valable dans un cas ne l’est pas forcément dans celui d’un
roman. L’excuse de la construction en rhizome n’est pas
suffisamment convaincante.
Difficultés de
traduction
Le roman est
intéressant au niveau de la traduction, qui représentait un
défi, au vu, justement, des ruptures de ton, des détails
historiques, mais aussi des particularités linguistiques
utilisées par l’auteur. Gwennaël Gaffric, le traducteur (3), en
explique la teneur dans son avant-propos : la majeure partie du
texte est écrit en chinois dit mandarin, mais, pour certains
dialogues, Wu Ming-yi a choisi d’utiliser le taïwanais (taiyu
臺語/台语
ou taigi en taïwanais).
Il s’agit d’une langue
sinitique dérivée du minnan (閩南語/闽南语),
c’est-à-dire ‘langue du sud de la rivière Min’ : langue des
immigrants venus du Fujian, est du Guangdong ou Hainan, elle est
encore parlée par quelque 60 % de la population après avoir été
interdite par le gouvernement nationaliste après la guerre. Dans
le roman, c’est la langue dans laquelle s’expriment les parents
du jeune
Saburō.
Bien qu’étant différente du chinois, elle est transcrite dans le
texte en caractères chinois traditionnels, comme le reste du
récit, mais se distingue à la lecture.
Cela posait un difficile problème de traduction : comment rendre
cette différence ?
Gwennaël Gaffric a opté
pour une langue française utilisant des transcriptions du créole
martiniquais. C’est une option, effectivement, mais reste un peu
artificiel dans le cours du texte. Il n’y a pas de solution
standard, et c’est une difficulté qui va se poser aussi de plus
en plus dans les traductions de textes de Chine continentale, au
fur et à mesure que renaissent les dialectes régionaux. On la
rencontre couramment déjà dans le sous-titrage de certains films
faisant usage, à des fins réalistes, de cantonais, shanghaïen ou
autres (4).
« Les lignes de
navigation du sommeil » incite certainement à attendre avec
impatience la traduction du second roman de
Wu
Ming-yi, « L’homme aux yeux à facettes »
(《複眼人》),
sur laquelle Gwennaël Gaffric est en train de travailler et qui
devrait paraître en 2014 chez Stock (5).
Notes
(1) Le maléfique Gong
Gong (共工)
ayant détruit dans un accès de colère la montagne Buzhou qui
soutenait le ciel (不周山),
celui-ci se mit à pencher dangereusement, ce qui causa sur terre
des inondations et de terribles souffrances pour les hommes.
Pour y mettre fin, la déesse Nüwa (女媧)
coupa les pattes de la tortue géante Ao (鳌)
et en fit quatre piliers pour soutenir le ciel.
(2) Guānyīn (观音)
ou Guānshìyīn
(观世音) :
celui/celle qui voit/observe les sons/plaintes du monde.
Le caractère
世
a disparu dans la
première moitié du septième siècle, sous l’empereur Taizong des
Tang (唐太宗
, règne 626-649),
parce que le nom personnel de l’empereur était Li Shimin (李世民),
donc le caractère 世
était
tabou.
On continue à dire
couramment Guanyin, bien que Wu Ming-yi utilise indifféremment
les deux. Avatar chinois d’Avalokitesvara, figure encore
essentiellement masculine sous les Song, Guanyin est devenue
féminine au douzième siècle et assimilée à une déesse.
(3) Doctorant de l’IETT,
l’Institut
d’études transtextuelles et transculturelles rattaché à la
Faculté des Langues
de l’université Jean
Moulin Lyon 3.
(4) C’est le cas,
aussi, des « Fleurs de Shanghai » (《海上花》)
de Hou
Hsiao-hsien dont les sous-titres ne marquent pas le passage du
shanghaïen au cantonais, pourtant significatif dans le film.
Voir
:
www.chinesemovies.com.fr/films_Hou_Hsiao_hsien_fleurs_de_Shanghai.htm
(5) La première
traduction n’ayant pas bénéficié de relectures suffisantes, elle
est sortie avec beaucoup de coquilles et erreurs de français. Il
n’est pas besoin de s’appesantir sur le sujet, on laisse souvent
des fautes même après de multiples relectures ; il suffit de
souligner que c’est un point sur lequel il faut être très
attentif au risque de desservir le travail de traduction, et,
partant, le roman lui-même.
|
|

