|
|
Brève histoire du
xiaoshuo
IX. Le xiaoshuo et
l’histoire
IX. 3 Langue
classique et langue vernaculaire dans l’histoire
par Brigitte
Duzan, 24 novembre 2025
L’écriture en
langue vernaculaire, distinguée de la langue classique (wenyan
文言), ne
date pas des débuts du 20e siècle avec l’avènement du
baihua (白话)
sous l’égide des réformistes de la fin des Qing puis des
intellectuels et écrivains du
mouvement du 4 mai (1919).
La langue vernaculaire s’est formée et a évolué peu à peu au
cours des siècles, pour s’épanouir dans les romans populaires
des Ming, avant d’être promue comme instrument de promotion de
la littérature et des idées auprès des couches populaires de la
population en facilitant leur lecture. On a fait de l’opposition
entre langue vernaculaire et langue classique un élément
symbolique du conflit entre ancien et nouveau, tradition et
modernité ; c’est aussi l’image de l’opposition entre culture
lettrée et culture populaire, avec en arrière-plan l’idée de
l’ « élégance » (yǎ
雅)
de l’une contre la « vulgarité » (sú
俗)
de l’autre.
La langue
vernaculaire s’est cependant développée parallèlement à la
langue classique, le vernaculaire se dégageant d’une langue plus
ou moins figée dans le temps pour se rapprocher de formes
vivantes d’expression en lien avec l’oralité, forcément
dialectale. Longtemps dépréciée, cette littérature est
aujourd’hui remise en valeur, dans sa forme autant que dans son
contenu, et dans son contexte historique.
A/ Langue
vernaculaire ancienne et langue classique
Les normes
fondamentales du chinois classique sont apparues pendant la
période des Printemps et Automnes, entre le 8e et le
5e siècle avant notre ère. Le wenyan est
devenu la langue du canon confucéen, celle des lettrés candidats
aux examens mandarinaux, acquérant ainsi un prestige incontesté
pendant quelque deux mille ans. La langue vernaculaire s’est
développée au fur et à mesure que cette langue classique se
distanciait de la langue orale qui, elle, évoluait, et cette
évolution contrastée a connu plusieurs étapes.
Dans sa
monumentale « Histoire de la langue chinoise » (《汉语史稿》)
initialement publiée en 1957, le linguiste chinois Wang Li (王力)
distingue trois périodes d’évolution de la langue chinoise avant
1919 : la période ancienne (shànggǔ qī
上古期), de
l’antiquité jusqu’au 3e siècle avant J.C., la période
« médiane »
(zhōnggǔ qī 中古期)
à partir du 4e et jusqu’au 12e siècle et
la période « moderne » (jìndài
近代) du
13e au 20e siècle, étant entendu que « jìndài »
en chinois désigne la période qui va de la guerre de l’opium au
mouvement du 4 mai, c’est-à-dire de 1840 à 1919, le 20e
siècle après 1919 étant la période « contemporaine » (xiàndài
现代).
| |
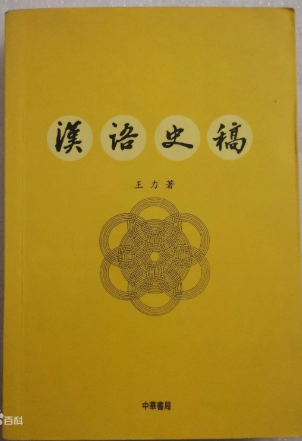
L’histoire de la langue chinoise de Wang Li (1957)
|
|
Plus
spécifiquement concernant l’évolution du vernaculaire, en
particulier au niveau lexical (que Wang Li aborde dans sa
dernière partie), c’est le philologue Xu Shiyi ( 徐時仪)
qui a écrit l’ouvrage le plus complet à ce jour : « Histoire du
développement du chinois vernaculaire » (《汉语白话发展史》),
publié aux éditions de l’université de Pékin en 2007, et réédité
en 2015 sous le titre « Histoire du chinois vernaculaire » (《汉语白话史》).
| |
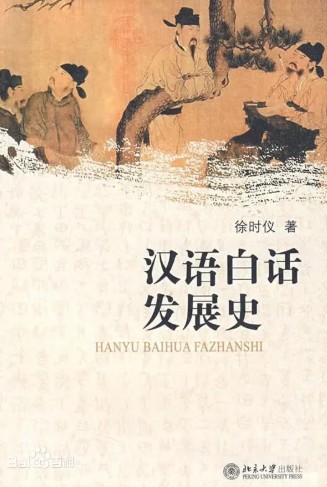
Histoire du développement
du
chinois vernaculaire, 2007 |
|
1.
Émergence de la langue vernaculaire
Selon cette
histoire, une première forme de vernaculaire, le vernaculaire
ancien (gǔ báihuà
古白话),
émerge vers le 4e-3e siècle avant J.C.
(période d’émergence ou lòutóu qī
露头期),
se développe sous les dynasties Qin et Han (秦汉的白话),
avec entre autres des collections de chants populaires, puis
sous les dynasties Wei, Jin et les dynasties du Nord et du Sud (魏晋南北朝的白话),
avec des traductions de textes bouddhiques (汉译佛经).
2.
Développement sous les Sui et les Tang
De cette
époque (隋唐的白话)
datent des recueils de poèmes en langue vernaculaire et des
histoires de type bianwen (变文)
ou « textes de transformation » ; ces bianwen sont des
récits bouddhiques, mais aussi laïques, dont un grand nombre a
été retrouvé à Dunhuang (敦煌变文).
Un premier recueil en huit volumes (《敦煌变文集》)
a été publié en 1957 aux éditions Littérature du peuple et a été
suivi de nombreux travaux de recherche ; des parties en prose
en langue vernaculaire y alternent avec des airs versifiés
destinés à être chantés, structure où l’on peut voir une origine
du théâtre chanté tel qu’il s’est développé sous les Yuan.
| |

Les
bianwen de Dunhuang, 2e édition,
1984. |
|
Cependant, les
chuanqi
(传奇)
typiques de la littérature des Tang, pourtant nourris de
légendes et superstitions populaires, sont écrits en langue
classique.
3.
Évolution pendant la période transitoire des Cinq Dynasties,
puis sous les Song et les Jin
Cette période
(五代宋金的白话)
voit émerger, à côté de la poésie, les
huaben
(话本)
et les pinghua (平话)
en langue populaire, issus de la tradition orale des conteurs et
précurseurs des romans en vernaculaire (话本小说).
Il faut aussi
noter l’importance non négligeable des yǔlù (語錄/语录)
qui se développent sous les Song : les transcriptions, par ses
disciples, de l’enseignement (oral) d’un maître, (néo)confucéen
ou bouddhiste, sur le modèle des Analectes
.
4.
Essor
sous les Yuan
La dynastie
mongole des Yuan (1279-1368) est la grande période du théâtre
zaju (杂剧)
et des
poèmes quci (曲辞).
Destinées à un public populaire, pour son divertissement (comme
le souligne le terme de zaju : pièces de variété), elles
étaient écrites en langue vulgaire, à l’exception des airs
chantés, par des lettrés privés d’examens impériaux
et d’emploi dans l’administration ; relégués au ban de la
société, ils ont trouvé une alternative dans l’écriture de ces
pièces, en devenant des professionnels du spectacle. Ces
dramaturges se retrouvaient avec d’autres auteurs de littérature
vernaculaire dans des associations d’écrivains ou shuhui
(書會/书会)
où ils côtoyaient également les acteurs ;
mais ils fréquentaient aussi les maisons de thé et autres lieux
populaires où se donnaient les pièces.
Les parties
écrites en vernaculaire ont longtemps posé des problèmes,
d’abord parce qu’elles étaient en dialecte du nord, donc d’un
abord difficile pour les locuteurs du sud, mais aussi parce que
l’on considérait qu’elles n’avaient pas la valeur littéraire des
airs chantés. Comme le souligne Isabella Falaschi dans son
introduction à sa traduction des « Trois pièces du théâtre des
Yuan » (p. LXXV)
,
lorsque, en 1731, le père de Prémare traduit la pièce du
dramaturge Ji Junxiang (紀君祥)
« L’Orphelin des Zhao » (Zhaoshi gu’er
《趙氏孤兒》),
il ne traduit que les parties en langue vernaculaire destinées à
être récitées, en omettant les airs versifiés destinés à être
chantés qu’il considérait comme trop difficiles pour être
traduits, en les remplaçant par la simple indication « il
chante » :
or, commente Isabella Falaschi, « ce sont justement ces parties
chantées … qui constituent l’ossature de la représentation
théâtrale et c’est là que réside la valeur littéraire d’un
livret. » Une édition d’époque Yuan retrouvée au début du 20e
siècle ne comporte, elle, que les parties chantées…
5.
Épanouissement sous les Ming et les Qing
La période
couvrant la fin des Ming et les premières années des Qing est
marquée par les
récits en baihua issus des huaben,
faisant du 17e siècle (entre les années 1620 et 1670)
un âge d’or du récit en vernaculaire. Précurseurs sont les
soixante récits des « Contes de la montagne sereine » (Qīngpíng
shāntáng huàběn《清平山堂话本》)
édités en 1550 par le graveur et bibliophile Hong Pian (洪楩),
ce qui constitue le plus ancien recueil connu de huaben
imprimé
.
Récits en
baihua
Les récits
populaires de
Feng Menglong (冯夢龙)
et de
Ling Mengchu (凌蒙初)
ont établi les normes de ces récits en baihua de la fin
des Ming, imités ensuite par des auteurs de moindre envergure –
Ling Mengchu, soit dit en passant, a aussi écrit des pièces de
théâtre dont il nous reste quatre pièces dans le style zaju,
dont l’une est adaptée du grand classique en
vernaculaire « Au
bord de l’eau ».
Il a inspiré un autre grand auteur de récits en vernaculaire :
Li Yu (李漁),
auteur entre autres de douze récits publiés en 1656, au tout
début de la dynastie des Qing, sous le titre « Théâtre
silencieux » (Wúshēng xì
《無聲戲》 /《无声戏》),
suivi d’un deuxième recueil de six récits publié sous le titre «
Jade précieux » (Liánchéng bì
《連城璧》) ,
puis d’une troisième recueil en 1658 intitulé « Les douze
tours » (Shí’èr
lóu《十二楼》).
Cette
littérature populaire, considérée comme vulgaire (tōngsú
wénxué “通俗文学”),
a fait fureur dans un contexte de troubles et d’atmosphère
fin-de-siècle qui explique également, au moins en partie, le
succès des grands romans populaires qui émaillent la période
Ming.
Romans
populaires
Les quatre
grands romans classiques qui datent de cette période sont écrits
en vernaculaire d’une grande richesse et ont contribué à
l’évolution de cette écriture. Sous les Ming, ce sont « Le
Roman des Trois Royaumes » (《三国演义》),
« Au
bord de l’eau » (Shuihuzhuan
《水浒传》)
et « La Pérégrination vers l’Ouest » (Xiyouji《西游记》),
tous trois fortement marqués par leur ancrage originel dans les
croyances populaires et la tradition des conteurs dont on
retrouve le panache et la verve.
Jin Shengtan (金圣叹),
en particulier, qui édité plusieurs romans dans les dernières
années des Ming et au tout début de la dynastie mandchoue, dont
une version tronquée du
Shuihuzhuan,
est généralement considéré comme un pionnier de la littérature
en vernaculaire. Il est resté dans les annales pour avoir établi
une liste iconique de « Six œuvres de génie » (六才子书)
où il mêle des œuvres en langue classique – le Zhuangzi (《庄子》),
le Li Sao (《离骚》)
de Qu Yuan (屈原),
les « Mémoires
historiques » (Shiji《史记》)
de Sima Qian (司马迁),
les poèmes de Du Fu (杜甫)
– et des œuvres populaires en langue vulgaire généralement
décriées par les lettrés : le Shuihuzhuan, en cinquième
position, suivi de l’ « Histoire du
pavillon de l’Ouest » (Xixiang ji《西厢记》),
pièce de théâtre zaju de Wang Shifu (王实甫)
– le tout édité en six volumes séparés, illustrés.
| |

Les
six œuvres de génie, édition 1668 |
|
Mais c’est au
« Rêve dans le pavillon rouge » (Hongloumeng
《红楼梦》),
plus tardif puisqu’il date du 18e siècle, que revient
l’influence déterminante pour l’évolution de la langue et le
statut du roman. Il a en effet été écrit dans un vernaculaire
très travaillé, fondé sur le dialecte de Pékin, dialecte devenu
par la suite la base du chinois moderne : les réformateurs du
début du 20e siècle, Hu Shi (胡适)
en tête, ont utilisé le roman pour promouvoir le baihua
tandis que les lexicographes en étudiaient le texte pour établir
les bases d’un nouveau vocabulaire standard pour la « langue
nationale » (le guoyu
国语).
Aux trois
classiques Ming, il faut cependant ajouter le
Jin Ping Mei
(《金瓶梅》)
ou « Fleur en fiole d’or », d’un certain « érudit railleur de
Lanling » (蘭陵笑笑生)
:
immergé, contrairement aux trois autres, dans la réalité d’un
monde sans héros où domine la soif du pouvoir et de l’argent
liée à celle du sexe, il verse dans le burlesque ou la
rhétorique bouddhique au gré de ses chapitres, et dans un esprit
satirique. Du point de vue de la langue, le roman abonde en
expressions dialectales, ce qui n’est pas le cas de l’autre
grand roman satirique (反讽小说)
en vernaculaire, qui date, lui, du 18e siècle :
« Chronique indiscrète des mandarins » (Rulin waishi
《儒林外史》)
de Wu Jingzi (吴敬梓)
– roman contemporain du Hongloumeng que l’on peut mettre
en parallèle avec « Au bord de l’eau » comme tableau d’une
société injuste et d’un pouvoir corrompu, même s’il s’agit
surtout d’une satire du monde des lettrés. Cependant, par sa
langue aussi bien que son contenu, c’est un roman proche des « romans
politiques » (政治小说)
appelés de ses vœux par
Liang Qichao
au début du 20e siècle, ou des « romans de
dénonciation » (谴责小说)
de
Li Boyuan (李伯元),
Wu Jianren (吴趼人)
ou
Zeng Pu (曾朴)
– romans qui s’appuient sur la langue vernaculaire.
| |
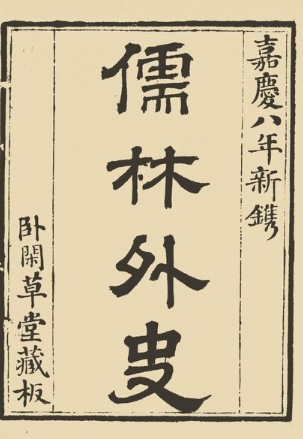
Rulin waishi,
1749 |
|
Xu Shiyi conclut son histoire par un huitième chapitre qui érige
cette évolution de la langue du wenyan vers le baihua
en « loi inexorable » (Wenbai zhuanbian de biran guilü
文白转变的必然规律).
Loi inexorable ?
Il faut noter ici que c’est le « mandarin » du Bas-Yangtsé (下江官话)
ou « mandarin Jianghuai » (江淮官话)
qui était la base du vernaculaire courant (celui utilisé dans
l’administration) jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le dialecte
de Pékin à la fin des Qing.
Dans la
pratique, les écrivains utilisaient la grammaire et le
vocabulaire du dialecte du Bas-Yangtsé mâtiné de dialecte de
Pékin pour faire en sorte que leurs écrits soient
compréhensibles de la majorité de leurs lecteurs, locuteurs des
dialectes les plus divers. C’est ainsi que s’est peu à peu créé
un chinois écrit standard qui a aussi incorporé des
constructions du chinois classique, baihua moderne qui a
repris le rôle unificateur qui était jusque-là le propre du
chinois classique, littéraire.
Il n’y a pas
de démarcation stricte entre les deux registres, le wenyan
influant sur l’écriture en vernaculaire, les mêmes auteurs
écrivant souvent et en langue classique et en langue vulgaire ;
ce sont les lettrés qui ont peaufiné la langue vernaculaire par
le biais de la fiction. En fait, le chinois classique s’est
longtemps maintenu, comme le latin en son temps en concurrence
avec le français, et dans le domaine des textes de lois en
particulier. Ainsi, le code législatif chinois a été écrit
jusque dans les années 1970 en chinois littéraire, bien que dans
une forme abondant en expressions et constructions modernes que
n’auraient pas reconnues les écrivains classiques.
Lorsque les
réformistes de la fin des Qing militent pour l’adoption du
baihua, ce n’est donc pas une langue totalement nouvelle
qu’ils appellent de leurs vœux, mais plutôt un vernaculaire
modernisé, répondant aux nécessités de l’heure en important des
néologismes de l’Occident, surtout par le biais du Japon.
B/
Émergence et développement du baihua moderne
Le baihua
(白话)
s’est défini en regard de la langue classique définie comme
langue littéraire et a désigné pendant longtemps les « langues
des localités » (fangyan 方言),
langues locales aussi diverses que souvent mutuellement
inintelligibles que l’on appelle aujourd’hui topolectes, ou
communément dialectes. La promotion du baihua à la fin du
19e siècle a eu lieu en même temps que celle du
guoyu (国语)
comme langue nationale, sous l’influence du néologisme japonais
kokugo (国語) désignant
la langue nationale, idéalement unifiée.
La promotion du
baihua représente donc une volonté politique et pratique
autant qu’intellectuelle et littéraire dans le contexte
nationaliste de la Chine de la fin des Qing
.
C’est une réforme de la langue fondée sur des oppositions
binaires : baihua / wenyan dans le domaine littéraire et
guoyu / fangyan dans le domaine plus spécifiquement
linguistique. Ce sont les journaux et revues qui, à partir des
années 1890, ont contribué au développement du baihua
dans leurs efforts pour toucher un plus vaste public, bien avant
les années 1910 qui voient son utilisation se généraliser peu à
peu.
1.
Le rôle
des journaux
a)
Les
précurseurs en baihua
Dans un
contexte d’effervescence et d’intense concurrence dans le
domaine de la presse, essentiellement à Shanghai, les
initiatives se multiplient pour répondre à une demande urbaine
en plein essor. Les périodiques sont encore très peu nombreux en
Chine en 1880 : une quinzaine. Mais l’expansion, ensuite, est
très rapide. Les années 1890-1920 sont marquées par véritable
révolution dans les techniques d’impression en particulier,
entraînant baisse des coûts et innovations éditoriales. Les
grands journaux que sont les deux principaux concurrents, le
Shenbao (《申報》)
et le Xinwen bao (《新闻报》),
fondés respectivement en 1872 et 1893 à Shanghai, publient leurs
articles en baihua. C’est le fondateur du Shenbao,
le britannique Ernest Major, qui est à l’origine de cette presse
en baihua : en 1876, pour toucher de nouveaux lecteurs,
un public populaire de femmes et de travailleurs incapable de
lire le chinois classique, il lance un supplément du Shenbao
en baihua, le Minbao (《民报》),
qui fait figure de précurseur. Les périodiques réformistes, eux,
sont éphémères, car vite interdits
.
Cependant, ce
journalisme en baihua s’est développé aussi de sources
plus spécifiquement chinoises dans le contexte du mouvement de
réforme de la fin des années 1890 : des journaux en dialectes
locaux, hors de Shanghai, la région du bas-Yangtsé - noyau de la
langue wu (吴语)
- faisant office d’épicentre. Le premier de ces journaux, le
Wuxi baihua bao (《無錫白話報》[无锡白话报])
est apparu en 1898, fondé par Qiu Tingliang (裘廷梁),
un recalé aux examens impériaux reconverti dans le journalisme ;
en dialecte local de la langue wu, le journal proclamait
son adhésion au baihua dès son titre. Pour son cinquième
numéro, il est rebaptisé « Journal chinois officiel en baihua »
(《中国官音白话报》),
publié tous les dix jours et distribué dans tout le pays. Il
publie des articles sur la Réforme, l’éducation des femmes, des
nouvelles étrangères et même des traductions de livres
occidentaux, dont des Fables d’Esope, à un moment où la
littérature pour enfants n’existait pas en Chine.
| |

Le
Wuxi baihua bao |
|
Le journal
cesse de paraître après l’échec de la Réforme, en septembre
1898, après 23 numéros, mais il fait des émules : une quinzaine
de journaux, quasiment tous rédigés dans des dialectes de wu,
apparaissent sur le même modèle dans les quelques années
suivantes, dont le trimestriel Hangzhou baihua bao (《杭州白话报》)
fondé en juin 1901 par un groupe incluant le traducteur
Lin Shu (林紓),
et le Suzhou baihua bao (《苏州白话报》)
lancé en octobre de la même année par l’éditeur, traducteur et
écrivain
Bao Tianxiao (包天笑),
fervent promoteur de la littérature populaire (tongsu wenxue 通俗文学).
Le Journal en langue vernaculaire de Pékin (Jinghua
bao《京話報》)
est lui aussi trimestriel, le premier numéro étant daté
septembre-décembre 1901, et le Journal en langue vulgaire de
l’Anhui (Anhui suhua bao 《安徽俗話報》)
est bimensuel, et édité par Chen Duxiu (陈独秀)
en 1904-1905. De 1876 à 1911, on compte ainsi 70 périodiques
en vernaculaire local.
Ces journaux
paraissaient pour la plupart avec des éditoriaux critiques du
genre lunshuo (论说),
orientés vers la défense d’une culture progressiste (contre
l’opium, la pratique des pieds bandés, les superstitions et
autres plaies de la société traditionnelle). En décembre 1903
est lancé à Shanghai le plus important de ces journaux en
vernaculaire, qui se distanciait dès son titre de toute
appartenance locale : le bimensuel Zhongguo baihua bao
(《中国白话报》).
C’était une publication ambitieuse et illustrée de quelque 80
pages, reliée comme un livre à l’occidentale, qui utilisait le
baihua comme arme de propagande révolutionnaire et
stratégie de diffusion auprès des masses populaires, fondée sur
les discours des révolutionnaires, donc sur l’oralité. Le
recours au baihua n’excluait d’ailleurs pas les articles
dans la langue classique la plus raffinée pour s’adresser aux
classes éduquées de la population.
| |
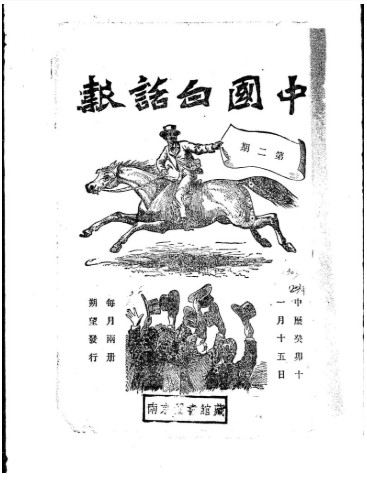
Le Zhongguo baihua bao (2e numéro) |
|
b)
Les
débuts de la presse féminine
Fondé par Qiu
Tingliang (裘廷梁)
et sa nièce Qiu Yufang (裘毓芳),
le Wuxi baihua bao est par ailleurs aussi le précurseur
de la presse féminine chinoise qui se développe au tout début du
20e siècle, sous l’influence du Japon
.
Lancé le 11 mai 1898, il disparaît en septembre au bout de 28
numéros, mais Qiu Yufang poursuit l’intention première de son
oncle qui était de créer une maison d’édition dédiée au
baihua (Baihua shuju
白話書局).
Elle traduit divers textes du wenyan en baihua,
dont le plus ancien ouvrage sur l’éducation des femmes, les
« Préceptes pour les femmes » (Nüjie
《女诫》)
de l’historienne et femme de lettres des Han
Ban Zhao (班昭),
et rédige une biographie en baihua de Mencius. Mais elle
propose aussi des traductions de livres sur la réforme de Pierre
le Grand en Russie et sur la réforme Meiji au Japon.
C’est de 1898
que date la naissance de la presse féminine, avec la création
par un groupe de femmes du premier périodique féminin, lancé le
24 juillet 1898, qui dure 12 numéros : le Nüxue bao
(《女學報》[女学报]),
littéralement le « journal d’études féminines». Parmi les
fondatrices figurent des personnalités comme Li Run (李閏/李闰),
épouse de Tan Sitong (譚嗣同)
et Li Huixian (李蕙仙),
épouse de Liang Qichao, tandis que Qiu Yufang faisait partie des
collaboratrices, ainsi que Kang Tongbi (康同璧),
fille de Kang Youwei. Dès le premier numéro, l’accent est mis
sur l’importance de la langue vernaculaire moderne, la langue
utilisée devant correspondre à la période de son emploi (古話合宜古人用,白話合宜今人用) ;
l’article se place résolument dans un contexte mondial, en
prenant pour modèle l’Europe et l’utilisation du latin délaissé
pour les « langues du terroir » (土语)
,
mais le baihua est ici revendiqué pour faciliter l’accès
des femmes à l’éducation.
Autre
pionnière du journalisme, et du féminisme, parmi le premier trio
de femmes à défendre le baihua au service de
l’émancipation des femmes :
Chen Xiefen (陳擷芬),
fondatrice en 1899, à l’âge de 16 ans, du Nübao (《女報》)
ou Journal des femmes, lancé comme supplément au journal de son
père Chen Fen (陳範) :
le Subao (《蘇報》[苏报])
ou Quotidien du Jiangsu, interdit en juin 1903. Le premier
Nübao disparaît vite ; en mars 1903, Chen Xiefen en fonde un
deuxième, expressément présenté comme la suite du premier, avec
un financement entièrement féminin et en reprenant le titre
Nüxue bao ; une cinquantaine de pages dont les rubriques
« Discours en baihua » (báihuà yǎnshuō
白話演說 [白话演说])
en défense non seulement du vernaculaire, mais aussi de
l’égalité hommes-femmes, ainsi que « Histoire récente du monde
des femmes » (女界近史),
le tout illustré de photos.
Chen Xiefen
était une amie proche de
Qiu Jin (秋瑾)
qui a elle-même lancé un journal expressément en baihua :
le Baihuabao (《白話報》),
dont le premier numéro sort en septembre 1904 et n’aura que six
numéros, mais qui met lui aussi l’accent sur le discours oral
comme le proclame un premier article de Qiu Jin dans le
journal : « Avantages du discours » (Yǎnshuō de hǎochù
« 演說的好處 »
[演说的好处]).
De manière significative, cependant, si le baihua est la
langue de référence, le journal publie également des poèmes qui,
eux, sont en langue classique. Le Baihuabao sera suivi du
Zhongguo nübao (《中國女報》[中国女报])
ou Journal des femmes de Chine, qui n’aura qu’un premier numéro
en janvier 1907, avant l’arrestation et l’exécution de Qiu Jin,
mais qui aura un grand impact sur le développement de la presse
féminine chinoise par la suite.
Il faut dire
que la question de la langue était particulièrement sensible
pour la presse féminine : comme le souligne Jacqueline Estran
dans l’article cité (n. 15), la proportion de femmes en état de
lire était alors en Chine entre 2 et 10 %, donc la langue écrite
proche de l’oral était plus adaptée pour développer leur
éducation, mais en même temps, c’est par leur maîtrise de la
langue classique (en particulier dans le domaine de la poésie)
que les femmes pouvaient, comme toujours, accéder aux cercles de
lettrés. Ces femmes des tout débuts du 20e siècle
sont en ce sens typiques d’une langue en pleine évolution, mais
reflétant un double ancrage dans l’écrit classique et dans la
langue parlée moderne, Qiu Jin en particulier se montrant
capable de s’adapter en fonction du public auquel elle
s’adressait.
c)
Effervescence et innovations
Cette
effervescence de la presse en baihua, de plus en plus
politisée à partir du tournant du 20e siècle, se
traduit par des innovations originales, en termes de formats, de
rubriques … et de langue. Témoins en sont le Zhongwai
ribao (《中外日報》)
ou Quotidien de Chine et de l’étranger, fondé en 1902, qui
imprime pour la première fois en recto-verso et fait appel à des
professionnels pour traduire les nouvelles étrangères, et
surtout le Shibao (《時報》)
ou Eastern Times fondé en 1904, toujours à Shanghai, par Di
Baoxian (狄葆賢).
Ancien élève
de Kang Youwei, Di Baoxian avait, après l’échec de la Réforme,
fui au Japon où il avait rencontré Liang Qichao qui l’avait
fortement influencé. Il s’entoure de rédacteurs prestigieux dont
Bao Tianxiao (包天笑)
recruté au Suzhou baihua bao qui apporte au journal son
intérêt pour la littérature populaire. Le Shibao remplace
les longues dissertations (lunshuo) des concurrents par
des articles courts et percutants, et inaugure des rubriques
spéciales de fiction en feuilleton. Le Shibao publie en
particulier les romans de type policier à la mode écrits par
l’écrivain et traducteur Chen
Jinghan (陳景韓/陈景韩)
sous son pseudonyme « Sang froid » (Lengxue
冷血) –
Chen Jinghan qui deviendra en septembre 1909 le responsable
éditorial du supplément mensuel Xiaoshuo shibao (《小说时报》)
ou Fiction Times, avant de passer au Shenbao.
En 1911, le
Shibao était devenu un concurrent direct des deux grands
rivaux, le Shenbao et le Xinwenbao. La concurrence
va se déplacer dans le domaine de l’image, avec le lancement de
suppléments illustrés. Mais c’est finalement le développement de
la fiction populaire sérialisée qui leur vaut leurs plus grands
succès et la littérale explosion de leurs tirages à partir de
1920.
| |

Le
Shibao, 12 juin 1912 |
|
La presse
chinoise du début du 20e siècle est ainsi le prélude
à la révolution littéraire qui se produit dans le cadre du
mouvement du 4 mai, sous l’égide de Chen Duxiu (陈独秀)
et de Hu Shi (胡适),
Hu Shi qui appelle en priorité à une révolution dans la langue.
Mais cette révolution s’inscrit dans un mouvement qui redéfinit
en même temps la notion d’opinion publique - de gonglun (公论)
à yulun (舆论)
- en opérant une transition vers le « peuple ordinaire » (yiban
renmin
一般人民),
auquel il convient de s’adresser dans une langue qui lui soit
compréhensible, et dans des formats attrayants.
2.
Le
baihua moderne
À partir
de 1919, la plupart des périodiques chinois délaissent la langue
classique pour adopter la langue parlée, en introduisant en même
temps des innovations significatives : un nouveau système de
ponctuation inspiré de l’étranger, une mise en page qui
substitue aux colonnes verticales des rangées horizontales,
ainsi que la séparation du texte en paragraphes pour en
faciliter la lecture. Et la littérature de fiction, populaire,
devient un formidable atout de vente.
Mais ce
baihua moderne n’est plus un vernaculaire calqué sur les
dialectes régionaux. C’est une langue réinventée et forgée peu à
peu par les grands intellectuels et écrivains du 4 mai, et qui
fait l’objet de recherches. Ainsi la Commercial Press de
Shanghai avait créé en 1910 le Xiaoshuo yuebao (《小说月报》)
ou Mensuel de la nouvelle, ou de la littérature de fiction.
C’était au départ, dans l’optique de la maison mère, une
entreprise essentiellement commerciale qui publiait des textes
sans grande valeur, pour le public populaire qui achetait ses
journaux. Or, fin 1920, est recruté un jeune journaliste de 24
ans du nom de Shen Dehong (沈德鸿)
qui écrivait sous le nom de plume de Yanbing (雁冰),
mais qui deviendra mondialement connu sous celui de
Mao Dun (茅盾).
Dans ses nouvelles fonctions de rédacteur en chef, il est chargé
de la nouvelle rubrique « Nouvelle vague de la littérature de
fiction » (xiǎoshuō xīncháo
小说新潮).
Le futur Mao
Dun y publie des textes en baihua des écrivains en pointe
du moment, sur le modèle de la revue « La Jeunesse » (《新青年》)
fondée en septembre 1915 à Shanghai par Chen Duxiu (陈独秀),
puis transférée à Pékin en janvier 1917.
| |
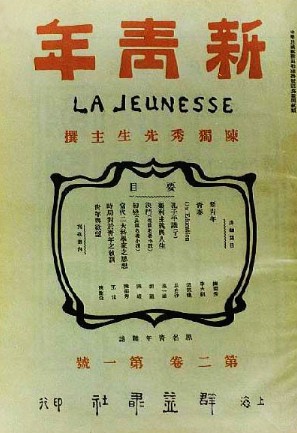
La
Jeunesse (2e numéro) |
|
C’était une
revue au tirage relativement limité, mais qui a exercé une
énorme influence sur l’évolution de la littérature par ses idées
réformistes, et en particulier par son incitation à abandonner
le chinois classique. Hu Shi, Chen Duxiu et quelques autres
publieront dans le journal quelques poèmes dans la langue qu’ils
préconisaient, mais qui était encore balbutiante. Invité par
Chen Duxiu, le linguiste Liu Bannong (刘半农)
leur apporte main forte dans les pages de la revue, publiant par
la suite un recueil de poèmes des débuts du baihua (《初期白话诗稿》).
Puis il part à Londres et à Paris. Diplômé de la Sorbonne en
1925 pour son travail expérimental de phonologie sur les tons du
chinois (《四声实验录》),
il dirige à son retour à Pékin un laboratoire de phonétique
expérimentale ; il publie en 1920 une étude pionnière sur les
manuscrits de Dunhuang (Dunhuang duosuo 《敦煌掇瑣》)
et en 1925 une étude sur « Les mouvements de la langue nationale
chinoise ». Il enseigne alors la littérature vernaculaire au
département des humanités et de la littérature nationale (wénkē
guówén mén
文科國文門)
de l’université de Pékin. En 1930, il publie une compilation de
caractères du langage vernaculaire utilisés sous les Song et les
Yuan (Songyuan yilai suzi pu
《宋元以來俗字譜》)
qui sera par la suite une référence pour la standardisation des
caractères simplifiés. Ses nombreuses traductions sont en
quelque sorte des travaux pratiques.
Pour la petite
histoire, c’est à Liu Bannong qu’est attribuée l’invention du
pronom féminin ta (她),
dans l’un de ses poèmes. L’usage en sera ensuite vulgarisé par
la chanson « Dites-moi comment cesser de penser à elle » (Jiao
wo ruhe bu xiang ta 教我如何不想她),
sur une mélodie du linguiste, poète et compositeur
sino-américain Yuen Ren Chao (趙元任) ;
spécialiste de phonologie chinoise, celui-ci a par ailleurs
enregistré en 1921, aux États-Unis, des modèles de prononciation
pour la Commission d’unification de la prononciation (读音统一会)
mise en place en 1913 par la République de Chine.
Jiao wo ruhe bu xiang ta
https://www.youtube.com/watch?v=EYPnciEpePk&t=53s
On
considère généralement que le premier récit marquant l’avènement
de la nouvelle littérature en baihua est « Le Journal
d’un fou » (《狂人日记》)
de
Lu Xun (鲁迅) publié
dans
« La Jeunesse » en mai 1918.
On mesure la
beauté du texte et de son impression (avec une ponctuation
discrète en marge), comparés aux suppléments littéraires des
grands journaux de l’époque.
| |
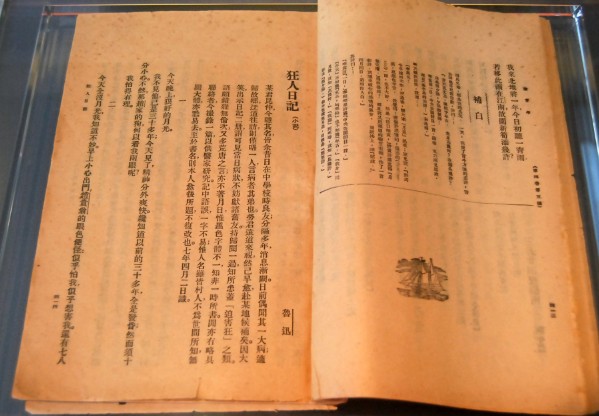
Le
journal d’un fou, « La Jeunesse », 15 mai 1918 |
|
Notons
cependant qu’il s’agit bien là d’une œuvre emblématique du
mouvement du 4 mai,
mais qui n’est pas véritablement la première : la première
nouvelle en baihua est en fait de la plume de la
pionnière
Chen Hengzhe (陈衡哲),
figure de proue du mouvement du 4 mai. Ayant rencontré Hu Shi à
l’université Cornell où elle étudiait la philosophie,
impressionnée par son article paru en janvier 1917 dans la revue
« La Jeunesse », « Suggestions pour une réforme de la
littérature » (《文学改良刍议》),
elle se met sans rien dire à écrire en baihua, des
poèmes, puis une courte nouvelle,
« Un jour » (《一日》),
qu’elle publie dans le trimestriel des étudiants de l’université
en juin 1917, soit près d’un an avant la publication du
« Journal d’un fou ». À son retour à Pékin, elle deviendra la
première femme à être professeure d’université en Chine et
publiera dans les principaux journaux du mouvement de la
Nouvelle Culture.
Pendant
longtemps, malgré tout, on écrira dans une langue à cheval entre
classique et vernaculaire, mi-wen mi-bai (bàn
bái bàn wén
半白半文).
Le baihua s’est imposé peu à peu grâce aux grands
écrivains qui l’ont fait évoluer,
Lu Xun (魯迅)
tout particulièrement. Mais même lui reviendra vers le chinois
classique à la fin de sa vie pour écrire des poèmes lyriques
avec un art consommé, et des emprunts aussi bien aux anciennes
élégies de Chu (Chuci《 楚辞》)
qu’aux poèmes de Li He (李贺)
ou de Li Shangyin (李商隐),
transposant en zeitgeist des années 1930 leurs sentiments
d’aliénation et leur réponse émotionnelle aux injustices et
vicissitudes du moment, les 8e et 9e
siècles
.
La langue classique garde toujours l’attrait d’une sorte de
pureté dans la concision.
Aujourd’hui,
cette histoire du baihua prend d’autant plus d’intérêt
que les jeunes écrivains et écrivaines ont tendance à revenir
vers leurs dialectes locaux pour écrire leurs nouvelles, en
émaillant leurs récits d’expressions dialectales vivantes et
colorées, et tout particulièrement ceux et celles de la région
de la langue de wu. C’est une nouvelle écriture qui se
profile, d’autant plus difficile à traduire.
À lire en
complément
Un article
comparatif sur les différents termes utilisés dans les registres
dits populaire (popular), lettré (learnèd),
familier (colloquial) et littéraire (literary), au-delà des
simples catégories wén
文et
bái
白,
sur la base du mandarin standard et du dialecte de Pékin, avec
quelques exemples secondaires empruntés aux dialectes Min :
Popular and learnèd in Chinese dialects,
Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 35, issue 2, April
2025.
Supprimés en 1237 dans le nord, en 1274 dans le sud,
jusqu’en 1314.
|
|

