|
|
La traduction pour le plaisir du
texte et de son partage, entre désir et frustration
Paris Cité,
Séminaire du CET,
7 avril 2025
par Brigitte
Duzan, 9 avril 2025
Au
cœur des humanités se situe la traduction.
Barbara Cassin
Il ne va pas
s’agir ici de théorie, mais de pratique, et en ce sens la
réflexion qui suit va tenir à la fois du plaidoyer pro domo
et de l’état des lieux :
-
plaidoyer pro domo, car partant de l’expérience,
personnelle et directe, de la traduction du chinois, mais pas
seulement,
-
et état
des lieux, car la traduction a son histoire et ses modes, les
traductions subissent un phénomène d’obsolescence, on ne traduit
pas aujourd’hui comme on traduisait hier, et pas seulement à
cause de l’évolution de la langue.
Il est par
ailleurs question ici de traduction littéraire, ce qui
est encore plus difficile à définir que le concept même de
traduction. Disons que la traduction littéraire suppose un texte
– dit texte-source - écrit dans une autre culture, bien plus
encore que dans une autre langue, un texte qui peut être de
fiction ou de non-fiction, mais surtout dont la caractéristique
essentielle est de posséder une qualité d’écriture. C’est
la beauté de cette écriture qu’il s’agit de rendre, avec toute
l’empathie que cela suppose. Quand on achète un livre, si c’est
une traduction, on aimerait que celle-ci nous dise au mieux
ce que l’auteur de l’original a écrit, comme il l’a écrit, en
son temps en son heure.
Ainsi posée,
en termes littéraires, la traduction est un travail d’écriture,
et un travail de création. D’où découlent un certain nombre de
joies, mais aussi de contraintes. À commencer par la pure
impossibilité de faire.
§
Traduire : impossibilité et nécessité
Je ne me sens
pas la personne la plus légitime pour parler de traduction, car
j’ai passé une partie de ma vie à apprendre des langues pour
pouvoir lire les textes dans l’original, sans avoir à passer par
une traduction. Et c’est en quelque sorte en désespoir de cause
que j’ai commencé à traduire, en désespoir de cause et par sens
du devoir.
Car traduire –
traduire des textes littéraires, donc - est
fondamentalement une impossibilité, et une impossibilité
radicale, comme écrire pour Marguerite Duras :
« Écrire. / Je
ne peux pas./ Personne ne peut.
Il faut le
dire : On ne peut pas.
Et on
écrit. »
Cette idée de
l’impossibilité radicale de traduire, comme d’écrire, a été
particulièrement mise en avant à partir de la première moitié du
19e siècle, avec le développement des théories sur la
dynamique des langues. Mais ces théoriciens étaient bien obligés
de reconnaître que, comme Duras écrivait, les traducteurs
traduisent… On est là devant un paradoxe qui ressemble à celui
de Zénon d’Élée, celui d’Achille et la tortue : Achille peut
bien courir plus vite que n’avance la tortue, il ne peut la
rattraper car il restera toujours un espace infinitésimal entre
eux. Nul besoin de recourir aux réfutations mathématiques du
paradoxe, qui commencent avec Descartes, il suffit d’une
réfutation pratique, par l’évidence, comme celle de Diogène le
Cynique : le simple fait d’aller plus vite que la tortue suffit.
Et les traducteurs traduisent.
Ce préjugé
d’impossibilité a priori de la traduction rappelle une
discussion sur la traduction, en 1734, à l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres. Discussion entre deux doctes
personnages, l’helléniste René Vatry et Nicolas Gédoyn,
« passionné pour les bons auteurs de l’Antiquité » qu’il s’est
appliqué à traduire, entre autres Quintilien et Pausanias,
traductions que Voltaire lui-même a louées. René Vatry a lancé
la discussion en s’élevant contre les traductions, en les
accusant de dévoyer les originaux, et d’en détourner les
lecteurs, la traduction apparaissant comme une désastreuse
solution de facilité.
À quoi Nicolas
Gédoyn, traducteur lui-même, a répliqué en invoquant le bon
sens, et en soutenant que « traduire un excellent original est
l’une des plus dignes occupations d’un homme de lettres et qu’en
cette qualité il ne peut guère rendre un plus grand service à la
Nation que de lui mettre sous les yeux en langue vulgaire ce que
l’Antiquité nous a laissé de plus précieux. » Ce Nicolas Gédoyn
a d’ailleurs laissé une apologie des traductions qui figure aux
côtés de traités divers, sur la vie urbaine des Romains ou la
querelle des Anciens et des Modernes – celle-ci n’étant
d’ailleurs pas étrangère à la querelle sur la traduction, par
les divergences de vue sur l’appréciation de l’héritage de
l’Antiquité.
On a là –
in a nutshell – une première approche qui amène à dépasser
l’idéal rigoureux du respect absolu de l’original : la
traduction est aussi l’art du compromis, ou de la négociation
comme préfère dire Umberto Ecco.
§
Traduire : art de la négociation
Art de la
négociation qu’Umberto Ecco a défini comme étant « dire
presque la même chose », tout tenant bien sûr dans le
presque. Presque que l’on peut définir aussi en
termes de tangente, la traduction étant ce qui tend vers…
C’est le grand
débat sur la fidélité au texte, qui a commencé très tôt, dès
l’Antiquité. Dans la seconde moitié du 17e siècle, le poète et
dramaturge anglais John Dryden, ayant perdu sous
Guillaume d’Orange son titre de Poète lauréat qui lui assurait
un revenu plus ou moins stable, se met sur le tard à la
traduction pour assurer ses fins de mois : il traduit en
particulier l’Énéide de Virgile, et dit tenter de faire parler
Virgile « avec les mots qu’il aurait probablement employés s’il
avait vécu la vie d’un Anglais ». Il fait briller ses
traductions comme il fait briller la poésie anglaise,
s’enthousiasme Samuel Johnson.
John Dryden a
fait également observer que « la traduction est une sorte de
dessin d’après nature », comparant ainsi le traducteur à un
artiste, comme Cicéron plusieurs siècles auparavant. Et c’est
justement Cicéron qui a lancé le débat sur l’art de traduire, la
traduction étant nécessaire pour la formation de base du bon
orateur.
Dans son cours traité sur la perfection de l’art oratoire « De
optimo genere oratorum », avant de présenter sa traduction
de deux adversaires politiques grecs, les orateurs athéniens
Eschine et Démosthène, il commence par rendre compte d’abord de
son propre travail de traducteur :
nec
converti ut interpres, sed ut orator,
je ne les ai pas traduits comme un interprète, mais comme un
orateur
sententiis isdem
par les mêmes significations
et earum formis tamquam figuris,
tant pour la forme que pour la structure
verbis ad nostram consuetudinem aptis.
par des mots conformes à nos habitudes
In quibus
non verbum pro verbo necesse habui reddere,
et en cela je n’ai pas eu à rendre un mot par un mot
sed_____genus omne verborum_____vimque servavi.
mais des mots j’ai conservé tout le caractère et la force
Ajoutant : Ce
que j’ai pensé qui importait au lecteur, ce n’est pas tant de
compter [les mots] mais plutôt de peser [mes mots].
C’est cette
idée que reprend, à la fin du 4e siècle, Jérôme de
Stridon, le futur Saint Jérôme, docteur de l’Église et patron
des traducteurs.
Saint Jérôme
écrivant, par Le Caravage
Il se réfère à
Cicéron dans sa « Lettre à Pammacchius » de 396
en une formule désormais célèbre :
…in interpretatione Graecorum,
non verbum e verbo, sed sensum exprimere de
sensu
dans mon
interprétation des Grecs,
je n’ai pas
traduit mot à mot, mais j’ai cherché à faire ressortir le sens.
Mais il fixait
aussitôt une limite à l’exercice, en tant que traducteur de la
Bible s’appuyant sur les écrits hébraïques, ce qui était nouveau
en son temps :
absque
Scripturis sanctis, ubi et verborum ordo mysterium est.
sauf pour les écritures saintes où l’ordre des mots participe du
mystère.
Cette question
du mot à mot opposé au sens pour le sens a alimenté des débats
sans fin. Mais ce que l’on oublie trop souvent, c’est la limite
posée par Saint-Jérôme, celle des textes sacrés. Il ouvre en
fait ici la possibilité de deux manières différentes de
traduire, en fonction du type de texte. Plutôt que le
problème du choix entre le mot et le sens qui est un faux
problème, il faut surtout retenir cette ouverture vers la
recherche d’un style adapté à l’original, un style qui
reflète celui de l’auteur traduit, et qui participe à la fois et
du mot et du sens.
Il faut dire
que, pendant longtemps, on a privilégié le confort de lecture,
en s’attachant à ne pas ennuyer, en expurgeant le texte au
besoin. La traduction a eu ses « belles infidèles ». Ce n’est
qu’au 19e siècle qu’il est demandé aux traducteurs
d’être « fidèles » au texte original et de respecter son style.
Mais là encore, il s’agit d‘une théorie, la théorie de la
traduction « transparente » du philosophe allemand Friedrich
Schleiermacher, figure majeure du romantisme allemand qui
privilégiait les traductions qui amènent le lecteur vers
l’auteur, en leur faisant sentir tout ce que le texte source
peut avoir d’étranger, sinon d’étrange. Conception qui inspirera
les grands théoriciens du siècle suivant, dont Antoine Berman,
et influencera des grands traducteurs étrangers, dont le Chinois
Yan Fu (严复).
Yan Fu était
un réformiste, traducteur vers le chinois d’ouvrages de sciences
sociales de Thomas Huxley, Adam Smith, John Stuart Mill, Herbert
Spencer … et de « L’esprit des lois » de Montesquieu : pour lui,
la traduction devait donc avant tout être accessible, dans une
langue recherchée, et aussi précise que possible, dans le
respect de l’esprit du texte. En forgeant des termes spécifiques
au besoin quand le chinois ne possédait pas même l’idée de ce
qu’il s’agissait de traduire. C’est resté un idéal de traduction
en chinois.
On est ici
cependant dans un cas de figure analogue à celui de Saint Jérôme
traduisant les écritures saintes, en partageant avec Nicolas
Gédoyn l’idéal de service à la nation. La traduction littéraire,
quant à elle, est autre ; elle demande non tant le respect de
la lettre, comme pour un texte saint, que le rendu de sa beauté
dans toute sa pureté, comme pour un poème. Chaque texte
littéraire est unique, original et fragile. Ce qui importe dans
sa traduction est la recherche du style, du ton et du rythme qui
puissent s’en rapprocher à une langue, une culture de distance,
une langue, une culture de différence. La traduction littéraire
est affaire d’écriture.
§
Traduire : art de l’écriture
Affaire
d’écriture, certes, mais écriture seconde, en quelque sorte, car
le traducteur est face à un texte, et tous les textes sont
différents. Il n’y a pas de formule magique, unique. Il faut
s’adapter. Mais il y a des stratégies et des règles à adopter,
et d’abord pour surmonter au mieux les différences de culture
tout autant que de langue. Ceci est fondamental quand on traduit
du chinois en français, mais n’est pas unique. Et surtout cela a
évolué dans le temps.
Rendre
la beauté de la langue
Les meilleures
traductions sont l’œuvre d’écrivains, en symbiose avec le texte
original et son auteur. Bien sûr, il vaut mieux éviter les
contresens, mais pour cela il y a la solution idéale de la
cotraduction. C’est en outre une expérience enrichissante de
travailler à deux sur un texte, l’un ou l’une des deux
l’abordant dans sa langue maternelle, ce qui permet de faire
ressortir les connotations, les allusions subtiles qu’il
comporte. Très souvent, ce qu’il est difficile de traduire, ce
n’est pas ce qui est dit, mais ce qui ne l’est pas.
En dernier
ressort, cependant, c’est la beauté de la langue cible qui est
déterminante, non tant pour juger que pour sentir, à travers la
traduction, la beauté du texte initial. Ce n’est pas pour rien
que certains traducteurs font corps pour ainsi dire avec les
auteurs qu’ils ont traduits. Et d’ailleurs au sens propre bien
souvent, la traduction s’imposant comme impératif urgent dans
des tournants de l’existence, avant d’être définitivement
emporté comme le seront les traducteurs de Kafka : par la
maladie pour Borges, un saut dans le vide pour Levi, un plongeon
dans la Seine pour Celan, les camps pour Milena, une balle dans
la nuque pour Schulz… La traduction tient souvent de l’impératif
vital. Et les meilleures traductions sont faites dans ces
conditions.
En même temps,
la traduction requiert la plus grande discrétion : on ne doit
pas faire d’ombre à l’écrivain qu’on traduit, on est là pour le
servir. Mais on y parvient mieux quand on est fidèle à la fois à
l’auteur et à soi-même. Un traduction est une rencontre, et
chaque rencontre est singulière. Il s’agit d’exhumer la beauté
de la langue d’origine, tout en étant conscient des
limitations : le rapport du contenu à la langue est totalement
différent dans l’original et dans la traduction. Comme le dit
Walter Benjamin dans « La tâche du traducteur » : « Si contenu
et langue dans l’original forment une certaine unité comme le
fruit et la peau, la langue de la traduction enveloppe son
contenu comme un manteau de roi avec de larges plis ».
La traduction,
en ce sens, a pour tâche essentielle de trouver, et de traduire,
l’intention initiale, celle, toujours selon Benjamin, « à
partir de laquelle l’écho de l’original peut être éveillé » dans
la langue du traducteur. La traduction invoque l’original pour
saisir cet « écho » qui va permettre d’entrer en résonance avec
l’œuvre originale. Avec pour conséquence que la traduction n’est
jamais qu’une intention dérivée. La fameuse « fidélité »
au texte implique ainsi liberté dans la restitution du
sens. La fidélité au mot ne peut pas à elle seule restituer
entièrement le sens perçu dans l’original. On a dit que les mots
portent avec eux une tonalité sentimentale, et c’est d’autant
plus vrai des caractères chinois. La littéralité en matière de
syntaxe – surtout dans une langue qui n’en a pas à l’origine,
qui ne possède qu’un ersatz de syntaxe fabriqué de toute pièce
sur le modèle occidental – cette littéralité syntaxique ne fait
que rendre plus difficile la restitution du sens.
Le traducteur
ne doit pas restituer l’original dans sa langue
d’origine, il doit inventer une langue qui sera la langue
originale de la traduction, avec sa propre intention, en
symbiose avec le texte original, dans son rythme et sa tonalité.
C’est là que la liberté vient soutenir la fidélité, et non
s’opposer à elle. Avec tout ce qu’une langue a d’incommunicable.
C’est en ce sens aussi que la liberté est l’art de la tangente.
Ce qui
implique aussi une grande fragilité car toute traduction – par
un traducteur dans son époque - est faite à un moment de
l’histoire, dans un contexte spatio-temporel et culturel
déterminé. Mais c’est aussi de la sorte que les traductions
participent à la vie d’une œuvre, à sa survie, à son histoire.
Dans la
pratique : la traduction au quotidien
o
Traduire de l’original
Il faut
commencer par poser un principe de base qui semble évident, mais
qui ne l’est pas toujours : on traduit de l’original. La
traduction est une interprétation, une recherche tangentielle du
paradis perdu qu’est le texte original. En tant que telle, elle
relève de l’intraduisible le plus fondamental. Il suffit de
faire subir au texte final le test de la retraduction dans la
langue originale, et on se rend compte alors de la divergence à
laquelle on a abouti. Il y a de cela un exemple qui fait mes
délices. Il s’agit de la traduction du Don Quichotte de
Cervantes par l’un des plus célèbres traducteurs chinois de la
fin du 19e siècle.
Ce traducteur,
Lin Shu (林紓),
premier traducteur chinois, entre autres, de Dickens, de
Shakespeare, de Victor Hugo et de Dumas fils, est l’auteur
d’environ 180 traductions en chinois d’œuvres occidentales alors
qu’il ne connaissait aucune langue étrangère : il se faisait
raconter oralement les œuvres et il transcrivait l’histoire
qu’on lui racontait dans un superbe chinois classique. C’était
un grand lettré, qui a été redécouvert au milieu du 20e
siècle et défendu pour la beauté de sa prose ; c’est grâce à son
style qu’il a contribué à faire connaître le roman occidental en
Chine, et en même temps à donner des lettres de noblesse au
genre romanesque qui était méprisé par les lettrés chinois. Même
le grand traducteur et sinologue britannique Arthur Waley a
défendu son style, en disant que sous sa plume Dickens est un
bien meilleur écrivain…
Traduire une
première traduction dans une autre langue, c’est ce qu’on
appelle une traduction-relais, et ces traductions ne sont pas
rares dans la littérature moderne, elles ont même été utiles car
elles ont longtemps permis d’avoir des traductions de langues
rares en un temps où il n’y avait pas de traducteurs capables de
traduire de l’original. Le jeune Isaac Bashevic Singer a ainsi
traduit Knut Hamsun, Romain Rolland et Gabriele d’Annunzio en
yiddish sans connaître le norvégien, le français ou l’italien :
il est parti des traductions en allemand qu’il a pu trouver en
Pologne avant la guerre. On a de très beaux exemples de la
sorte, qui sont des cas d’école. Mais avec parfois des
surprises, comme l’a montré l’histoire du Don Quichotte de Lin
Shu.
Sous sa plume,
le titre est devenu l’« Histoire du chevalier enchanté » (《魔侠传》),
titre très astucieux qui évoque aussitôt, pour le lecteur
chinois, à la fois un chuanqi (传奇),
dans la grande tradition du fantastique chinois, et un roman de wuxia (武侠小说),
c’est-à-dire un roman de chevalerie à la chinoise. En fait, Lin
Shu est parti d’une traduction en anglais datant de 1885. Son
assistant, Chen Jialin (陈家麟),
avait fait des études universitaires en Angleterre et semblait
donc compétent pour lire l’histoire à Lin Shu. Mais il a en fait
inventé des dialogues et raccourci le texte de plusieurs
chapitres, dont le prologue.
Il faut dire
que le roman de Cervantes rapporte les tribulations d’un vieil
homme passionné de romans chevaleresques, et qu’il était censé
être la traduction d’un texte écrit en arabe attribué par
Cervantès à un historien musulman, stratagème devenu courant
bien avant Cervantes. Il y avait donc, en un sens, une certaine
logique pour le traducteur chinois à traduire ce roman à partir
d’une version traduite en anglais de la version espagnole de
1605 qui était censée être une traduction de l’arabe. Or, en
2021, pour le 100e anniversaire de la publication de
la traduction de Lin Shu qui venait d’être redécouverte, le
texte chinois a été retraduit et publié en espagnol, aussi
littéralement que possible, à commencer par le titre :
« Historia del Caballero Encantado ». On découvre un Don
Quichotte rebaptisé Quisada, devenu un maître éclairé au lieu
d’être un pauvre hère un peu fou qui prend ses fantasmes pour
des réalités. Il est instruit et cultive les traditions comme
tout lettré chinois qui se respecte. Dulcinée s’est muée une
charmante jeune femme nommée Dame de Jade. Même Rossinante est
devenu un fringant coursier. En fait, ce n’est pas Quisada qui
est fou, c’est le monde autour de lui, et cette pagaille
ambiante est bien chinoise, même Dieu en a disparu.
Mais
l’histoire ne s’arrête pas là car la maison d’édition qui avait
publié la traduction de Lin Shu en 1922, la Commercial Press de
Shanghai, a le projet d’en faire une édition bilingue ! La
traduction acquiert dans ces conditions une signification
historique, en devenant un reflet de cultures croisées et
d’époques différentes. Don Quichotte alias Quisada est ainsi
entré dans l’histoire des traductions et on pourrait faire subir
le même sort à « La Dame aux Camélias » (《茶花女》),
par exemple… « La Dame aux Camélias » qui se trouve aux origines
du théâtre parlé chinois, le huaju (话剧),
avec une première représentation de la pièce adaptée du roman
par Dumas et traduite en chinois, par des étudiants chinois à
Tokyo, en 1907, les deux rôles étant interprétés dans la grande
tradition tant japonaise que chinoise, par des hommes.
On pourrait
dire : c’est une autre époque… Pas vraiment, même en s’en tenant
au chinois. Et pour des raisons bien pratiques : une traduction
coûte cher, et il est bien plus rentable pour un éditeur de
faire traduire de l’anglais que du chinois. On a vu fleurir
quelques traductions de ce genre en France il y a quelques
années, sous la pression des agents étrangers. Avec des
résultats qui ne sont pas aussi drôles que l’histoire du Don
Quichotte, mais qui sont de la même eau. Par exemple la
traduction d’un roman de l’écrivaine
Hong Ying (虹影).
C’est une
écrivaine qui n’est pas inintéressante : elle n’en finit pas de
revenir sur son enfance et sa vie ; trois de ses romans ont été
traduits en français et publiés au Seuil entre 1997 et 2003.
Mais il en est un quatrième, chez un autre éditeur, dont la
traduction date de 2009, et qui n’est pas, ou plus,
répertoriée : celui-là a été traduit de l’anglais, par une
traductrice britannique ne connaissant rien à la Chine. Le roman
se passe à Chongqing, la ville natale de Hong Ying, mais, faute
de mieux, la traductrice a gardé les noms des rues traduites en
anglais, on se croirait ainsi en Angleterre, ou dans la Shanghai
coloniale de Zhang Ailing alias Eileen Chang. Et parfois on
peine à comprendre, comme la traductrice elle-même : « la
voiture franchit le pont élargi du Yangtsé et s’engagea dans
Nanbin Road. », c’est la nuit : « nous descendîmes de voiture et
dans le noir commençâmes à gravir la pente abrupte. Nous étions
en pleine zone. » Quelle zone ? nous n’en saurons rien car
« aucun réverbère ne dissipait l’obscurité. » Un peu plus loin,
on nous présente un homme qui habite « Middle School Street »,
et on nous dépeint la ville vue d’une de ses fenêtres : « on
entrapercevait les bacs qui traversaient le Yangtsé à Turtle
Rock et à Marble Rock » - on est là soudain quelque part dans la
baie de Hong Kong. Je passe sur les noms des personnages. On
finit par rire, et refermer le livre qui est depuis lors passé
aux oubliettes, mais reste un témoin de l’histoire.
La traduction
de l’original est d’autant plus nécessaire quand il s’agit de
poèmes, et dans ce cas, il est souhaitable, en outre, d’avoir
une édition bilingue. Tout poème chinois est par nature même
bourré d’ambiguïtés qui en font toute la richesse. En
traduisant, le traducteur lève ces ambiguïtés, il fait des
choix, il interprète. Si on traduit de l’anglais, on fait comme
Lin Shu. On pourrait croire qu’aujourd’hui c’est là chose
entendue. Mais on est étonné de voir un excellent traducteur de
littérature russe produire une traduction de poèmes chinois, en
se fondant non sur une traduction en anglais, mais sur
plusieurs, en choisissant ce qu’il trouvait de plus beau,
dit-il. C’est appliquer à la traduction les règles de calcul
d’une moyenne pondérée. On balaierait cela d’un revers de manche
s’il s’agissait d’une appli d’intelligence artificielle, mais on
a là un travail de traducteur chevronné…
La littérature
chinoise déchaîne des passions, et des tentations de traduction.
Ce n’est pas toujours inintéressant, mais pas pour le texte
lui-même. Par exemple, on a des dizaines de traductions du
Laozi, qui toutes sont différentes, forcément, c’est l’un
des textes les plus ésotériques, et intraduisibles, de la pensée
chinoise. La seule solution est de le publier en bilingue, avec
explications et commentaires en bas de page, comme dans la
collection des Budé chinois des Belles Lettres. Car chaque
« traduction » des classiques est en fait une interprétation qui
demande clarification, le commentaire étant, dans la tradition
chinoise, partie prenante du texte que l’on ne peut comprendre
autrement. Mais, dans ce contexte, une « traduction » est
révélatrice de la personnalité d’un écrivain, et valable en tant
que telle. C’est le cas, par exemple, du Laozi d’Ursula
le Guin, publié comme « English version » et non comme
« translation ». Ursula le Guin que l’on connaît comme auteure
de science-fiction, mais qui est bien plus que cela, son
Laozi, justement, en témoigne.
o
Importance des notes en bas de page
Ces exemples
de traductions montrent l’importance des commentaires et des
notes en bas de page. Là encore on a l’impression en disant cela
d’enfoncer des portes ouvertes, mais pas du tout : beaucoup
d’éditeurs sont encore aujourd’hui indéfectiblement opposés à la
note en bas de page. Opposition qui tient d’un certain nombre de
préjugés vivaces contre lesquels il est très difficile de
lutter. Et pourtant, on n’est plus au Moyen Âge, je veux dire au
Moyen Âge de la traduction et de son édition. Tout
particulièrement pour ce qui concerne la littérature chinoise,
la note en bas de page relève souvent de la nécessité, par une
espèce de compassion envers le lecteur, pour qu’il ne se sente
pas totalement perdu, et qu’il n’entraîne pas dans son errance
désespérée tout le roman avec lui.
On constate
nettement ce bien-fondé dans les réactions des lecteurs et
lectrices en club de lecture. Celui de littérature chinoise
(CLLC), mais d’autres aussi bien. Il suffit de lire les comptes
rendus de séances pour s’en persuader. L’une des dernières
séances du CLLC, par exemple, était consacrée aux « Notes
diverses sur la capitale de l'Ouest » (《西京雜記》)
de Liu Xin (刘歆),
grand lettré de l’époque des Han : texte et traduction en
regard, nourris de notes et commentaires en bas de page. La
réaction a été unanime, pour saluer non seulement les notes mais
aussi l’introduction et la postface. On va me dire : bien sûr,
mais il s’agit d’un texte ancien, particulièrement difficile…
Oui, c’est peut-être un cas extrême, mais la démonstration vaut
pour bien d’autres traductions. On ne peut pas présumer que le
lecteur français comprendra entre les lignes ne serait-ce que
les références historiques qui sont évidentes à un lecteur
chinois ordinaire, sans parler des références littéraires. Il
faut l’ expliquer. Le défaut de notes explicatives ruine un
roman traduit.
On se demande
parfois comment il peut se faire qu’un roman formidable n’ait
aucun succès. C’est l’étonnement que l’on trouve exprimé dans le
« Routledge Companion to Yan Lianke » –
Yan Lianke (阎连科)
étant l’un des plus grands écrivains chinois contemporains, dont
la majorité des romans ont été traduits en français, par deux
excellentes traductrices, là n’est pas le problème. La dernière
partie de ce « Routledge Companion » est consacrée à la
traduction et la réception des œuvres de Yan Lianke dans
différents pays ; il comporte un chapitre sur la réception en
France, et l’auteure de ce chapitre s’étonne du peu de succès
qu’a eu le roman
Les quatre livres (《四书》),
en cherchant des explications du côté de la communication et de
la promotion du livre. Il aurait fallu commencer par voir
comment la traduction a été éditée, par un éditeur certes
remarquable par la qualité des traductions à son catalogue, mais
viscéralement opposé aux notes en bas de page. « Les quatre
livres » est paru dans une traduction brute, sans aucun appareil
critique. Or c’est l’un des romans les plus complexes de Yan
Lianke. Il a été au programme de l’agrégation pendant deux ans,
et on n’en a pas fait le tour. Ce n’est pas tant qu’il ne peut
être compris du lecteur moyen, non prévenu, il le déroute et le
rebute très vite quand il n’a pas un minimum de références.
Il s’agit là
d’un cas extrême, mais les exemples de ce genre abondent.
Parfois, le traducteur, pour faire plaisir à l’éditeur, intègre
la note qu’il sent nécessaire dans le corps du texte. Et c’est
peut-être pire car on aboutit à un texte hybride qui explique
comme en aparté, entre parenthèses ou entre crochets quand une
note s’imposait, tout simplement par respect du texte.
o
Inquiéter le lecteur en soignant le style
Il faut
expliquer, mais pas trop malgré tout. Il faut privilégier le
désir premier de rendre la beauté du texte, dans le style de
l’auteur. Surtout quand il est original et reflète une recherche
personnelle. Il faut oublier son français et le mettre à l’école
du style de l’auteur, dans toute son étrangeté. Dans sa
« Poétique du traduire », Henri Meschonnic engage le traducteur
à se libérer des préceptes obsolètes de transparence et de
fidélité de la tradition : « l’équivalence recherchée, dit-il,
ne se pose plus de langue à langue, en essayant de faire oublier
les différences linguistiques, culturelles et historiques, mais
de texte à texte, en travaillant au contraire à montrer
l’altérité linguistique, culturelle et historique, comme une
spécificité. » Il ajoute : un passeur, le traducteur ? Certes.
Mais ce qui importe n’est pas de faire passer, mais « dans quel
état arrive ce qu’on a fait passer ». Passer de l’autre côté,
dans l’autre langue : tra-ducere.
Les
traductions de Marguerite Duras en chinois en fournissent des
exemples. Très souvent, le texte est traduit dans un beau
chinois classique, un peu dans la tradition de Yan Fu, sans
beaucoup d’égard pour le style particulier de Duras. Or un texte
de Duras vaut d’abord par son écriture. Et cela ne vaut pas
uniquement pour les traductions en chinois. Dans un ouvrage
récent sur l’écriture de Duras, « L’écriture désirante »,
la dernière partie est justement consacrée aux traductions, et
deux chapitres sont des critiques de traductions en italien et
en hongrois, pour les mêmes raisons.
Tout dépend
évidemment de ce qu’on traduit. Mais si on traduit un texte
littéraire bien écrit, il faut pouvoir en rendre le style, même
si les langues sont très différentes, à commencer par le
rythme, au moins, et peut-être surtout. Il est frappant de
voir Rémi Mathieu, présentant et commentant sa traduction
récente du plus ancien recueil de poésie chinoise, le Shijing,
insister d’abord sur le rythme. Ce qui vaut pour la poésie
ancienne vaut pour la littérature moderne et contemporaine. Au
début des « Quatre livres » de Yan Lianke, par exemple, le texte
est calqué sur la Genèse, dans un chinois au rythme syncopé,
très bref, qui n’est pas rendu dans la traduction de Sylvie
Gentil, très belle par ailleurs car elle l’a travaillée avec Yan
Lianke lui-même ; mais elle avait peur, m’a-t-elle dit, que le
lecteur français ne suive pas et qu’on lui reproche un style
trop haché, elle a donc introduit des liaisons pour rendre le
texte fluide. Heureusement, c’était une excellente traductrice
et elle ne l’a fait que de manière modérée. Mais c’est dire
comme il est dur de lutter contre la tradition de « la belle
traduction ». Au détriment du texte.
En fait, cette
tradition que Meschonnic appelle « effaçante » est une
manifestation de la permanence du mythe de Babel :
inconsciemment, il s’agit d’effacer la diversité des langues,
leur différence, comme un mal fondamental. Mais c’est justement
la mauvaise traduction qui efface. La traduction qui ne
s’intéresse qu’au contenu, comme Lin Shu en son temps, sans voir
l’importance de la forme dans laquelle il est exprimé. Et ce
sont justement les belles traductions du passé, celles qui ont
rendu le style avec soin, qui sont restées mémorables, alors que
les traductions, par principe et définition, souffrent d’un
phénomène d’obsolescence : éternels sont ces véritables
monuments que sont les traductions en français du Shuihuzhuan
(《水浒传》),
« Au bord de l’eau », par
Jacques Dars,
ou celle du Liaozhai
zhiyi (《聊斋志异》)
ou « Chroniques de l’étrange » par
André Lévy.
§
Traduire : entre frustration et plaisir
C’est d’abord
une frustration, que traduire, et même une somme
de frustrations, parce qu’une traduction n’est jamais parfaite,
n’est jamais terminée. L’intraduisible, ce n’est pas ce qu’on ne
traduit pas parce qu’on ne peut pas, c’est ce qu’on ne cesse pas
de (re)traduire. La richesse d’un texte est aussi la richesse de
ses traductions. Humboldt disait qu’on en apprend plus sur une
œuvre avec plusieurs traductions qu’avec une. Mais là réside la
plus grande frustration pour le traducteur : celle de n’en avoir
jamais fini.
Frustration
aussi parce qu’il y a tellement de textes formidables que l’on
aimerait traduire mais dont il faudra abandonner tout espoir de
le faire, et de trouver un éditeur pour le publier. Surtout
quand ce sont des nouvelles, car il est une autre idée
préconçue, plus dramatique que celle des notes en bas de page,
c’est l’idée que 1/ Le lecteur n’aime pas les nouvelles, et 2/
Les nouvelles, ça ne se vend pas. Idée dont on voit bien
l’inanité en club de lecture : oui, il y a des lectrices et des
lecteurs qui préfèrent lire des romans, mais quand on leur donne
à lire de belles nouvelles, leur préférence va aux nouvelles
plutôt qu’à un roman assommant ou insipide. Or la nouvelle est
le fondement de la littérature chinoise, et de la meilleure qui
plus est, en particulier aujourd’hui. Il y a là un vide
insondable à combler en traduction française.
Fort
heureusement il y a le plaisir. Et il commence par
le plaisir de la découverte, la joie de la lecture. Plaisir qui
est justement ce qu’on va essayer de transmettre au lecteur.
Avec quelque chose du conteur dans cette approche. L’art de la
traduction, c’est un peu celui du conteur, dans le choix du mot
juste, de la phrase qui sonne bien et au bout du compte de
l’histoire qui va captiver l’auditoire. Et d’ailleurs la
traduction doit aussi soigner sa part d’oralité : elle doit
passer le test de l’oral. C’est une chose que m’a apprise Noël
Dutrait, le traducteur avec son épouse Liliane, de romans et
nouvelles de
Gao Xingjian (高行健),
à commencer, en 1995, par « La montagne de l’âme » (《灵山》).
Roman qui est bien plus beau en français que dans sa version
originale, ce qui a largement contribué à l’obtention du prix
Nobel par son auteur. Et justement, m’a expliqué Noël Dutrait,
quand ils sont arrivés au bout de la traduction, ils sont tous
les deux allés prendre un mois de repos en montagne, et là, ils
ont déclamé la traduction au cœur de la nuit, en la peaufinant
pour qu’elle sonne bien. On devrait toujours faire subir ce test
à nos traductions. Ou au moins les dire à haute voix dans sa
tête, comme des poèmes.
Et plaisir
enfin dans le sentiment d’appartenir à une histoire, et à une
communauté. Communauté virtuelle de traductrices qui
apparaissent sous leur propre nom à partir du 16e
siècle : la première traductrice à signer de son nom est une
Anglaise, Margaret Tyler, qui traduisait de l’espagnol, et qui a
traduit un roman, non un texte religieux, et en plus un roman de
chevalerie, véritable indécence pour une femme – elle s’est
élevée contre ses critiques dans sa préface en demandant
qu’hommes et femmes soient traités en être rationnels, sur un
pied d’égalité. Car les traductrice sont très souvent des
féministes, par la force des choses. Il y a toute une histoire
non pas de la traduction mais des traductrices, qu’on a commencé
à faire, et qui vaut d’être poursuivie.
Les
traductrices, d’ailleurs, peuvent aussi être personnages de
romans, et emblématiques en tant que telles, comme cette
« Unnecessary Woman » d’un auteur libanais d’aujourd’hui, Rabih
Alameddine : cette femme vit dans une époque troublée, comme on
dit en Chine, la guerre est à sa porte, elle vit repliée chez
elle, à traduire un livre après l’autre, un par an, choisi après
une longue hésitation. Sa vie tourne uniquement autour des
auteurs qu’elle traduit, qui finissent par constituer son
univers, en dépassant largement ses quatre murs, et la guerre au
dehors. Elle écrit à la main, et ses manuscrits s’entassent dans
une pièce qui leur est réservée. Toute une existence se déroule
ainsi, dans laquelle la traduction est élevée au rang de
nécessité vitale, bien que parfaitement « unnecessary » pour le
monde alentour.
La
confrontation avec le monde extérieur est une épreuve, le monde
extérieur incluant les éditeurs, qui sont vitalement
nécessaires, et auxquels il faudrait élever des stèles pour les
services rendus à la littérature, et à ses traductions, mais
avec lesquels il faut négocier, pied à pied, en affrontant les
dures réalités du marché, de la vente, parce qu’il faut bien que
le livre se vende, autrement cela ferait un éditeur de plus qui
mettrait la clé sous la porte. Il faut donc composer, négocier
dit Umberto Eco. Mais pas trop, comme toujours. À preuve
l’aventure du titre du roman de
Fang Fang
(方方)
« Funérailles
molles » (《软埋》),
qui avait été refusé au départ par l’éditeur, parce que ses
« commerciaux » lui avaient dit : avec un titre aussi
incompréhensible, ça ne se vendra pas. Or c’est la traduction
aussi précise que possible du titre original, qui représente une
coutume spécifique que Fang Fang explique dans le roman car elle
en constitue un élément thématique important. Et qu’elle
explique parce que, s’agissant d’une coutume locale, ancienne,
la plupart des Chinois eux-mêmes ne la connaissent pas. Mais
c’est justement ce qui intrigue. Et le roman s’est très bien
vendu. La traduction française est même restée longtemps la
seule disponible, la version chinoise ayant été « retirée des
étagères » en Chine. La traduction en anglais vient juste de
sortir, avec quasiment le même titre : « Soft Burial » (Burial
étant meilleur, mais « enterrement mou » ne sonnait vraiment
pas bien).
Au milieu des
frustrations et tribulations coutumières, il est toujours
réconfortant de pouvoir se sentir partie prenante d’une
communauté vivante de traductrices. Souvent inconnues. Le plus
souvent étrangement hybrides. Comme cette Maïa Hruska découverte
grâce à une amie archiviste passionnée de littérature d’Europe
centrale : née dans une famille franco-tchèque, élevée en
Allemagne et vivant aujourd’hui à Londres. Elle a écrit un
essai, « Dix versions de Kafka », publié chez Grasset en 2024,
qui revisite l’œuvre de Kafka à travers ses différentes
traductions. Où l’on voit nettement les relations croisées entre
l’écrivain et son traducteur, et dont ressort la richesse de ces
traductions, toutes différentes, mais marquées du sceau de la
personnalité du traducteur. Avec bien sûr des incidences
historiques.
Il y a des
rencontres virtuelles qui sont de joyeuses surprises quand on
retrouve les livres qui en sont la matérialisation, en quelque
sorte, tel ce petit livre que j’avais relégué dans un pli de ma
mémoire et que j’ai retrouvé en en cherchant un autre, comme
souvent.
|
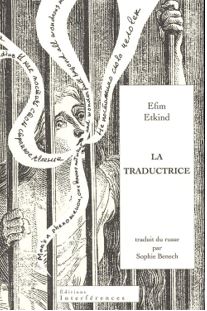 |
|
C’est un bref récit, de 25 pages, d’un auteur, Efim
Etkind, mort en 1999, qui était un ami de
Soljenitsyne et de Brodsky.
Le
récit s’intitule « La traductrice ». C’est une
histoire vraie, contée en flash-back : celle de
Tatiana Gneditch, descendante du traducteur de
l’Iliade en russe, traduction publiée en 1829 et
considérée comme un chef-d’œuvre… de la langue
russe.
.
Elle-même, dans les années 1930, travaillait sur les
poètes élisabéthains du 17e siècle, au
milieu des purges dont elle se souciait comme d’une
guigne. Envoyée dans une prison du NKVD, alors
qu’elle avait disparu du monde, elle a traduit en
russe, au fond de sa cellule, le Don Juan de
Byron. |
Mais ce petit
livre a lui aussi son histoire. Il porte une dédicace : « À
Brigitte, de la part de l’éditrice et traductrice Sophie
Benech ». Mais la Brigitte à qui il est dédié, ce n’est pas moi,
c’est une autre traductrice, une amie qui s’appelle aussi
Brigitte, Brigitte A, traductrice du japonais qui m’envoie
régulièrement des haikus, et qui connaît Sophie Benech,
traductrice du russe et éditrice, passionnée de dessin et de
gravure, comme en témoigne la couverture de son livre.
L’histoire de
la traduction est en filigrane dans ces parcours croisés, et la
traduction y prend toute sa signification. Car dans notre monde
va-t-en guerre d’extrémismes exacerbés et de nationalismes
exaltés, la traduction est aujourd’hui plus que jamais pont
nécessaire entre les cultures. Au cœur des humanités.
__________________
Bibliographie
(Ouvrages
cités)
Cassin,
Barbara, Éloge de la traduction. Compliquer l’universel,
Fayard, 2016.
Eco, Umberto,
Dire presque la même chose. Expériences de traduction,
traduit de l’italien par Myriem Bouzaher, Grasset, 2006.
Meschonnic,
Henri, Poétique du traduire, Verdier, 1999.
Fiction
Alameddine, Rabih, An Unnecessary Woman, Corsair, 2013.
Récit
Etkind, Efim,
La Traductrice, trad. du russe par Sophie Benech, éd.
Interférences, 2012.
Essai
Hruska, Maïa,
Dix versions de Kafka, Grasset, 2024.
_________________
|
|

