|
Club de lecture de littérature
chinoise (CLLC)
Compte rendu de la séance du 17
décembre 2025
et annonce de la séance suivante
par Brigitte
Duzan, 22 décembre 2025
À la suite de
celle concernant Bao Tianxiao (包天笑),
cette dernière séance de l’année 2025 était consacrée, à des
nouvelles d’un autre écrivain de la fin du 19e et du
début du 20e siècle : Su
Manshu (苏曼殊).
Écrivain atypique s’il en est, romancier, poète, traducteur… et
moine, né d’un marchand de thé cantonais et d’une mère
japonaise, il a longtemps été ostracisé, d’abord par les
promoteurs de la Nouvelle Culture car il écrivait dans un
chinois classique et non dans le
baihua
qu’ils appelaient de leurs vœux, puis par les maoïstes qui lui
reprochaient de vivre et de prôner des valeurs « féodales » ;
enfin, il a été généralement méprisé parce qu’il était considéré
comme « le moine des sentiments » (qing seng 情僧)
et qu’on en a fait un précurseur du courant des « Canards
mandarins et papillons » (鴛鴦蝴蝶派).
Il faut
attendre les années 1980 pour que s’amorce un renouveau
d’intérêt pour cet auteur, et que six de ses principales
nouvelles soient publiées en traduction française, avec une
préface élogieuse d’Etiemble qui voyait en Su Manshu « le
parangon de l’homme libre » :
- « Les
larmes rouges du bout du monde » (Tiānyá
hóngléi jì《天涯红泪记》),
traduction et notes de Dong Chun
et
Gilbert Soufflet, préface d’Etiemble, Gallimard, coll.
« Connaissance de l’Orient », 1989.
Ce sont six
nouvelles datant des années 1910 :
1/ La solitude
de l’oie sauvage Duànhóng língyàn jì 《断鸿零雁记》1912
(en 27 courts chapitres
)
2/ Le foulard
pourpre Jiàngshā jì《绛纱记》1915
3/ L’épée
brûlée Fénjiàn jì 《焚剑记》1915
4/ L’épingle
brisée Suìzān jì 《碎簪记》1916
5/ Ceci n’est
pas un rêve Fēimèng jì 《非梦记》1917
6/ Les larmes
rouges du bout du monde Tiānyá hóngléi jì《天涯红泪记》(début
de sérialisation 1914, inachevé)
Avec en
appendices (pp. 233-256) tout un dossier sur l’auteur, y compris
des traductions de préfaces, dont celle écrite pour son recueil
de traductions de poèmes de Byron (Bàilún shī xuǎn《拜伦诗选》)
paru en Chine en 1909.
| |

Su
Manshu, préface aux poèmes choisis de Byron |
|
Homme libre,
certes, Su Manshu, mais qui a connu une existence de paria dont
ses écrits sont le reflet et qui en sont indissociables. La
séance du club de lecture a montré que ces nouvelles sont
toujours d’une lecture difficile, peut-être plus que jamais, ne
serait-ce qu’en raison de la langue dans laquelle elles sont
écrites pour ceux et celles qui ont essayé de les lire dans le
texte original – cette difficulté fait d’autant plus apprécier
la beauté de la traduction, mais celle-ci a tendance à faire
oublier le contexte et l’arrière-plan d’écriture. En ce sens, Su
Manshu a divisé les membres du club, et la séance en a été
d’autant plus animée.
Ø
Guochuan
a ouvert la
séance par un premier avis synthétique sur sa lecture du recueil
tel que publié en Chine, aux éditions Yilin (译林出版社),
en 2013.
| |
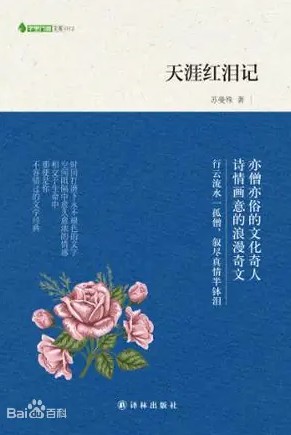
Tiānyá hóngléi jì,
译林出版社
2013 |
|
Ce recueil
inclut, outre les nouvelles traduites en français, la
« traduction » par Su Manshu des « Misérables » de Victor Hugo -
interprétation et réécriture en très beau chinois classique
plutôt que traduction véritable, selon ce qui se pratiquait à
l’époque, à l’instar de
Lin Shu (林紓).
[« Les
Misérables » a été traduit pour la première fois en chinois par
Su Manshu en 1903. La traduction, littéralement « Un monde
misérable » (《悲惨世界》),
est parue en feuilleton dans le Quotidien national (《国民日日报》)
à partir du 8 octobre, signée du pseudonyme Su Zigu (苏子谷).
La publication a cessé avec le journal le 1er
décembre suivant, au bout de 11 chapitres. L’année suivante, en
1904, elle a été publiée en livre, en 14 chapitres, les
chapitres 12 à 14 étant de la plume de Chen Duxiu (陈独秀),
alias Chen Youji (陈由己).]
| |
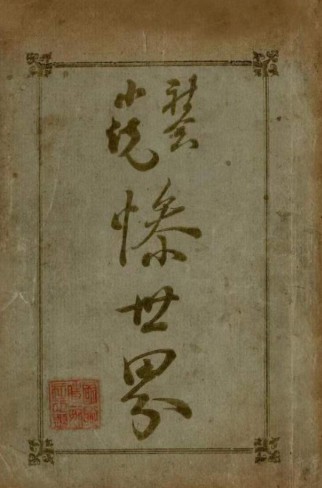
Un
monde misérable, éd. 1904 |
|
Guochuan
insiste sur ce texte car elle a été frappée par la langue de
cette traduction et son humour. Comme il était courant chez les
traducteurs chinois, le texte s’éloigne de l’original de Hugo
pour « siniser » l’histoire et les personnages, et les rendre
ainsi plus compréhensibles et plus attrayants pour les lecteurs
chinois de l’époque. Su Manshu en profite pour se moquer des
clichés sur les pieds bandés qu’il introduit dans l’histoire en
les comparant à des coutumes occidentales tout aussi barbares
comme celle du corset.
Au-delà des
nouvelles, et en particulier de « La solitude de l’oie sauvage »
qui est comme une autobiographie de l’auteur, elle a surtout été
fascinée par le personnage et la vie de Su Manshu, ses idéaux et
ses contradictions. Un personnage qui s’est fait trois fois
moine, a vécu entre Chine et Japon, était l’ami de Chen Duxiu et
de Lu Xun, et dont les nouvelles reflètent la vie, et en
particulier, au Japon, sa fréquentation des lieux de loisirs.
Elle a
apprécié la satire de la société qui caractérise ces nouvelles,
même si les femmes y sont promises à des fins tragiques tandis
que l’homme peut toujours se réfugier dans un monastère, ce que
Su Manshu lui-même ne s’est pas privé de faire. Elle a poursuivi
sa lecture par des articles sur le style de l’auteur, dont
beaucoup mentionnent l’influence de l’esthétique japonaise dite
« Mono no aware » (物の哀れ),
concept à la fois esthétique et spirituel où mono (物)
désigne les choses et aware (哀れ)
est une interjection témoignant d’une surprise mesurée. Donc on
peut traduire littéralement par « Ah les choses ! », soit
« empathie envers les choses » (entendues comme impermanentes et
éphémères, témoignant du passage du temps).
C’est un concept très connu de critique littéraire au Japon qui
s’applique tout particulièrement, dans le cas de Su Manshu, à
ses descriptions du paysage et du temps en symbiose avec les
sentiments et émotions du narrateur/auteur.
Au total, elle
a été ravie de découvrir cet auteur.
Quant aux
autres membres du club, ensuite, on peut distinguer trois
tendances générales dans leurs réactions à cette lecture.
1/ Réaction
négative aux « larmes » récurrentes.
C’est une
réaction assez générale, mais qui peut aller jusqu’au rejet de
l’auteur et de ses récits.
Ø
C’est le
cas de Sylvie, qui a dû reprendre plusieurs fois sa
lecture de la première nouvelle
,
« La solitude de l’oie sauvage », commencée sans avoir rien lu
sur l’auteur auparavant. Au bout des trois premiers chapitres,
elle a failli abandonner, lasse de « ce texte larmoyant où
l'auteur-narrateur semble toujours au bord des larmes ».
Par acquis de
conscience, elle a alors lu la préface d’Etiemble et s’est alors
dit : « si ce texte représente la biographie romancée de
l'auteur, c'est quand même intéressant d'en découvrir un peu
plus... ». Elle a donc repris sa lecture. Mais avec toujours
autant d’agacement : voilà trois personnages mal équilibrés, peu
vraisemblables, « qui marchent côte à côte » ;
l’auteur-narrateur rend visite à sa famille, dont la jeune
Shizuko qui est amoureuse de lui et que sa mère et sa tante
veulent lui faire épouser. Elle s’inquiète de sa tristesse, mais
« après quelques mots d'excuses polies, c'est lui qui pleure, et
elle lui tend un mouchoir. » Et la petite sœur ? On ne sait trop
qui elle est ni quelle est sa position…
Bref,
Sylvie a fini la nouvelle, mais à grand peine, et si elle a
lu les autres nouvelles dans la foulée, c’est « parce qu’elle
avait du temps devant elle ». Tous ces récits pleins
d'événements dramatiques, naufrages, maladies, suicides, et même
mort subite "de chagrin", sont peuplés uniquement de jeunes
femmes idéalisées, sur le plan physique comme sur le plan moral.
Dans une seule de ces nouvelles ( L'épingle brisée), on voit
brièvement un reflet de la vie politique – lorsque le
héros-narrateur refuse de signer un document à la gloire de Yuan
Shikai ; mais, dans la plupart des cas, elle a eu l'impression
d'être hors du temps, sans pouvoir adhérer aux récits.
Ø
De
même, Laura a renâclé à la lecture des nouvelles qu’elle
a pu lire, entre autres lectures pour la librairie, et en
commençant par les plus courtes. Elle a trouvé qu’elles étaient
bâties sur un même modèle, avec le monastère comme porte de
sortie dans les cas de détresse extrême.
Résultat :
elle en a déjà oublié le détail. Il lui reste le souvenir d’une
série de fantômes. Et, pour ce début de 20e siècle,
elle préfère largement
Bao Tianxiao
découvert le mois précédent.
Ø
Dorothée
a lu ces récits en « regrettant Kawabata » auquel elle a songé
dès la première nouvelle, et s’est lassée de la succession de
larmes, maladies et autres malheurs récurrents. La figure de la
mère lui a semblé incompréhensible, de même que l’image des
femmes, entreprenantes ou inaccessibles.
Elle en a
gardé quelques expressions frappantes, dont une répétée
plusieurs fois : « les femmes sont des eaux malveillantes » ou
« des eaux malfaisantes ».
Ø
UB
a raté l’unique exemplaire de la traduction de la Bulac et,
voulant lire les nouvelles mais trouvant le chinois trop
difficile, a été obligé d’acheter le livre.
[Désolée, dit
Lei, c’est moi qui venais de l’emprunter…]
[Le club fait
monter les enchères. Comme on dit : « A Luoyang le papier est
cher »
洛阳纸贵 ]
Il a lu à
partir de la fin, et c’est « L’épée brisée » qu’il a préférée
car c’est le récit qui offre le plus de retournements. Mais ces
nouvelles l’ont dans l’ensemble laissé « froid ». Il garde
l’impression d’un véritable « jeu de massacre » sur fond
d’arbitraire.
2/ Intérêt
pour l’arrière-plan socio-politique et la beauté de l’écriture
Ø
Christiane a bien aimé
la première nouvelle du recueil :
- pour la
beauté de l'écriture, dans la description de la nature, mais
aussi de la subtilité des sentiments humains. Avec des images
originales comme p.87 : « enchanteresse qui ressemble au pas
des crabes ».
- pour la
grande sensibilité et l'élévation d'esprit du
narrateur, mais aussi des femmes qui lui étaient destinées,
Xuemei ou Shizuko. Elle a moins bien compris son statut
récurrent de moine, alors même qu'il ne manque pas de sens
critique à l'égard des moines et de leur attachement « aux
biens matériels » :
« Un donneur
d'offrandes, c'est celui qui offre sans rien recevoir. Mais ce
que nous faisons aujourd'hui n'est plus que du commerce, puisque
l'on récompense avec de l'argent les services que nous rendons.
Il ne s'agit plus de communication spirituelle. » (p.101).
- pour
l'intérêt de certaines remarques à l'arrière-plan du
récit, comme celles de la mère de Saburo à propos de sa fille
aînée : « Une fois mariées les filles ne pensent plus à leurs
parents (...). Bien sûr, il leur faut s'occuper du ménage. Mais
tout de même, c'est leur nature, aux filles, que d'être
ingrates. » Déclaration où un phénomène lié à la culture et
induit par les structures et coutumes sociales est interprété en
termes de « nature ».
Cependant,
c’est Le foulard pourpre qui lui a semblé la
nouvelle peut être la plus intéressante, car elle éclaire la
position politique de Su Manshu. On y trouve (p.130) une
description de la société idéale dont il rêve :
« Dans cette
contrée, personne ne savait ni lire ni écrire. Le troc tenait
lieu de commerce. Toute monnaie y était inconnue. Tout le monde
s'attachait au labeur de la terre. On respectait les anciens, on
aimait son semblable, et on ne connaissait pas de conflit.
Personne n'accaparait - fût-ce en le ramassant - ce qui ne lui
appartenait pas. Les portes, le soir, restaient ouvertes. »
Par contraste,
la société réelle est faite d'injustices alimentées par les
rumeurs et aggravées par l'arbitraire.
Face à
l’arbitraire du pouvoir, on trouve, même parmi les pirates, des
êtres au grand cœur qui, par horreur de l'oppression, peuvent
secourir les êtres démunis, comme le capitaine du vaisseau
pirate qui décide d'emmener le narrateur à Hong Kong.
Mais, dans
L'épée brûlée, le pessimisme de Su Manshu semble
accru : « Aujourd'hui, c'est le règne de la déraison et de
l'injustice. On ne compte plus le nombre des victimes. C'est le
dégoût que m'inspire ce monde qui m'en a éloigné. » (p. 145)
Sa critique
s'étend même aux lettrés, par la voix de la jeune Ahui :
« à quoi cela sert-il, ce que nous apprenons ici ? N'y a-t-il
pas déjà trop de gens à tenir des propos vides de sens? Ceux-là
ne sont que des profiteurs. Tout ce qui les préoccupe, c'est la
gloriole et leur enrichissement. Leurs paroles mielleuses et
éculées ne masquent pas leurs ambitions malsaines. Ce sont
ceux-là qui ruinent le pays et le conduisent à sa perte. »
(p. 148)
On en arrive même à
des horreurs, puisque Mei Niang et Alan, dans leur errance, se
retrouvent dans un village d'anthropophages. Et même la vertu
féminine conduit à des situations extrêmes, puisqu'Ahui, promise
à son cousin qui meurt de tuberculose, se trouve acculée à
épouser un bout de bois symbolique
!...Dans
cette nouvelle, le contraste entre l'horreur d'une situation
chaotique et l'idéalisme des personnages est poussé à l'extrême
.
Pour les deux
nouvelles suivantes, cependant, L'épingle brisée
et Ceci n'est pas un rêve, Christiane a
trouvé lassant le romantisme exacerbé de l’auteur, même si est
pathétique la situation réelle des femmes, soumises aux
décisions familiales qu'elles appellent « destin ». Le souci
qu'ont les familles d'organiser des mariages avec de « bons
partis » montre comment les jeunes gens, hommes et femmes, sont
prisonniers des conventions (mais de même que dans les milieux
bourgeois ou paysans de l'Europe jusqu'au milieu du 20e
siècle) ; l'argument de la tante de Haiqin a malgré tout quelque
chose de révoltant : « C'est une affaire de dignité sociale.
Il faut tenir notre rang. » (p.209). Dans toutes les
nouvelles du recueil, les jeunes gens ne peuvent que se
soumettre ou mourir. Si le jeune homme peut trouver une
échappatoire en se faisant moine, pour les jeunes filles, c'est
plus difficile, même si dans Le foulard pourpre
les deux jeunes filles survivantes deviennent bonzesses. Dans sa
dernière nouvelle, inachevée, Christiane a trouvé comme
un aveu de ce qui pousse à se retirer dans la vie
monastique : « N'est-il pas compréhensible que les hommes,
tourmentés par les affres d'une époque convulsive, cherchent
refuge dans la méditation, au milieu des fleuves et des
montagnes ? » Surtout quand il s'agit d'êtres
particulièrement sensibles aux malheurs de leur temps,
ajoute-t-il (P.223/24).
Christiane
trouve paradoxal de voir Su Manshu dénoncer le poids écrasant
des conventions sociales, mais critiquer en même temps le manque
de retenue d'une Fengxian et plus largement, dans
L'épingle brisée, « ces femmes qui se prétendent
libres et n'ont pas plus de vertu que la plus inconstante des
femmes. » Il dénonce à la fois l'injustice régnante et le
changement des mœurs. Ainsi, dans Le foulard pourpre,
sa cible est la décadence qui va de pair avec l'influence
occidentale : « Cette tenue n'accusait que trop l'influence
occidentale. Je pensai aussitôt aux ères de décadence de la
Chine antique. Les mœurs allaient à vau-l'eau, on voyait des
hommes s'accoutrer en femmes. Ainsi agonisaient des royaumes. »
(p.123)
Dernières
remarques : en lisant la description par Su Manshu de son idéal
social, Christiane a pensé au rêve de transparence de
Rousseau dans la Nouvelle Héloïse. Enfin, elle a
retrouvé dans ces textes un même souci de vie spirituelle que
celui qui transparaît dans un roman vietnamien de Khái Hung
récemment paru à l'Harmattan : « Deux
papillons rêvant d'immortalité » (dans
lequel une jeune bonzesse renonce à son amour pour un jeune
lettré par souci de spiritualité.)
Ø
LLP
a lu trois nouvelles, dont « La solitude de l’oie sauvage » et
« L’épée brisée », mais elle ne les aurait certainement pas lues
d’elle-même si elles n’avaient été au programme du club de
lecture.
La première,
autobiographique, lui a paru refléter l’idéal de liberté de
l’auteur sous couvert de solitude et elle a beaucoup apprécié la
culture lettrée dont ces nouvelles sont empreintes, et tout
particulièrement :
- La
poésie qui s’en dégage, très bien rendue dans la
traduction : poésie rendue par des images originales (les
libellules comme pigeons voyageurs) ainsi que par la valeur
picturale des descriptions de lieux et de paysages.
- L’érudition
dont fait preuve l’auteur, en matière de textes et culture
bouddhiques entre autres, avec un idéal de renoncement, et même
de mendicité, ce qui n’empêche pas une critique du clergé,
symptomatique pour l’époque.
- Érudition
mais aussi culture polyglotte (citant Sappho aussi bien
que Byron), ce qui s’étend aussi à la cousine Shizuko qui
connaissait le sanscrit. Les femmes sont d’ailleurs souvent très
intelligentes, à l’instar de cette Shizuko, ce qui est rare dans
la littérature chinoise encore à cette époque.
Tout cela
n’exclut pas l’immense tristesse qui se dégage de ces textes,
régulièrement ponctués de larmes. Mais s’en dégagent aussi des
détails qui l’ont frappée, sur l’époque, et en particulier sur
la vie des femmes :
- Il
est quand même étonnant de voir qu’en 1915 encore on ne pouvait
pas toucher la main d’une femme, si bien que, quand on lui
offrait un tableau ou un livre, elle le prenait la main protégée
par un pan de sa robe ;
- On
a aussi quelques méthodes pour éviter les viols, dont la plus
courante : s’enduire le visage de suie…
[méthode
surtout pour éviter les enlèvements que l’on retrouve dans
divers textes] ;
- Elle
a souri à la mention des poux, une constante symbolique chez les
intellectuels chinois, y compris dans la Chine maoïste.
Ø
Giselle a été séduite,
dès l’abord, par la beauté du texte de « La solitude de l’oie
sauvage », mais en se demandant si c’était dû à la traduction.
Non, confirme
Lei, c’est aussi très beau en chinois.
Giselle
en a donc retenu des images de paysages de vent et de neige,
d’échassiers au repos, de saules maigres et de montagnes tristes
dans la brume, de personnages qui se lavent le visage de leurs
larmes, noyés dans des chagrins amers comme des vagues
déferlantes et des nuées porteuses d’orage, et des évocations
d’amours plus fortes que la mer et les roches, mais qui
n’engendrent que tristesse et désespoir. Et au milieu de toute
cette tristesse, quelques pages qui tranchent par leur violente
actualité (un projet d’assassinat !).
Finalement
l’amour le plus inspiré est l’amour maternel. D’où le dilemme :
rester avec sa mère ou partir… Mais c’est le personnage de
Shizuko qui lui a semblé peut-être le plus émouvant : elle a la
grâce d’un jeune cygne, un charme divin, le cœur qui s’envole ;
elle est comparée à une divinité, timide et le feu aux joues,
mais le garçon n’est pas plus entreprenant : il a « le regard
admiratif collé au sol de l’allée » ; elle est érudite et
possède des livres confucéens, mais qui sont en meilleur état
que les livres bouddhiques qui sont, eux, tout usés… il n’ en
faut pas plus pour se représenter les personnages, et toute
l’époque, mais de manière originale. Le thème général restant la
tristesse infinie, à une époque et dans un univers où les poèmes
ne sont plus « des vers qu’on lit mais des larmes qui coulent ».
Le problème,
cependant, reste celui de la complexité de la langue dont la
beauté apparaît au travers de la traduction, mais sur laquelle
ont buté même les membres du club d’origine chinoise, et qui a
entraîné deux stratégies de lecture : le contournement et
l’affrontement.
3/ Le
problème de la complexité de la langue d’origine
Ø
MRC
a
trouvé le texte original particulièrement difficile à
comprendre. Après l’avoir trouvé sur internet, il l’a fait
« traduire » en chinois moderne par chatgpt, qui a malgré tout
conservé le style général.
Ensuite, la
lecture des nouvelles lui a donné l’impression de lire une
traduction du japonais, et en particulier du Kawabata.
Moi aussi, dit
Laura, non seulement le style, mais aussi l’histoire.
[ce qui
renvoie aussi à ce que disait Guochuan sur le style
japonais dit « Mono no aware » dont Kawabata était l’un
des partisans et promoteurs modernes.]
Kawabata
(1899-1972) mais aussi Dazai Osamu (1909-1948), poursuit MRC.
Quelles qu’en
soient les raisons profondes, il a retrouvé dans les textes de
Su Manshu une forme de beauté typique de la littérature
japonaise mêlant tradition, retenue et politesse. Cette beauté
est aussi celle des fleurs de cerisier, beauté de l’éphémère,
marquée par le sentiment de la fatalité et
de la fragilité.
Les
personnages féminins présentent des traits communs : elles sont
d’une pureté irréprochable, blanche comme neige, empreintes de
pudeur, presque célestes. Cette représentation donne
l’impression que l’auteur idéalise profondément la figure de la
femme et qu’au fond, il n’a jamais réellement réussi à se
détacher du monde profane. Ces figures féminines semblent
animées par une vraie volonté de poursuivre leur bonheur
personnel, mais leurs trajectoires aboutissent le plus souvent à
une impasse, d’où l’impression de fragilité et de fatalité.
Sur le plan
narratif, « La solitude de l'oie sauvage » et « Les larmes
rouges » ne comportent pas beaucoup de rebondissements, tandis
que « Le foulard pourpre » se distingue par une véritable
intrigue. Quatre ou cinq personnages s’y croisent, ce qui, selon
les normes habituelles de la nouvelle moderne, peut sembler
beaucoup et parfois déstabiliser la lecture. Cependant, chacun
de ces personnages incarne un thème distinct : le suicide lié à
la pression économique et à la survie, le choc de l’amour libre
face aux traditions, l’engagement révolutionnaire, la tromperie,
ou encore le choix final du retrait du monde profane. Ils ne se
répètent donc pas, mais composent ensemble une mosaïque de
tensions et de destins.
Ø
Quant à
Lei, elle s’est attachée à lire les nouvelles dans le
texte, et le texte dans sa version originale en chinois
classique (《曼殊小说集》),
mais elle a mis longtemps à « trouver le rythme » en raison de
la langue elle-même, mais aussi de la mise en page verticale.
| |

Les
nouvelles de Su Manshu, éd. originale
|
|
1) La
lecture : une course d’obstacles
La langue
faisant obstacle, et le sens des phrases n’apparaissant que de
manière fragmentaire, rendant une lecture fluide impossible,
Lei a choisi de procéder par étapes, en commençant par le
dernier chapitre qui donne son titre au recueil et qui est
relativement court. Mais, si la trame narrative apparaissait
clairement, le texte restait élusif. C’est donc grâce à la
traduction française, d’une grande élégance stylistique, et à
ses notes, qu’elle a pu trouver le rythme de lecture car le
texte original est d’une grande beauté, les phrases sont
soigneusement construites, riches en expressions
quadrisyllabiques, ce qui leur confère une grande musicalité et
un rythme très marqué - caractéristique qui correspond
parfaitement à la description figurant sur la quatrième de
couverture de la traduction française : « phrase musicale et
rythmée ».
Ainsi, par
exemple, dans le septième chapitre de « La solitude de l’oie
sauvage » (Duanhong lingyan ji
《断鸿零雁记》),
l’auteur traduit
des vers de Lord Byron extraits du Childe Harold’s Pilgrimage
en vers quadrisyllabiques
extrêmement travaillés, d’une grande virtuosité stylistique, ce
qui témoigne de l’excellence de la plume de Su Manshu et
justifie pleinement sa réputation – mais ce passage n’est pas
traduit dans l’édition française.
[Le passage se
situe au moment où le narrateur de la nouvelle se trouve à bord
d’un navire, sur l’océan Pacifique, et que le spectacle de la
mer et du ciel l’entraîne dans une rêverie très littéraire ;
feuilletant les livres qu’on lui a offerts, les œuvres de
Shakespeare, de Byron et de Shelley, il compare le premier à Du
Fu (杜甫),
le deuxième à Li Bai (李白)
et le dernier à Li He (李贺)
et s’arrête sur le poème qui conclut l’ouvrage de Byron et
s’intitule « The
Sea »
- qu’il traduit « aussitôt » (édition française p. 40-41).]
2) Son
impression générale des nouvelles ?
Lei
a été frappée par la beauté tragique des histoires d’amour, mais
les intrigues paraissent il est vrai très similaires, tant dans
leur structure que dans leur contenu : dans chaque récit, les
protagonistes tombent amoureux au premier regard, se heurtent à
l’opposition des aînés, puis la femme choisit le suicide tandis
que l’homme tente (et même à plusieurs reprises) de devenir
moine.
Cette
répétition révèle une conception de l’amour qui peut sembler
quelque peu stéréotypée. Cependant, dans la première préface du
« Foulard pourpre » (Jiangsha ji (《绛纱记》),
Su Manshu consacre un long passage à l’histoire de Roméo et
Juliette ; il apparaît ainsi clairement que ce récit constitue
pour lui une clé essentielle. De plus, dans sa postface à
« L’épingle brisée » (Suizan ji《碎簪记》),
Chen Duxiu souligne que, si une même histoire se répète, c’est
qu’elle correspond à une réalité profondément enracinée dans la
société :
“余恒觉人间世,凡一事发生,无论善恶,必有其发生之理由,况乎数见不鲜之事,其理由必更充足,均不当谓其不应发生也。食,色,性也;况夫终身配偶,笃爱之情耶。人类未出黑暗野蛮时代,个人意志之自由,迫压于社会恶习者又何僅此!而此则其最痛且者。古今中外之说部,多为此而说也。”
(《碎簪记》p.
95)
« Je suis
convaincu que tout événement survenant dans le monde, qu’il soit
bon ou mauvais, a nécessairement sa raison d’être. À plus forte
raison lorsqu’un phénomène se reproduit fréquemment : sa
justification en est d’autant plus solide. On ne peut pas dire
que cela ne doit pas avoir lieu. Nourriture et désir relèvent de
la nature humaine ; à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un
compagnon pour la vie, d’un amour profond et sincère. L’humanité
n’étant toujours pas sortie de la barbarie la plus sombre, les
atteintes à la liberté de chacun et les tragédies causées par la
pression sociale sont certes loin de se limiter à ces cas ! Mais
les drames de l’amour sont sans doute ce qu’il y a de plus
douloureux. Depuis l’Antiquité, en Chine comme ailleurs, la
majorité des œuvres littéraires leur sont consacrées. » (Suizanji
[L’épingle brisée] postface p. 95)
3) Un titre
bien choisi, annonçant motifs et personnages récurrents autour
d’une pensée centrale
Tianya
honglei ji
étant le texte le plus court du recueil et demeuré inachevé, on
peut se demander pourquoi l’auteur, ou l’éditeur, en a fait le
titre de l’ouvrage. Lei s’est posé la question et, après
lecture complète et réflexion, il lui est apparu que ce titre
est une parfaite synthèse de l’intention de Su Manshu :
- D’abord, en
chinois, le terme tianya (天涯,
« le bout du monde ») évoque souvent un univers irréel, un monde
d’évasion, voire une utopie ou un « ailleurs ». Les temples, les
rêves, les forêts paisibles ou les villages isolés décrits dans
les récits relèvent tous de cet espace symbolique du tianya,
un refuge loin du chaos d’une époque de troubles et de
souffrances, que l’on cherche à fuir.
- Ensuite, le
terme hong (红,
« rouge ») renvoie à la fois à la féminité, à l’amour et à la
passion, mais aussi au sang, à la vie et à la mort. Il constitue
ainsi le noyau symbolique de l’ensemble des récits.
- Enfin,
lei (泪,
« larmes ») représente la misère et la tragédie, tant des
destins individuels que des histoires d’amour. Les larmes sont
omniprésentes : les héroïnes et les héros pleurent, tout comme
les personnages féminins secondaires, telles que les servantes,
les mères, les tantes ou les nourrices.
Personnages et motifs récurrents
peuvent certes donner une impression de répétition :
- Les
personnages :
1. Les
héroïnes : d’une grande beauté, cultivées et vertueuses, elles
incarnent l’idéal de la « vertu féminine » prônée par la société
traditionnelle, allant jusqu’au sacrifice de soi. Leur destinée
est toujours tragique : issues de milieux modestes ou déchus,
contraintes à des mariages arrangés, elles finissent par se
suicider.
2. Les
héros : beaux, mais maladifs, ils sont dotés de qualités morales
et intellectuelles exceptionnelles. Mais leur existence est
aussi marquée par la souffrance : orphelins, enfants abandonnés
et adoptés, ou exilés loin de leur terre natale. Prisonniers de
l’amour et de leur époque, ils choisissent finalement la voie du
bouddhisme, ou tout au moins du monastère.
3. Les
personnages féminins secondaires : souvent désignées comme
épouses par arrangement familial, elles sont également
amoureuses du héros et elles aussi belles, instruites et
vertueuses.
4. Les
personnages masculins secondaires : un vieil homme apparaît
fréquemment comme figure de guide spirituel. Les aînés sont
généralement des figures positives, tandis que belles-mères et
tantes sont souvent cruelles et égoïstes.
5. L’auteur
lui-même : comme le souligne la 4e de couverture de
l’édition française, « Ici se mêlent indissociablement les
pérégrinations de l’auteur et les vagabondages de sa plume »,
les protagonistes masculins peuvent être lus comme des alter
ego de Su Manshu. Sa biographie (origines mixtes, santé fragile,
exil, souffrance amoureuse, moine à trois reprises) transparaît
clairement dans ses récits.
- Et
les motifs :
1. Temples,
paysages, rêves et contexte politique : ces éléments récurrents
traduisent la quête d’un apaisement intérieur et le désir
d’échapper à une réalité chaotique, dans la plus pure tradition
chinoise.
2. L’injustice
judiciaire : à l’instabilité politique correspond une justice
arbitraire et cruelle, notamment envers les femmes.
3. La
culture et la littérature étrangères : leur présence répétée
reflète à la fois l’érudition de l’auteur, son milieu social et
la modernité conflictuelle de son époque. La coexistence du
chinois classique, sur fond de société chinoise féodale
arriérée, et de références occidentales crée toutefois un
contraste saisissant. Les références aux études à l’étranger, au
port du costume occidental, à l’usage de la langue anglaise, aux
hôpitaux occidentaux ou encore les nombreuses citations d’œuvres
étrangères suscitent chez le lecteur un sentiment de décalage et
de tension.
Mais
finalement de ces nouvelles se dégage une pensée centrale :
à travers ces histoires d’amour tragiques, Su Manshu développe
une profonde réflexion sur l’amour, la vie et la mort. Cette
dimension est également soulignée par Chen Duxiu dans la
deuxième préface de Jiangsha ji (Le foulard pourpre),
dans laquelle il met en regard religions et littératures
orientales et occidentales afin d’interroger la nature de
l’amour et son lien indissociable avec la mort.
« Les deux
questions les plus difficiles à élucider dans l’existence
humaine sont au nombre de deux : la mort et l’amour. » (“人生最难解之问题有二:曰死曰爱。”
)
« La
vieillesse et la mort naissent de la vie ; la vie naît de
l’amour, l’amour de l’ignorance. Mais cette ignorance générale
sans limites et sans commencement peut-t-elle pour autant avoir
une fin ? » (“老死缘生,生缘爱,爱缘无明。夫众无尽无明无始而具有终耶?”
)
« Ayant enfin
pénétré le sens de la vie et de la mort, Mengzhu devrait être
délivrée de toute attache et de tout regret ; pourtant, un
morceau du foulard pourpre demeure encore visible parmi les
cendres. Mort et amour : lequel des deux constitue, en
définitive, l’ultime vérité ? » (“梦珠方了徹生死之事,宜脱然无所顾怜矣,然半角绛纱,尤见于灰烬。死也爱也,果孰为究竟也耶?”)
(Jiangsha
ji, « Préface II », 《绛纱记》“序二”,pp.
4 et.5, édition chinoise)
_______
De fil en
aiguille et au gré des différentes lectures, les nouvelles de Su
Manshu sont ainsi apparues sous des jours très différents, mais
dans des approches s’affinant progressivement pour faire
ressortir les qualités d’une écriture aujourd’hui reconnue à sa
juste valeur. En même temps, on peut mesurer la richesse d’une
époque où la langue,
comme la littérature, était en pleine évolution. Il reste à découvrir le « biopic » « Su Manshu » (《苏曼殊》) réalisé
en 2024… et produit par
Tian Zhuangzhuang (田壮壮),
mais dont on attend encore la sortie…
Su Manshu, le
« biopic »
http://www.chinese-shortstories.com/Auteurs_de_a_z_Su_Manshu.htm
___________
Prochaine
séance
Le mercredi
14 janvier 2026
- Six récits
au fil inconstant des jours (《浮生六记》)
de Shen Fu (沈復),
trad. Simon Leys, JC Lattès, 2009.
Et
éventuellement :
- La Dame aux
pruniers ombreux, de Mao Xiang (冒襄),
trad. Martine
Valette-Hémery,
Philippe Picquier, 1992
(Épuisé, mais
à découvrir en bibliothèque ou d’occasion).
|

