|
|
Club de lecture de littérature
chinoise (CLLC)
Compte rendu de la séance du 17
septembre 2025
et annonce de la séance suivante
par Brigitte
Duzan, 22 septembre 2025
Cette première
séance de l’année
2025-2026
était consacrée au grand roman classique : « Au
bord de l’eau » (Shuihuzhuan
《水浒传》).
| |
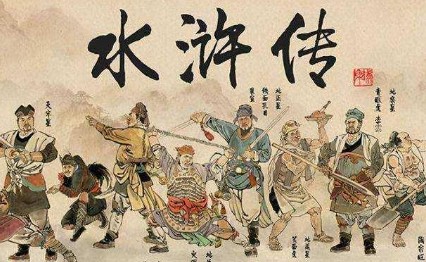
Le
Shuihuzhuan et ses héros |
|
Au programme
était proposée en priorité la version de Shi Nai’an (施耐庵)
/ Luo Guanzhong (罗贯中)
traduite et annotée par
Jacques Dars :
- Au bord de
l’eau, traduit, annoté et présenté par Jacques Dars, préface
d’Étiemble, Gallimard, coll. La Pléiade (2 tomes), 1978.
Mais on
pouvait lire aussi (voire comparer) la version de Jin Shengtan (金圣叹),
réduite à 70 chapitres et un prologue :
- Au bord de l’eau, traduit par Jacques Dars,
Folio (2 tomes), 1978/1997.
Malgré une
lecture estivale assidue, il faut bien dire qu’à la fin de l’été
tout le monde n’était pas arrivé au bout des deux tomes, même
dans la version de Jin Shengtan. Pourtant, il a été reconnu à la
quasi unanimité que le roman était d’une lecture addictive,
chaque fin de chapitre laissant le lecteur sur un suspense et
incitant en termes renouvelés à lire le chapitre suivant pour
connaître la suite, reprenant en cela les astuces des conteurs
d’autrefois. La traduction de
Jacques Dars et
ses nombreuses annotations et commentaires ajoutaient au plaisir
de lecture.
Malgré
quelques défections de dernière minute, la séance a été longue
et animée, en raison des multiples réflexions qu’a suscitées la
lecture.
Ø
Giselle
a d’entrée de jeu reconnu qu’elle n’avait lu que la première
partie (de la version Pléiade), mais faute de temps car elle a
trouvé la lecture compulsive, avec ces appels répétés en fin de
chapitre, toujours différents, comme des diptyques, et chaque
fois introduits par un court poème.
Ainsi à la fin
du chapitre I : Si de ces propos étranges vous voulez savoir la
raison, continuez à lire vous aurez des détails à foison.
Elle n’a pas
trouvé facile, bien évidemment, de s’y reconnaître dans les noms
des personnages, tous accompagnés en outre d’un surnom. Mais
elle a été frappée de voir tous ces personnages jouissant d’un
bon statut social dans l’ensemble, voire d’une situation
privilégiée, se retrouver poursuivis et emprisonnés, la cangue
au cou, en raison de la corruption généralisée de
l’administration impériale, n’ayant d’autre recours, de manière
récurrente, que de fuir « au bord de l’eau ».
[ce qui est
clairement dit, ainsi au chapitre 20 : Song Jiang réfléchit sur
le sort de Chao Gai et son petit groupe de frères jurés qui ont
dérobé les trésors du convoi d’anniversaire, et de fil en
aiguille ont tué nombre de gens, « Pareil amas de forfaits a de
quoi les faire exterminer jusqu’à la neuvième génération… Bien
sûr on les avait acculés à agir de la sorte, et ils ne pouvaient
guère faire autrement… »]
Giselle
a quelques personnages préférés dans cette histoire, en tête
desquels le 13e des Esprits célestes : l’ancien chef
de garnison devenu moine Lu Zhishen (鲁智深),
dit le Bonze-tatoué (花和尚),
buveur impénitent et force de la nature dont les exploits
animent une demi-douzaine de chapitres.
| |
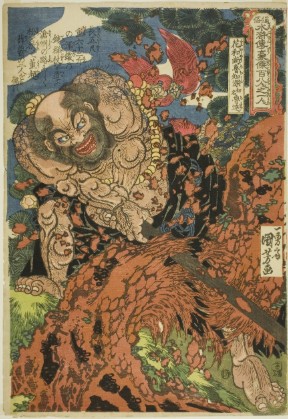
Lu
Zhishen le Bonze-tatoué,
par
Utagawa Kuniyoshi
歌川国芳,
illustration de sa série « 108 Héros du Bord de
l’eau »
通俗水滸傳濠傑百八人之内
|
|
Un autre de
ses favoris est Dai Zong (戴宗),
le Messager-magique (神行太保),
ancien gardien de prison lui aussi, qui peut faire 800 li
en un jour grâce à deux talismans attachés à ses pieds, ce qui
est bien pratique pour transmettre des messages ou glaner des
informations en toute urgence comme il est dit au chapitre 38.
C’est une des nombreuses manifestations de la magie dans le
roman.
| |

Dai
Zong par Utagawa Kuniyoshi |
|
L’histoire
repose sur la loyauté et la fidélité entre « frères jurés », ce
qu’a retenu pour en faire son titre la traduction en anglais :
« All Men are Brothers ».
[Il s’agit de
la traduction de Pearl Buck, dont la première édition date de
1933 (London: Methuen & Co. Ltd), qui a été révisée en 1937 et
rééditée de nombreuses fois par la suite. C’est une traduction
de la version en 70 chapitres de Jin Shengtan qui se termine par
l’exécution de toute la bande. Elle est restée longtemps une
référence, malgré ses erreurs de traduction.
| |
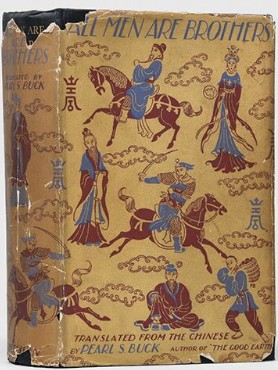
All Men are Brothers, tr. Pearl Buck,
1933 |
|
La traduction de référence en anglais est intitulée « Outlaws of
the Marsh » (par Sidney Shapiro, édition illustrée en 3 volumes,
Foreign Languages Press, Beijing, 1980) ; l’autre titre anglais
de référence est celui de l’adaptation cinématographique de 1972
par
Chang Cheh (张彻)
« The Water Margin ».
Nota : le titre « All Men are Brothers » est une citation des
« Entretiens » de Confucius (Lunyu《论语》),
livre XII,
De l’art de gouverner, selon la traduction d’Anne Cheng
:
君子敬而無失,與人恭而有禮,四海之內,皆兄弟也…
« L’homme de
bien fait son devoir sans faillir, traite les autres avec
respect et possède le sens du rituel. Pour lui, entre les Quatre
Mers, tous les hommes sont frères…. » (livre XII, 5) ]
Ø
Dorothée
avait d’abord lu le roman dans sa traduction en allemand, dans
une édition de poche dont elle avait trouvée le premier tome par
hasard … dans la rue. C’est la première traduction en allemand,
par le traducteur et sinologue Franz Kuhn (1884-1961), « Die
Räuber vom Liang-Schan-Moor », initialement éditée à
Leipzig en 1934
,
mais dont elle avait l’édition de poche de 1975.
| |
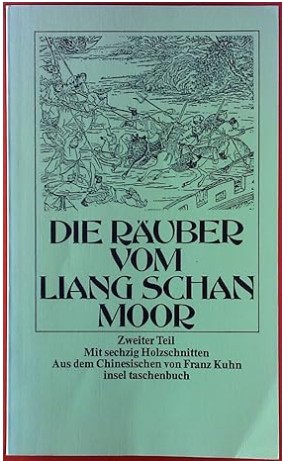
Die Räuber vom Liang Schan Moor,
trad.
Franz Kuhn, éd. de poche illustrée 1975 |
|
Le 2ème
tome se termine par une postface du traducteur qui l’a
particulièrement intéressée car Franz Kuhn y explique ses choix
de traduction – une langue populaire correspondant à l’original
– et le contexte historique de la réception du roman en Chine :
il y est resté longtemps interdit, pour son côté subversif,
explique-t-il, et les fonctionnaires qui étaient pris à le lire
encouraient des peines allant jusqu’à la retenue de leur salaire
pendant un an.
Ensuite,
pendant l’été, Dorothée s’est plongée dans la traduction
de Jacques Dars et elle a particulièrement apprécié tout
l’appareil de notes. Mais elle a aussi admiré la précision des
descriptions des personnages : tous les détails de leurs
vêtements et de leurs armes, dans une profusion de couleurs.
Ø
Quant à
Christiane, elle a adoré le roman dont elle a lu l’édition
de La Pléiade après avoir lu la version de Jin Shengtan qu’elle
avait achetée en premier. Elle a trouvé la traduction de Jacques
Dars aussi « flamboyante » que le récit lui-même.
Elle aussi a
été accrochée par les appels à poursuivre en fin de chapitre,
avec des formules différentes chaque fois. Mais elle a également
été sensible aux interpellations dans le cours du texte, comme
le conteur s’adressant à son auditoire. Ainsi au chapitre 31,
lorsque Wu Song trucide une servante qui voulait s’enfuir,
l’autre est clouée sur place de frayeur : « D’ailleurs, dit
l’auteur, il y avait de quoi … vous-même, lecteur, fussiez resté
hébété de terreur… » Elle a trouvé tout aussi remarquable les
ruptures dans la narration, pour insérer une explication à
partir d’une question soudaine : « À propos, comment Song Jiang,
issu d’une famille de propriétaires fonciers, avait-il pu se
retrouver au fond d’un souterrain ? » (chapitre 22).
Le récit,
ensuite, est très bien construit, de manière à amener petit à
petit l’arrivée des bandits, les uns après les autres. Et une
fois le groupe constitué, le récit bascule vers l’amnistie,
puis, après la victoire contre Fang La, vers la disparition et
la mort des bandits, sauf ceux utiles à l’empereur, dans un
processus qui semble inéluctable.
Comme
Dorothée, elle a beaucoup aimé les descriptions des
personnages, colorées comme dans un manga, et traduites en outre
en gardant le rythme et en évitant les clichés, ainsi au
chapitre 5 la description du bonze Lu Zhishen : « À la lueur de
la lanterne, ils découvrirent un spectacle peu commun : un bonze
gras, colossal, et nu comme un ver, assis à chevauchons
sur le dos du grand roi écrasé sur le lit … »
[Et quelques
pages auparavant est décrit ce « grand roi », avec force détails
et dans un chatoiement de couleurs : « coiffé d’un turban
vermillon… les tempes ornées d’une fausse fleur de gaze brodée…
son corps de tigre vêtu d‘un pourpoint collant de soie verte à
broderies d’or, avec revers de velours, … chaussé de bottes en
peau de buffle, à talons ornés de motifs de nuages assortis… »]
Les
descriptions de troupes et les scènes de bataille ne sont pas en
reste (ainsi au chapitre 86). Mais, dans ce contexte,
Christiane a apprécié l’humour, comme dans la scène où Li
Kui, terrorisé, doit « voler » de concert avec le Messager
magique, mais aussi les scènes d’horreur telle qu’elles
finissent par en être drôles, ainsi au chapitre 32 où Song Jiang
a été fait prisonnier et emmené dans un repaire de brigands qui
s’apprêtent à le trucider pour en manger le cœur, et l’aspergent
d’eau auparavant : « En effet, le cœur humain baignant pour
ainsi parler dans du sang chaud, une aspersion d’eau glacée
dissipe cet excès… cela permet d’arracher le cœur qui sera bien
croustillant, c’est comme cela qu’il est le meilleur. »
L’art du
dialogue lui a semblé relever presque de Molière, par exemple
dans les dialogues de la mère Wang avec Ximen Qing au chapitre
24. Les femmes, en revanche, ne sont guère mises en valeur,
elles sont courtisanes ou adultères (à l’exception de la femme
de Lin Chong qui préfère se pendre plutôt que perdre sa vertu) ;
mais elles peuvent aussi faire des petits pains de chair
humaine, et se montrer aussi cruelles que leurs collègues
masculins une fois devenues guerrières.
[Il y en a
tout un détachement au chapitre 63 : « de vrais tigres » menés
« par une amazone dont les bannières de commandement portaient
en grands caractère d’or… « Vipère d’une toise » (毒蛇)
.
À sa gauche il y avait la grande sœur Gu, la Tigresse (顾大嫂,
母大蟲
),
à sa droite la dame Sun, l’Ogresse (孫二娘,
母夜叉
),
avec plus d’un millier de cavaliers… »]
| |
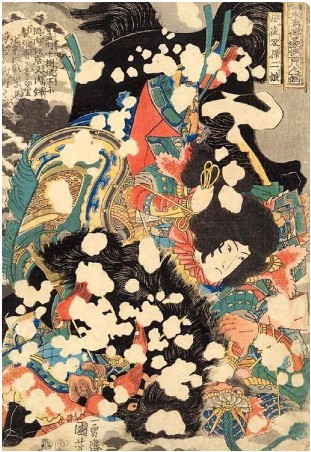
Sun
Erniang, dite l’Ogresse, par Kuniyoshi |
|
Le récit ne
lui a pas semblé révolutionnaire : le seul révolutionnaire, dans
l’histoire, c’est Li Kui, Song Jiang ne rêve que de soumission à
l’empereur. Elle l’a surtout lu comme une dénonciation de
l’arbitraire et des abus de pouvoir, et de la corruption
omniprésente dans la société : elle commence au bas de l’échelle
sociale, le népotisme et l’usage des pots de vin étant ordinaire
à tous les niveaux, y compris dans le système judiciaire et
pénal.
Christiane
a aussi remarqué la place des moines dans le récit de Shi Nai’an
/ Luo Guanzhong, alors qu’ils ont été supprimé de la version de
Jin Shengtan. Ils peuvent être charismatiques, mais aussi
paillards, ce qui est expliqué dans le texte (leur luxure étant
due à leur oisiveté). De manière générale, elle trouve qu’elle
« n’a pas perdu son temps » à se plonger dans la version longue
après la version tronquée de Jin Shengtan.
En parlant de
moines, LLP a trouvé amusant de voir la séance sur les
bandits du Liangshan éclairée par l’actualité : toute la
controverse autour de « la chute vertigineuse » du moine
supérieur du temple de Shaolin, arrêté par la police et démis de
ses fonctions pour « malversations et vie dissolue » comme l’a
titré
Courrier international
fin juillet dernier, à la suite du scandale suscité par son
arrestation.
Ø
Quant à
MRC, il développe la question des techniques d’écriture
à partir des commentaires de Jin Shengtan qu’il a trouvé
très intéressants.
Comme le
rappelle Christiane, Jacques Dars a fait une synthèse de
ces techniques dans son introduction à sa traduction (dans la
version de La Pléiade, pp. CXXVII-CXXIX) : il en dénombre quinze
qui sont autant d’expressions imagées très colorées. Mais MRC
se place d’un autre point de vue ; il distingue deux
dimensions : une dimension macro, où il s’agit de choisir le
sujet de chaque chapitre et de définir les grandes lignes des
caractères des personnages, et une dimension micro pour
déterminer la manière concrète de raconter l’histoire, de
décrire les traits physiques et psychologiques des personnages,
autrement dit de mettre en œuvre de façon précise le plan conçu
au niveau macro.
- Dimension
macro :
d’une part, l’auteur peut choisir ou non de faire des
répétitions (犯
fàn /避
bì
éviter),
mais les répétitions ne sont jamais strictement pareilles, comme
dans le thème du héros luttant contre le tigre : Wu Song le tue
en autodéfense, à mains nues, mais Li Kui avec un sabre, par
colère et piété filiale, parce que le tigre a tué sa mère ;
d’autre part, les personnages sont souvent traités par paires,
pour créer des effets de contraste (Lu Zhishen/Lin Chong, Song
Jiang/Li Kui différents jusque dans la piété filiale), mais
aussi des ressemblances (dans les combats martiaux où les
adversaires sont de forces égales).
- Dimension
micro : ce sont des techniques qui rendent le récit plus fluide
sans attirer l’attention du lecteur. Par exemple : máng zhōng
xián bǐ
(忙中闲笔)
– expression souvent utilisée aussi dans les commentaires sur le
« Rêve dans le pavillon rouge » : lorsque l’intrigue principale
atteint un moment de tension (忙
máng),
l’auteur choisit de ne pas la faire avancer, mais passe à autre
chose et détend ainsi l’atmosphère (闲
xián).
Ainsi au
chap. 10 : Dans la bise et la neige, l’instructeur Lin va au
temple de l’Esprit-de-la-Montagne – dans les granges et
greniers, l’officier Lu allume un incendie
林教头风雪山神庙,陆虞候火烧草料场。
| |
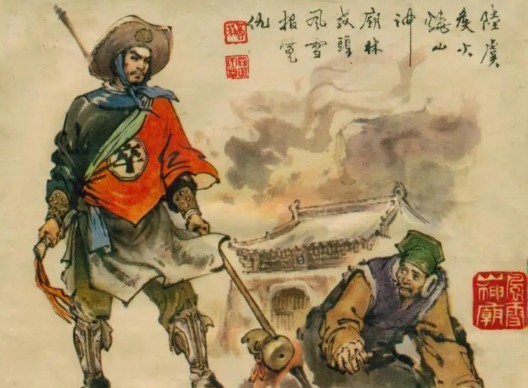
Dans
la bise et la neige, l’instructeur Lin
va au temple de l’Esprit-de-la-Montagne …. |
|
a) Le chapitre
9 se terminait sur le conflit entre Lin Chong et le gouverneur
de la forteresse et le geôlier. Le lecteur brûle donc de savoir
ce qui va arriver à Lin Chong. Or, dès la fin du chap. 9, la
narration bifurque vers un autre personnage rencontré dans la
même prison, Li le Cadet,李小二,
propriétaire d’un cabaret que Lin Chong avait tiré d’un mauvais
pas dans le passé. L’intrigue principale est ainsi suspendue
pour laisser place à une intrigue secondaire. Pourtant, si l’on
poursuit la lecture, on comprend que cette intrigue secondaire
sert en réalité l’intrigue principale. Li surprend dans son
cabaret une conversation entre trois clients qui complotent
contre Lin Chong ; comme il avait bénéficié de la générosité de
Lin Chong auparavant, il lui transmet cette information et ainsi
averti, Lin Chong commence à porter une arme sur lui, ce qui
prépare le terrain pour l’épisode où il tuera ces trois hommes.
Li le Cadet est un personnage dit "fonctionnel" : il intervient
pour faire avancer l’intrigue, puis ne réapparaîtra plus jamais.
b) Cependant,
le récit n’explique pas tout de suite qui sont les trois hommes
et en quoi consiste leur complot. Il passe à des choses
apparemment anodines, et en particulier la grande chute de neige
qui force Lin Chong à se réfugier dans le temple de
l'Esprit-de-la-Montagne… il y a ici un effet de retardement qui
prolonge l’attente et renforce le suspense : autre exemple de
máng zhōng xián bǐ.
Une autre
expression a intrigué MRC car elle revient quatre fois
dans les commentaires de Jin Shengtan :
Du récit
naissent les émotions, des émotions naît le récit
Wén shēng qíng, qíng shēng wén “文生情,情生文”。
(également écrit :
文生于情,情生于文)
MRC
propose
son interprétation : le récit a pour but de susciter des
émotions chez le lecteur comme chez l’auteur ; et ce sont des
émotions qui constituent le premier moteur poussant l’auteur à
écrire ses histoires, tandis que le récit doit rester en accord
avec les émotions des personnages.
Par ailleurs,
en lisant
l’interview de Yan Geling (严歌苓)
par Zhang Guochuan sur chinese-shortstories, MRC a
remarqué qu’elle disait avoir été « influencée par "Au bord
de l’eau", pour sa représentation des personnages
masculins ». Ce qui l’a surpris : est-ce que les mêmes
techniques peuvent servir à décrire les femmes aussi bien que
les hommes ? En fait, dans le Shuihuzhuan, les
descriptions des personnages mettent souvent l’accent sur leur
apparence, leur langage et leur actions, mais on trouve rarement
une introspection psychologique profonde. Ce qui pourrait être
étendu à beaucoup de romans classiques chinois.
Ø
LLP
a
été sensible à l’écriture. Elle avait lu la version Folio à
vingt ans, c’était l’une des ses lectures « fondatrices ». Pour
cette séance du club, elle en a relu 450 pages cet été, mais
avec beaucoup de difficultés. Il faut attendre le chapitre 18
pour voir arriver Song Jiang, selon une narration très
structurée, et qu’il soit présenté alors qu’il est question des
poursuites contre la bande qui a volé les cadeaux
d’anniversaire.
[alors que
l’audience matinale a été close, on attend sa reprise et le
« registreur »,
que l’on voit alors sortir de la préfecture : « Cet homme avait
pour nom Song, pour prénom Jiang, et pour nom social Gong-ming (公明).
C’était le troisième enfant de sa famille… un bomme trapu, au
teint noirâtre, ce pourquoi tout le monde le surnommait Song
Jiang le Noir (黑宋江).
… » Et comme il était généreux et venait en aide aux miséreux et
aux gens en détresse, il était surnommé Pluie-opportune (及時雨).]
LLP
était intéressée par les adaptations au cinéma, et elle a trouvé
le film de
Chang Cheh (张彻)
dans la médiathèque à côté de chez elle : il correspond aux
chapitres 61 à 64, c’est-à-dire essentiellement, après la mort
de Chao Gai (晁盖),
l’histoire de la mystification de Lu Junyi (卢俊义)
la Licorne-de-jade (Yu qilin玉麒麟)
par Wu Yong (吴用)
pour le contraindre à se joindre à la bande du Liangshan grâce à
un stratagème mené de main de maître.
| |

Lu
Junyi la Licorne-de-jade par Kuniyoshi
(dans le film de Chang Cheh, le personnage
est
interprété par un acteur… japonais) |
|
[C’est un film
qui s’intègre particulièrement bien dans l’univers très masculin
de Chang Cheh, et qui mériterait une analyse plus poussée dans
une approche comparative littérature-cinéma. ]
LLP
s’est
particulièrement intéressée au nombre 108, dans ses
divers aspects symboliques. C’est un nombre sacré dans
l’hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme et autres, et en
particulier dans la cosmologie védique. Le 1 représente une
chose, le 0 rien, et le 8 l’infini, ce qui
représente la totalité de la réalité de l’univers : les
divinités ont ainsi 108 noms et les chapelets rudrakshas comme
ceux ornant le cou de Shiva ont 108 grains, comme les chapelets
mani tibétain qui ont 9 perles mais 108 (12x9) dans leur
version mala. 108 est le nombre d’étoiles sacrées dans
l’astrologie chinoise (zhan xing shu
占星术)
dont le principe est d’associer un tronc céleste et une branche
terrestre pour déterminer une année, un mois ou un jour ; dans
le bouddhisme tibétain, la voie du nirvana est pavée de 108
tentations. Mais 108 est aussi le nombre… des prétendants de
Pénélope dans l’Odyssée.
Elle a été
frappée de voir que tout commence par le serment des gardes
assignés à la protection du convoi du cadeau d’anniversaire,
serment d’aide mutuelle et de loyauté qui rappelle le serment
des trois frère jurés au Jardin des pêchers (地桃园结义)
au début du « Roman
des Trois royaumes » (Sanguo Yanyi《三国演义》),
d’ailleurs attribué lui aussi à Luo Guanzhong. Mais cela
rappelle aussi l’Iliade et le « serment de Tyndare », père
d’Hélène qui sacrifia un cheval et fit monter les prétendants de
sa fille sur sa peau pour prêter le serment solennel de porter
secours à celui qui serait choisi si quiconque tentait de lui
ravir son épouse ; c’était pour éviter une guerre entre eux,
mais c’est justement ce serment qui a provoqué la guerre de
Troie.
Les nombreux
surnoms des bandits, en lien avec un astre, lui ont donné
l’impression d’un récit mythologique. Mais peut-on parler de
mythologie ? Comment définir le roman ?
C’est un sujet
qui a déclenché un débat qui s’est conclu par la négative : non,
il est fait appel à des éléments mythologiques, surtout au
début, dans le récit-cadre qui introduit l’histoire, mais le
roman n’est ni mythologique, ni d’ailleurs une épopée. C’est ce
que Lu Xun appelle « la tradition des récits légendaires » à
partir des Song du Sud (南宋以來流行之傳說)
et qu’il range dans sa « Brève histoire du roman chinois » (《中国小说史略》)
parmi les « romans historiques » des Yuan et des Ming (Chapitre
15/II
第十五篇 元明傳來之講史(下)).
On est donc dans le domaine de la légende sur fond de récit
historique (ou vice versa).
[Voir en
complément :
Mythe, légende, épopée … et roman classique dans la tradition
chinoise
].
Enfin, de la
même manière que le roman trouvait un écho dans l’actualité du
procès du chef du temple de Shaolin, elle le voit de même
conserver une charge subversive aujourd’hui. Car le thème
central est celui de la loyauté. Cette même
loyauté à toute épreuve que le Parti communiste réclame pour
lui. Et la dénonciation, dans le roman, de la corruption
généralisée du pouvoir comme de la société qui pousse
les bandits dans la rébellion trouve aussi son écho dans la
lutte anti-corruption menée par le président actuel.
En fait, le
Shuihuzhuan comporte une double thématique : celle de la
subversion par des rebelles poussés à la révolte par les
injustices dont ils sont victimes, mais aussi celle de l’ordre
et de sa nécessité, l’ordre qui prévaut dans l’assemblée des
bandits, dans le respect d’une stricte hiérarchie
et dans une parfaite discipline sur le champ de bataille. C’est
la thématique de la rébellion qui a fait que le roman a été
longtemps interdit, chaque fois que le régime impérial se
trouvait menacé, par des révoltes justement ; c’est aussi ce qui
en a fait un modèle révolutionnaire pour Mao.
Mais c’est l’ordre, finalement, qui est principalement retenu
aujourd’hui.
Le débat sur
ce sujet se conclut par la remarque finale de MRC : le
Shuihuzhuan n’est pas interdit en Chine aujourd’hui, au
contraire ; il est considéré comme un modèle qui propose une
vision très traditionnelle d’organisation hiérarchique, et
autocratique, du pouvoir, et en ce sens anti-démocratique.
Ø
UB
avait déjà lu le roman et a pris plaisir à s’y replonger,
retrouvant la fluidité de la narration, une construction
progressive avec une focale sur divers personnages, d’un
personnage à l’autre, finissant par cette zone de non-droit où
tous finissent par se retrouver. C’est un texte « sans gras »,
qu’il a lu en passant du chinois à la traduction de Jacques Dars
pour progresser un peu plus vite, et en revenant au chinois,
chinois vernaculaire avec des incidences de dialecte du Shandong
et de langue de wu.
Ce qu’il a
trouvé de nouveau, c’est que l’empereur Song Huizong (宋徽宗),
connu pour son art raffiné, est l’un des personnages du roman,
qui se passe vers 1120. En revanche, il a trouvé que les
personnages féminins sont sans profondeur, contrairement à ceux
du Jinpingmei (《金瓶梅》)
qui sont au contraire pleins de vie et d’originalité ; on y
retrouve Pan Jinlian (潘金莲)
et Ximen Qing (西门庆),
mais Pan Jinlian occupe une place centrale.
Le
Shuihuzhuan est surtout une satire de la nature mafieuse du
pouvoir ; en fait il n’y a pas de différence marquée entre
pouvoir et brigandage, on passe de l’un à l’autre constamment et
sans hiatus, et il y a une reconnaissance mutuelle, un respect
des uns pour les autres. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que
le saint patron des policiers (à Hong Kong) est le guerrier Guan
Yu (关羽),
immortalisé dans le « Roman des Trois royaumes » et divinisé
quelques siècles après sa mort.
Pour la petite
histoire, UB s’est demandé comment tous ces bandits
pouvaient boire autant : ils sont constamment en train de
festoyer, et de boire. Mais l’alcool du roman, d’après ce qu’il
a pu lire, n’est pas de l’alcool de riz, c’est de l’alcool de
blé ou de millet, qui n’a donc pas la même teneur d’alcool.
[D’ailleurs
les gens du Shandong sont réputés pour boire beaucoup, par
obligation sociale, en quelque sorte. Ce que confirme
Guochuan qui est du Shandong et cite cette expression
typique de la province :
“大碗喝酒,大块吃肉”
dà wǎn hējiǔ, dà kuài chīròu
(litt. ) Boire
de l’alcool à grands bols, manger de la viande à gros morceaux
Ce qui
s’applique parfaitement à ces valeureux guerriers, dit-elle,
toujours à festoyer. ]
Ø
Lei
n’était pas très attirée par le roman quand elle était jeune. En
fait, parmi les quatre grands classiques chinois, y compris
toutes leurs adaptations, c’était celui qui l’intéressait le
moins. Elle avait l’impression que ce n’était que des histoires
violentes de combats et de tueries. Mais, comme il s’agit d’un
chef-d’œuvre incontournable, les séries adaptées du roman
passaient à la télévision presque tous les étés et hivers quand
elle était en maternelle et au collège ; de plus, dans la vie
quotidienne ou à l’école, les gens en parlaient, et en parlent
toujours, très souvent. Peu à peu, elle s’est donc familiarisée
avec les histoires célèbres et les personnages marquants.
Ce qu’elle
aime particulièrement, ce sont les surnoms des cent huit
héros. Ils sont à la fois imagés, vivants, et correspondent au
caractère et au destin de chacun. Beaucoup sont connus de tous
en Chine : « Song Jiang, la Pluie opportune » (宋江,及时雨),
« Chai Jin, le Petit Ouragan » (柴进,
小旋風), «
Lu Zhishen, le Moine fleuri » (鲁智深,
花和尚), «
Lin Chong, la Tête de léopard » (林冲,
豹子头),
etc. On les mentionne presque toujours avec leurs surnoms.
D’autres surnoms sont devenus si célèbres qu’ils sont encore
utilisés comme expressions figées aujourd’hui, alors même que
les personnages qui les portent ne sont pas forcément très
connus. À titre d’exemple :
拼
命 三 郎
« le Fou prêt à mourir » (Shi Xiu
石秀) est
désormais une expression pour désigner quelqu’un qui se donne
corps et âme, qui est prêt à se sacrifier pour atteindre un
objectif ;
笑面虎
« le Tigre au visage souriant » (Zhu Fu
朱富) est
utilisé pour parler d’une personne qui semble aimable mais cache
de mauvaises intentions. Enfin, certains personnages sont
extrêmement célèbres sans faire partie des cent huit, comme Pan
Jinlian, devenue figure récurrente de nombreuses œuvres
littéraires et audiovisuelles.
Elle a relu le
roman en se concentrant sur les personnages qui l’intéressent le
plus (Chao Gai, Lin Chong, Song Jiang, Wu Song, Chai Jin, Wu
Yong), y compris les personnages féminins (Yan Poxi, Sun
Erniang, Hu Sanniang), en se demandant qui sont les 108 héros et
à quels astres ils sont associés, pourquoi Song Jiang a été
choisi comme chef, si l’œuvre dénigre les femmes, quelles sont
les relations avec « Les trois royaumes », et en réfléchissant
sur les problèmes sociaux soulevés dans le roman et leurs échos
aujourd’hui.
-1/ De manière
générale, elle apprécie beaucoup la manière dont sont dépeints
les personnages, et la grande beauté littéraire de ces
descriptions. Dès le début, la mise en place des « 36 Esprits
célestes » et des « 72 Démons terrestres » donne à l’ouvrage une
aura mystérieuse. Elle a trouvé que le destin de certains
personnages correspondait parfaitement à l’astre qui leur était
attribué. Par exemple, Chai Jin est « l’Étoile précieuse du
Ciel » (Tiangui xing
天贵星) :
issu d’une famille impériale, il est né riche et noble, et son
destin dans le roman est l’un des plus favorables.
Parmi les
héros du Liangshan, celui qu’elle apprécie le moins reste
Song Jiang. Même après cette relecture, son avis n’a pas
changé. Elle continue à trouver que son personnage n’est pas
très convaincant : il n’est ni le plus riche, ni le mieux né, ni
le plus haut placé dans la fonction publique avant sa rébellion,
ni le plus habile au combat. Surtout, il ne dégage pas de
véritable charisme de chef : il est hésitant, parfois lâche, et
souvent calculateur et hypocrite. Pourtant, chaque fois qu’il
apparaît dans le roman, c’est accompagné tout de suite d’une
aura universelle, comme si tout le monde le connaissait et
l’admirait. En réalité, il n’était au départ qu’un simple
greffier. Son surnom de « Pluie opportune » vient de ce qu’il
aidait généreusement quiconque se trouvait en difficulté, même
des inconnus. Mais d’où provenait donc sa fortune ? De plus,
nombre de ses erreurs de jugement ont causé de graves pertes
parmi les membres du groupe. Pour Lei, il ressemble au
moine Tang Sanzang dans le Xiyouji ou à Liu Bei dans les
Trois Royaumes : des personnages vertueux mais hésitants et
timorés. Pas ce qu’elle apprécie le plus.
Son personnage
préféré est Chai Jin (柴进),
qui semble également être l’un des favoris de l’auteur. Issu
d’une lignée impériale, il est généreux, intelligent, posé et
d’une grande droiture. Nombre de héros, y compris Song Jiang,
ont bénéficié de sa protection à leurs débuts. Pourtant, Chai
Jin ne s’en vante jamais. Plus tard, il occupe une fonction
importante au Liangshan qu’il accomplit avec sérieux. Lors de la
campagne contre Fang La, il devient même gendre impérial et
contribue à la victoire finale contre le bandit. À la fin, alors
que beaucoup de héros meurent après l’amnistie, il fait partie
des rares à pouvoir se retirer en paix et à revenir à une vie
discrète. En revanche, elle trouve particulièrement regrettable
le destin de Chao Gai (晁盖),
le « roi céleste » (晁天王)
: homme de grande valeur, il a apporté une contribution non
négligeable, mais il meurt tôt, d’une flèche empoisonnée, et il
n’apparaît pas dans le décompte des cent huit héros
Quant à la
représentation des femmes, il est indéniable qu’elle
comporte une part de mépris, voire de dénigrement. Beaucoup de
personnages féminins sont décrits comme vulgaires, lubriques, ou
de basse condition (souvent prostituées ou chanteuses), et
finissent tragiquement, souvent de façon violente. Pourtant, il
existe aussi des héroïnes, comme Hu Sanniang (扈三娘)
ou Fang Jinzhi (方金芝),
fille du rebelle Fang La. Elles sont courageuses, loyales et
redoutables au combat, dignes des héros du Liangshan. De plus,
l’auteur décrit leur beauté avec des louanges appuyées.
Comparées à la condition des femmes de l’époque, généralement
confinées à la maison, ces représentations étaient très en
avance. Même si « Au bord de l’eau » est essentiellement un
roman masculin, on y recense tout de même entre soixante-dix et
quatre-vingts personnages féminins.
| |

Hu
Sanniang par Utagawa Kuniyoshi |
|
- 2/ Lei
a par ailleurs trouvé des résonances et des parallèles
avec d’autres romans classiques :
- des
parallèles avec « La Pérégrination vers l’Ouest » (Xiyouji
《西游记》).
L’histoire des héros du Liangshan, qui suivent Song Jiang pour
franchir mille épreuves, établir leur repaire, défendre la
justice et combattre le mal, n’est pas sans rappeler Sun Wukong
et ses compagnons protégeant Tang Sanzang dans sa quête. Mais il
y a aussi des détails parallèles : les 72 transformations de Sun
Wukong sont appelées les « 72 métamorphoses des Démons
terrestres », tandis que Zhu Bajie maîtrise les « 36
transformations des Esprits célestes » - bien que Sun Wukong ait
de nombreux talents, sa magie est en réalité plus faible que
celle de Zhu Bajie, ce qui correspond à leur origine respective
: Sun Wukong n’était qu’un singe sauvage, tandis que Zhu Bajie
avait été maréchal des armées célestes.
- et des
résonances avec des personnages du « Roman des
Trois Royaumes ». En lisant, Li Kui, Lu Zhishen et Lin Chong
lui rappelaient Zhang Fei – d’ailleurs l’un des surnoms de Lin
Chong est « Petit Zhang Fei » (小张飞),
Wu Yong et Chai Jin lui évoquaient Zhuge Liang, et Song Jiang
lui semblait un autre Liu Bei. Guan Sheng (关胜)
est présenté dans le roman comme un descendant de Guan Yu (关羽)
et il lui ressemble. Lü Fang (吕方),
quant à lui, a des similarités avec Lü Bu (吕布),
même cheval, même arme, d’où son surnom de « Petit marquis de
Wen » (小溫侯).
Mais rien de très étonnant : Shi Nai’an était le maître de Luo
Guanzhong auquel est attribué « Le roman des Trois Royaumes »,
qui aurait été écrit après « Au bord de l’eau » ; certains
disent même que Luo Guanzhong aurait poursuivi l’écriture de Shi
Nai’an.
Mais Lei
a également trouvé des échos du Shuihuzhuan dans
la société actuelle. Car, si « Au bord de l’eau » met en
avant la fraternité chevaleresque, il dénonce aussi les
défaillances du système judiciaire qui poussent les innocents à
la rébellion. On y voit des paysans ou des fonctionnaires,
victimes d’injustices, réduits à une impasse et contraints de se
révolter par la violence. Cela fait penser à certaines
situations dans la société chinoise contemporaine. Derrière ces
récits transparaissent des questions profondes sur les
institutions sociales et judiciaires, ainsi que sur les
faiblesses humaines. Ces problèmes ont-ils reçu une attention
suffisante ? Quelle influence « Au bord de l’eau » pourrait-il
exercer sur la Chine d’aujourd’hui et de demain pour que ces
questions soient mieux prises en compte ?
Telles sont
les réflexions que lui a inspirées cette lecture et qu’elle voit
reflétées dans la société chaque fois qu’elle revient chez elle
en Chine, en particulier chez les jeunes en échec scolaire,
rejetés par la société et l’école, et qui n’ont d’autre choix
que la révolte. Ils forment des groupes liés, comme les héros du
Liangshan, par l’amitié fraternelle et la loyauté à toute
épreuve (zhōngyì
忠義/忠义).
Au total et en
conclusion de cette longue séance : « Au bord de l’eau »
apparaît comme le miroir d’une société figée entre stricte
hiérarchie du pouvoir et rébellion latente parmi les oubliés et
victimes du système.
Prochaine
séance
Le mercredi
15 octobre 2025
Autres
histoires de bandits, par
Jia Pingwa
(贾平凹) :
- Le porteur
de jeunes mariées, trois nouvelles de 1990, trad. Lu Hua, Gao
Deku, Zhang Zhengzhong, Stock, coll. « La bibliothèque
cosmopolite », 1995/1998 :
Le porteur de
jeunes mariées Wǔkuí《五魁》/
Le Tout-Blanc Bái Lǎng《白朗》/
Le géomancien
amoureux Měi xué dì
《美穴地》
En lien,
l’adaptation de Wǔkuí par
Huang Jianxin (黄建新) :
« The Wooden Man’s Bride » (《五魁》),
1994.
Et
éventuellement, sur le banditisme moderne :
-
Broken Wings (Jihua《极花》),
trad. Nicky Harman, ACA Publishing, 2019 (Jia Pingwa 2016).
Kuhn a
commencé à traduire la littérature chinoise classique
après la Première guerre mondiale.
Avant
le Shuihuzhuan, il a traduit le Hongloumeng
(« Der
Traum der roten Kammer »,
Leipzig 1932).
蟲/虫
signifie littéralement ‘insecte’, voire ‘serpent’, mais
est à entendre ici comme euphémisme littéraire pour
signifier ‘tigre’. C’est elle qui fabriquait les petits
pains farcis à la chair humaine avec son mari.
|
|

