|
Club de lecture de littérature
chinoise (CLLC)
Compte rendu de la séance du 11
décembre 2024
et annonce de la séance suivante
par Brigitte
Duzan, 17 décembre 2024
À la suite de
la
séance du 13 novembre
consacrée à
Qian Zhongshu (钱钟书)
et en particulier à son roman « La
Forteresse assiégée » (Wéichéng《围城》),
la séance du 11 décembre était consacrée à l’œuvre de son épouse
Yang Jiang (杨绛),
avec au programme :
- Le Bain (《洗澡》),
trad. et introduction Nicolas Chapuis, Christian Bourgois, 1992.
| |
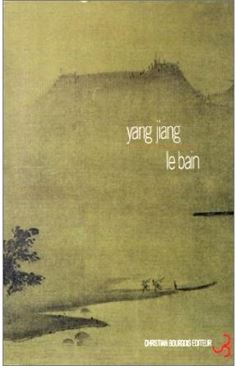 |
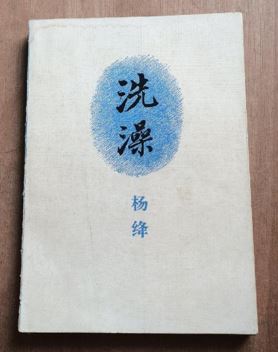
Le
Bain, édition originale 1988 |
Texte
chinois :
https://www.tianyabooks.com/book/yj01/
- Mémoires
décousus (souvenirs tirés du recueil d’essais《杂忆与杂写》),
trad. Angel Pino et Isabelle Rabut, Christian Bourgois, 1997.
- Sombres
nuées, chronique des années Bing Wu et Ding Wei (《丙午丁未年纪事》),
trad., introd. et notes d’Angel Pino, Christian Bourgois, 1992.
Texte
chinois :
https://xiandangdai.xiusha.com/y/yangjiang/000/015.htm
La séance a
fait ressortir – à une exception près – combien Yang Jiang
suscite toujours d’admiration chaleureuse, encore aujourd’hui,
huit ans après sa mort, à l’âge canonique de 105 ans. Sa voix
calme et son humour distancié, dans « Le Bain » autant que dans
ses essais, ont été finalement bien plus appréciés que les
piques à répétition de « La Forteresse assiégée ». Il faut dire
en outre que ses ouvrages sont servis en français par de très
bonnes traductions – comme souligné par plusieurs lectrices (en
particulier celle, bien annotée, du « Bain » de Nicolas
Chapuis).
Le plus bel
éloge vient de Marion J. qu’on n’avait pas vue depuis
quelques temps : elle dit avoir traversé une période de
« jachère de lecture », et c’est « Le Bain » qui a réussi à l’en
sortir !
Avis de
lecture
Ø
W.
Lei
a ouvert la séance, justement, par un hommage personnel à Yang
Jiang, qui est l’une de ses écrivaines favorites et même,
au-delà de ses œuvres littéraires, un modèle : modèle de
sagesse, de tolérance et de sérénité malgré les souffrances
qu’elles a traversées tout au long de sa vie, pour atteindre
finalement à la liberté intérieure.
W. Lei
avait lu in extenso, en chinois, outre « Le Bain », les deux
tomes de ses « Mémoires décousus » qui ont été réédités en Chine
en 2015 : les textes de la période 1933-1991 et ceux de la
période suivante 1992-2013
.
Ces textes l’ont confirmée dans sa vision de la personnalité de
l’écrivaine (elle en a
sélectionné et traduit quelques extraits
pour le
club de lecture). Et cette personnalité, justement, se reflète
dans son écriture, autant dans la forme que dans le fond :
style » doux et fluide comme l’eau », débordant de chaleur
humaine, vivant, dynamique et empreint d’humour, avec une
préférence pour les phrases courtes, claires et faciles à lire.
Contrairement à ce que l’on dit parfois, son écriture n’a rien à
envier à celle de Qian Zhongshu – pour preuve, en particulier,
l’essai intitulé « Vent » (《风》)
des « Mémoires décousus (1933-1991) ».
Elle a trouvé
les personnages très nuancés, et les classe en trois
catégories :
- la
famille, et le père, en particulier, à l’esprit très
ouvert pour son époque, soutenant sa fille célibataire. Les
pages sur la jeune sœur Yang Bi (《记杨必》),
tôt disparue, sont pour elle parmi les plus émouvantes des
« Mémoires décousus ». C’est son personnage préféré, avec Yao Mi
(dans « Le Bain »), tellement semblable qu’elle lui semble en
être inspirée.
- les
intellectuels : ceux du « Bain » présentent de
nombreuses similitudes avec ceux de « La Forteresse assiégée »,
mais Yang Jiang ne se limite pas à des portraits négatifs, elle
met aussi en lumière des traits positifs (l’indépendance et
l’intelligence pour Yao Mi, la droiture et la sincérité pour Xu
Yancheng, l’enthousiasme pour Luo Hou). En outre, dans « Le
Bain », elle met en valeur les personnages féminins,
avec des caractères bien campés (Yao Mi et sa mère, Du Lilin,
Wang Ying, ou encore Shi Nina)
- les
gens du peuple, pauvres et malchanceux, nombreux dans
les « Mémoires décousus », sont dépeints avec compassion et une
grande chaleur humaine. Ils sont aussi vivants qu’attachants
sous sa plume.
W. Lei
a aussi beaucoup apprécié la manière qu’a Yang Jiang de traiter
les épisode historiques dans ses récits. En dehors
de la peinture de la vie quotidienne, ses œuvres tournent autour
d’événements historiques durs et éprouvants : les campagnes des
Trois et des Cinq antis, la Révolution culturelle, l’envoi des
intellectuels à la campagne pour la réforme par le travail, et
la guerre. Cependant, elle aborde ces moments de l’histoire
marqués par la souffrance avec une légèreté teintée d’humour.
Elle permet ainsi aux lecteurs de découvrir des histoires
intéressantes et des personnages attachants dans un contexte
pourtant douloureux – ainsi, quand elle décrit la vie rurale et
les paysans dans son chapitre « Première fois envoyée à la
campagne » (《第一次下乡》)
des « Mémoires décousus », l’expérience devient à la fois légère
et amusante.
Dans la
troisième partie du « Bain », la description de la
campagne des Trois anti est pleine d’humour. Pourtant,
dans la réalité, ces expériences ont été profondément
éprouvantes. Par exemple, le suicide de Zhu Qianli dans le roman
est inspiré des suicides réels de plusieurs amis proches de Yang
Jiang. Malgré cela, la tentative de suicide de Zhu Qianli est
décrite avec un humour qui rend la scène presque burlesque. De
même, la guerre est, elle aussi, abordée avec
légèreté, sans descriptions dramatiques de chaos, de souffrance
et de désespoir, et en ce sens Yang Jiang se rapproche de la
manière dont ce thème est traité dans « La Forteresse
assiégée ».
Ø
MRC
apporte la note discordante de la séance : il a lu « Le Bain »
en chinois et parcouru sur internet les articles et forums
concernant le roman et son auteur, mais il s’est lassé de sa
lecture au milieu du roman.
- Concernant
la forme, il a trouvé une forte similitude de style (en chinois)
entre le roman de Yang Jiang et celui de Qian Zhongshu, mais
sans les « satires mordantes », références et allusions
multiples de « La Forteresse assiégée ». A travers leurs
livres, on peut deviner – dit-il – qu’ils vivent dans le même
environnement. C'est comme si deux personnes parlaient devant
nous : on peut sentir qu'elles viennent sans doute de la même
région et exercent la même profession.
- Pour le
fond, en lisant l'histoire d'amour et la description physique
des personnages du « Bain », il a senti une écriture plus
féminine que dans « La Forteresse assiégée ». La représentation de l'amour entre Yao Mi et Xu Yancheng lui a
semblé plus tendre et subtile et la description physique des
personnages moins unidimensionnelle, car présentée sous des
angles plus variés. Ce qui nécessiterait des exemple précis, il
s’agit là juste d’une impression après lecture. Mais il retrouve
dans la description du couple Xu Yancheng/Yao Mi certaines des
caractéristiques du couple Qian Zhongshu/Yang Jiang, souvent
présenté comme modèle : amour et admiration réciproques avec un
espace de liberté mutuelle.
- S’il devait
résumer le style de Yang Jiang, ce serait par le terme chinois
de dàn
淡.
Terme généralement traduit par « fade », impliquant un style
plat, comme une peinture diluée ou pâle, mais qui peut avoir en
chinois des connotations positives (sobre, serein… ).
Cela vient de la représentation des personnages, aux
personnalités peu marquées, dont les conflits ne lui ont pas
laissé une impression profonde. Ce n’est pas seulement en raison
de la lenteur du rythme narratif. Ce n’est pas quelque chose qui
lui déplaît a priori, mais il aime les romans traditionnels
chinois qui accordent beaucoup d'importance à des intrigues
riches en rebondissements. Il cite le dicton chinois: « Un roman
est comme une montagne, il ne doit pas être plat pour plaire » (文似看山不喜平).
Il lit beaucoup « Les Trois Royaumes » et « Au bord de l’eau »
en ce moment, et il préfère la complexité et les rebondissements
de leurs intrigues. Provisoirement, ajoute-t-il…
Ø
LLP
apporte le témoignage vivant qu’il peut y avoir une lecture
« provisoire » du « Bain » : elle commence par dire qu’elle non
plus n’a pas lu le roman jusqu’à la fin, car trop lent, trop
ceci … pas assez cela… et au fur et à mesure qu’elle déroule ses
arguments, elle réalise elle-même toute la subtilité qu’elle
avait bien perçue, mais comme inconsciemment. Pour conclure,
toute étonnée elle-même, que ce sont les qualités mêmes
d’écriture qui l’ont rebutée au départ et que cela lui donne en
fin de compte terriblement envie de terminer sa lecture –
d’autant plus qu’en chinois, le roman est accessible et agréable
à lire.
Yang Jiang
décrit en effet très subtilement la mise au pas des
intellectuels après 1949, par petites touches, sans fracas. Elle
montre cette progression lente à travers des anecdotes de la vie
quotidienne d’une bande de lettrés, inspirées par sa propre
expérience en tant que professeur de littérature britannique à
Qinghua en 1949 ou au sein du groupe
des langues étrangères de l’Institut de recherche en Littérature
(文学研究所外文组)
de l’Académie chinoise des Sciences sociales (après 1952). Elle
retranscrit ainsi l’avancée inexorable de l’idéologie communiste
dans le milieu intellectuel après 1949 dans un département de
littérature dite « bourgeoise » auprès d’intellectuels
fraîchement revenus de pays occidentaux « capitalistes », qui
seront les premières victimes des purges du régime. C’est la
chronique d’un drame annoncé. Elle montre les inflexions
minuscules, les changements de tons et de lexique, de postures,
la constitution des clans, la versatilité des allégeances, les
changements de valeurs, toute une tectonique des plaques en
narrant l’insignifiant, l’infiniment petit de la vie quotidienne
de ces professeurs où l’idéologie et les travers communistes
infusent progressivement.
Le langage change aussi progressivement, la marxisation des noms
« réformés » rappelant la rectification des noms (正名)
de Confucius autant que la rectification de Yan’an. Ce n’est
qu’au début de la deuxième partie que l’on voit les
procommunistes s’emparer des postes à responsabilité, même s’ils
n’ont pas les compétences requises, l’idéologie primant le
reste. Telle Shi Nina bombardée directrice du département de
littérature étrangère alors qu’elle a attribué « Le rouge et le
noir » à Balzac et « Les Fleurs du mal » à Mallarmé… Le champ
lexical communiste (y compris les invectives) est de plus en
plus présent, tandis que l’origine de classe devient un
problème, que disparaissent les « vêtements anciens » et qu’il
faut cacher les livres. On voit peu à peu s’instaurer une
logique perverse fondée sur la surveillance mutuelle des uns et
des autres, les dénonciations justifiant les enquêtes sauvages.
LLP
voit
finalement dans la lente dissection de ces mécanismes insidieux
une véritable « prouesse littéraire ». La satire du système
communiste est subtile dans sa prudence même,
les plus fervents défenseurs de
l’abolition des privilèges ne font qu’en créer de nouveaux dont
ils deviennent les heureux bénéficiaires. Yang Jiang met en
scène des communistes qui se veulent modernes mais qui ne font
que reproduire les normes confucéennes dont ils sont pétris :
lors de la constitution des groupes de travail, ils s’accordent
sur une organisation fondée sur le binôme « maître-disciple »
(2ème partie, p. 126).
Elle a retrouvé dans « Le Bain » des traits du roman de Qian
Zhongshu : le diplôme étranger de Xu Yancheng obtenu dans une
université fantoche (comme Feng Hongjian), les propos oiseux et
discours creux, la vacuité du badinage en totale déconnection du
contexte historique gravissime, la mauvaise foi des
intellectuels, leur opportunisme, leur paresse, leur
malhonnêteté intellectuelle et leur lâcheté… En déroulant tous
ces arguments, elle souligne la qualité du texte, sa progression
narrative toute de lenteur voulue, reflétant l’étroitesse des
existences de ces intellectuels revenus de l’étranger.
Plus que Qian
Zhongshu, Yang Jiang livre en outre une réflexion critique sur
la place de la femme dans la société en en
dénonçant les travers misogynes tout en montrant les femmes bien
plus « dégourdies » que les hommes sur le plan pratique. Les
petites filles, on le sait, sont considérées comme enfants de
second ordre (« Yancheng n’éprouvait pas le moindre intérêt à
l’égard de cette fille qu’il n’avait jamais vue »), mais en
outre ces intellectuels ont des attitudes déplacées, voire
grivoises. Yu Nan est même dépeint comme un « parfait obsédé »
(p. 79). Yao Mi considérée comme « aguicheuse » aux yeux de
Yancheng rappelle la Lolita du roman de Nabokov (publié à Paris
en 1955)… Le
récit qu’elle fait de la tentative de viol de son fiancé
frustré, qu’elle repousse avec une « paire de ciseaux à
ongles » (p. 111), évoque le fait divers de 2009 repris par
Jia Zhangke en 2013 dans « A
Touch of Sin » (《天注定》)
(où une hôtesse d’accueil dans un sauna finit par poignarder
avec un couteau à dessert un cadre local qui tentait de la
violer).
Donc,
finalement, dit-on à LLP, tu as apprécié le roman bien plus que
tu ne disais au départ….
Eh bien, oui,
dit-elle, cela m’a donné envie de le lire jusqu’au bout,
d’autant plus que le texte chinois est agréable à lire…
Ø
Zh.
Lingling
poursuit dans le même sens. Elle avait lu « Nous trois » (《我们仨》)
quand elle était au lycée. Ce sont les souvenirs de leur vie,
elle, son mari et sa fille, publiés par Yang Jang en 2003, et
Lingling se rappelle avoir pleuré quand Yang Jiang décrit la
mort de de sa fille (en 1997), puis celle de son mari (en 1998)…
« Le Bain » ne
l’a pas fait pleurer, mais elle a retrouvé dans le roman le
style délicat de l’auteure, son art de raconter avec détachement
les malheurs de la vie, mais en soulignant toujours les côtés
positifs. Sans doute parce que, ayant reçu beaucoup d’amour dans
sa vie, Yang Jiang en avait gardé un esprit paisible, au-dessus
des malheurs,, jusque dans sa vieillesse. « Le Bain »,
Lingling y est entrée tout de suite, dès le début de sa
lecture, en le trouvant bien plus facile à lire que le roman de
Qian Zhongshu. C’est volontairement « plat », dàn comme
l’a dit MRC, mais le style est soutenu, cultivé, c’est
wěi wěi dào lái (娓娓道来),
dit-elle : subtil et raffiné, dont on ne se lasse pas.
Et puis, elle
a découvert dans la troisième partie du roman la signification
du « Bain » (洗澡)
qu’elle ne connaissait pas, et qui est très peu connue, car
c’est une spécificité de la campagne dont il est question à la
fin du roman : double campagne, des « trois antis » en 1951,
complétée par les « cinq antis » en 1952 (三反五反), visant
à consolider le pouvoir de Mao en ciblant ses opposants
politiques et les « capitalistes ». Mais Yang Jiang distingue
avec humour trois types d’opposants ayant à passer par trois
sortes de « bain », petit, moyen et grand, selon leur statut
social et leur autorité, pour en ressortir lavés et purifiés
.
Ce qui l’a surtout frappée, ce sont les subtilités de
l’autocritique : il faut savoir rester dans le juste milieu car
si on exagère ou si on n’en dit pas assez, ce ne sera pas
accepté. Il y a donc des gradations dans l’autocritique pour
rester crédible.
Ø
Dorothée
MS est entrée tout de suite dans le roman, avec un grand
plaisir, en savourant les histoires du travail et celles des
couples, entre mesquineries et rivalités. Mais aussi certains
détails qui l’ont ramenée au temps présent – ainsi (p. 21)
a-t-elle constaté que l’on donnait déjà des postes honorifiques
à l’UNESCO à l’époque, ce qui a contribué au fil du temps à tuer
cet organisme…
Elle a quand
même trouvé que le récit traînait un peu en longueur, mais son
intérêt s’est ravivé dans la dernière partie et elle a beaucoup
aimé le récit des confessions forcées. Le roman a fini là par
l’émouvoir.
Ø
Sylvie
D. a commencé par lire « Sombres nuées » et a apprécié
dans ces sept brefs récits la capacité de l’auteure à apporter
une vision sereine et positive de situations pourtant horribles
– en particulier l’épisode de la confiscation du manuscrit de sa
traduction du « Don Quichotte » et de ses efforts pour le
retrouver.
Elle s’est
ensuite plongée dans la traduction des seize textes tirés des
« Mémoires décousus » et les a appréciés comme des « petites
merveilles ciselées ». Elle a beaucoup aimé la peinture des
personnages, et les scènes de vie comme un puzzle, avec une
touche d’émotion larvée, car ce sont des vies toujours un peu
dérisoires. Ainsi cette madame Lin du deuxième récit :
blanchisseuse consciencieuse, qui s’occupe de sa belle-mère,
pousse son fils à faire des études secondaires, et élève la
fille de sa belle-sœur, qui économise jusqu’à pouvoir s’acheter
une maison… réquisitionnée pendant la Révolution culturelle,
puis rasée… toujours travaillant et économisant, construisant
une maison pour son fils, puis pour sa fille… et finalement
tombant malade, et mourant à l’hôpital sans même que sa fille se
soit déplacée.
« Le Bain »
lui a semblé plus difficile à suivre, et elle a un peu décroché.
Elle a surtout aimé le début, le récit de la création du Centre
d’études dont elle a trouvé l’atmosphère semblable à celle de
l’université Sanlü dans « La Forteresse assiégée ».
Ø
Françoise
J. a lu « Sombres nuées » en trouvant pénible d’avoir les
notes à la fin du livre, et encore plus pénible de ne pas avoir
d’appel de notes. Ce qui ne l’a malgré tout pas empêchée
d’apprécier ces textes empreints de délicatesse et d’un « grand
poids d’humanité » (en particulier dans le texte des « agneaux
déguisés en loups »), avec l’impression de rencontrer une
personne modeste et simple, d’une extrême bienveillance.
Quant au
« Bain », elle en a bien plus apprécié le style que celui du
roman de Qian Zhongshu. Aucune lourdeur chez Yang Jiang : elle
procède par petites touches bien plus légères, et en outre la
construction de son roman, en trois parties, est bien
équilibrée. Elle montre l’adaptation graduelle des personnages
dans leurs recherches, les jalousies et rivalités, comme dans
« La Forteresse assiégée », mais avec une montée en charge
progressive.
Ce qui l’a
frappée, c’est la description des rapports humains, sans
distinction entre vie privée et vie publique. Cela tient
évidemment au fait qu’il n’y a pas de différence entre lieu de
vie et lieu de travail, donc pas de rupture entre vie et
travail, donc pas de vie personnelle, au point que l’on peut
tranquillement aller fouiller dans les papiers de quelqu’un
d’autre, et qu’il n’y a pas non plus de notion de bibliothèque
privée.
Ø
Giselle
H. a lu « Le Bain » avec plaisir car elle en a trouvé la
lecture facile et agréable. Mais elle a aussi trouvé très
intéressante la description de la campagne des Trois antis, des
luttes et des débats qui l’ont accompagnée. La lecture de
« Sombres nuées » lui a donné une impression de satire en
douceur, et de simplicité toute apparente.
Dans « Le
Bain », elle a été frappée en particulier par les rivalités
féroces entre les intellectuels, qui lui ont rappelé un livre de
littérature anglaise qu’elle a lu dans le passé, un roman de C.
P. Snow intitulé « Strangers and Brothers » [en fait une
série de onze romans publiés entre 1940 et 1970 qui traitent des
mécanismes de l’exercice du pouvoir et des questions d’intégrité
personnelle et politique].
[On pourrait
quasiment faire une analyse comparée de ces romans (anglais et
chinois) et de leurs thèmes qui recoupent principalement la même
époque, celle de la guerre et de l’après-guerre, avec une
peinture décapante du milieu universitaire. On trouve par
exemple dans « The Masters », qui se passe en 1937, l’élection
d’un nouveau « maître » à Cambridge, avec des manœuvres
politiques qui ressemblent beaucoup à ce que l’on trouve à
l’université Sanlü et dans l’Institut de recherche de Yang
Jiang]
Ø
Marion J.
avait donc
réussi à mettre un terme à sa période de « jachère de lecture »
et retrouvé le plaisir de lire avec « Le Bain », tout en
regrettant d’avoir raté la séance sur le roman de Qian Zhongshu
qu’elle avait lu, mais trouvé plus ardu et bien moins agréable.
N’ayant pas de connaissances de chinois, elle a toujours des
problèmes avec les noms propres qui gênent souvent sa lecture,
mais pas pour « Le Bain ».
Elle a été
touchée par l’humour, la délicatesse de l’écriture, la
description subtile de l’évolution des sentiments et des
réactions, chez ces intellectuels pris peu à peu dans
l’engrenage des événements avec une sorte de naïveté, voire
d’immaturité. Elle a trouvé savoureuse la description des
autocritiques qui montre que, jusqu’à la fin, ils n’ont toujours
rien compris, qu’ils considèrent cela comme un jeu.
La mise au pas
des intellectuels dans l’institut de recherche du « Bain » lui a
paru très proche des diatribes, intrigues et luttes pour le
pouvoir dans le milieu de la recherche en France – voire dans
l’audiovisuel.
Elle n’a pas
trouvé, en lisant « Le Bain », la lenteur qui lui a été
reprochée. Elle a au contraire apprécié la complexité de la
narration et les mille détails précis et pleins d’humour dans la
description de la vie quotidienne : mère et fille couchant dans
le même lit, mais tête-bêche, ou ce dîner se voulant
« informel » mais affichant quand même une dizaine de plats…
Malgré tout c’est un humour universel.
De même, elle
a été touchée par la peinture pleine d’humanité des personnages,
et pas forcément ceux en première ligne : dans « Le Bain », elle
a trouvé attendrissant le personnage de Luo Hou (罗厚),
en retrait, peinant à trouver son orientation et sa place dans
la société ; dans les « Mémoires décousus », elle a beaucoup
aimé le portrait du vieux Wang, le tireur de pousse (《老王》),
ou encore celui, haut en couleur, de la femme de chambre Shunjie
et de sa « grande sœur », c’est-à-dire l’épouse principale, dans
« L’"amour libre" de Shunjie » (chap. 14 de la traduction et en
chinois
《顺姐的“自由恋爱”
》).
Autant d’humbles personnages décrits avec un grand respect, y
compris de leur position de classe.
Ø
Zh.
Guochuan
revient sur le rapprochement que l’on ne peut
s’empêcher de faire entre « Le Bain » et « La Forteresse
assiégée », rapprochement qui s’impose naturellement,
parce que les auteurs sont mari et femme, avec des parcours
similaires — études et séjours à l’étranger, postes de
professeurs d’université en Chine —, mais aussi parce que leurs
œuvres ont un sujet commun : une satire du milieu intellectuel.
Les deux romans partagent un cadre similaire et se déroulent à
des époques proches ; on y retrouve des personnages comparables,
ainsi qu’une certaine atmosphère de luttes sournoises (勾心斗角)
dans les universités, où les promotions dépendent moins des
compétences professionnelles que de l’habileté dans les
relations humaines.
Par ailleurs,
les titres des deux romans sont révélateurs.
Forteresse assiégée est une métaphore qui peut renvoyer au
mariage comme au milieu universitaire ; quant au titre du
« Bain », il offre une double interprétation : évocation de la
« campagne des Trois-Anti » lancée en 1951, mais également de la
transformation des personnages. La société, et plus
particulièrement le cadre universitaire, est ici décrite comme
un creuset : ceux qui y entrent subissent une sorte de
« baptême » qui les change profondément, en bien ou en mal.
Cependant, ces
deux romans présentent des différences marquées. Yang Jiang
n’adopte pas le style de satire acerbe de Qian Zhongshu, son
écriture est plus douce, et son roman met en lumière des
personnages attachants et positifs, Yao Mi, bien sûr,
mais également Xu Yancheng, qui évoque Qian Zhongshu lui-même.
Tous deux sont titulaires d’un doctorat obtenu à l’étranger,
travaillent dans l’Institut de recherche littéraire (文学研究院),
et partagent une même maladresse dans les relations humaines.
Incapables de flatteries, ils restent fidèles à leur véritable
nature, refusant toute forme de dissimulation.
Cependant,
Guochuan souligne un aspect qui n’a pas été abordé
jusque-là : le parallèle subtil entre « Le Bain » et « Le
Rêve dans le pavillon rouge » (《红楼梦》).
Dans son roman, Yang Jiang fait explicitement référence au
« Rêve » à deux reprises, et le parallèle entre les deux
romans peut être établi pour plusieurs raisons :
- D’une part,
Yang Jiang a étudié « Le Rêve dans le pavillon rouge » et
a écrit deux articles à son sujet : d’abord « L’art et le
triomphe sur les difficultés - notes occasionnelles sur le "
Rêve dans le pavillon rouge" »
《艺术与克服困难——读<红楼梦>偶记》en
1959, puis « Propos à bâtons rompus sur le " Rêve dans le
pavillon rouge" »《漫谈<红楼梦>》en
2010 (à l’âge de 99 ans)
.
Dans le premier article, en particulier, elle analyse en détail
les relations entre les principaux personnages, et surtout Jia
Baoyu et Lin Daiyu.
Dans « Le
Bain », l’intrigue amoureuse entre Xu Yancheng d’une part et Yao
Mi et Du Lilin de l’autre est un triangle amoureux similaire à
celui du « Rêve dans le pavillon rouge », Xu Yancheng
correspondant à Jia Baoyu (贾宝玉),
Yao Mi et Du Lilin respectivement à Lin Daiyu (林黛玉)
et Xue Baochai (薛宝钗).
Même la différence d’âge entre les personnages renforce le
parallèle : Du Lilin est d’un an plus âgée que Xu Yancheng, qui
lui-même a quelques années de plus que Yao Mi, comme dans le
roman classique où Xue Baochai est l’aînée et Lin Daiyu la
cadette par rapport à Jia Baoyu.
- Une autre
similitude réside par ailleurs dans la structure narrative.
Si l’on examine attentivement les 120 chapitres du « Rêve dans
le pavillon rouge », il apparaît que, dans les 80 premiers
,
Cao Xueqin prend le temps de décrire minutieusement une
multitude de personnages, en multiples scènes de vie aux
dialogues riches, sans se précipiter vers une fin. En revanche,
dans les 40 derniers chapitres, ceux qui sont d’une autre plume,
les événements s’accélèrent (concours impériaux, décès,
retraites monastiques…) pour donner une conclusion à l’histoire
de tous les personnages. De la même manière, dans les deux
premières parties du « Bain », on ne distingue pas de
personnages principaux ; l’auteure consacre une attention
équivalente à chacun d’entre eux, en multipliant les
descriptions détaillées et les scènes de vie. Cette approche a
d’ailleurs été critiquée par certains lecteurs, qui trouvent le
roman trop fragmenté, avec trop de personnages et l’absence
d’une intrigue centrale, ce qui contribue à l’impression de
« fadeur ».
Ce qui a
surtout séduit Guochuan dans « Le Bain », c’est
l’histoire d’amour entre Yao Mi et Xu Yancheng. Leur relation,
platonique, est décrite avec une grande subtilité. Fait
intéressant : peu avant son décès, Yang Jiang a écrit une suite
en forme de novella intitulée « Après Le Bain » (《洗澡之后》),
où elle fait de ces deux personnages un couple marié, ajoutant
ainsi une conclusion inattendue à leur histoire. Dans la préface
du « Bain », Yang Jiang a bien précisé : « Ce roman n’a ni
structure épique, ni protagonistes. »(既没有史诗性的结构,也没有主角)Dans
« Après Le Bain », en revanche, elle déclare : « Yao Mi et Xu
Yancheng sont des personnages appréciés des lecteurs ; ils sont
donc devenus les protagonistes du présent récit. »(姚宓和许彦成是读者喜爱的角色,就成为书中的主角)Elle
précise également que son intention, en l’écrivant, était de «
conclure l’histoire, afin que personne ne puisse tenter d’y
ajouter quoi que ce soit. »
(把故事结束了,谁也别想再写什么续集了)Des
extraits de cette suite peuvent être consultés ici :
https://www.whb.cn/zhuzhan/bihui/20140717/10533.html
| |
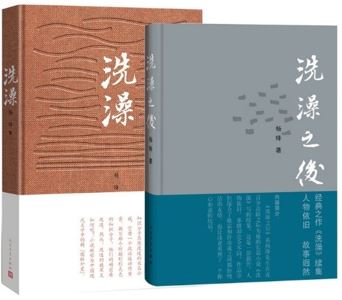
Le
Bain et Après le bain |
|
Ø
D.
Yanzhao
a vu dans « Le
Bain » - qu’elle a lu en chinois - une suite du roman de Qian
Zhongshu en raison des nombreuses analogies (personnages,
situations et détails)
,
mais elle a apprécié le ton personnel et le rythme propre au
roman de Yang Jian passant d’une lenteur initiale dans les deux
premières parties à un tempo plus rapide ensuite.
Au passage,
étant enseignante, elle a souri à la progression des choix
professionnels proposés (ironiquement) dans le roman, comme dans
« La Forteresse assiégée » : la voie royale, c’est de devenir
fonctionnaire, faute de quoi on peut travailler pour un
journal ; sinon il reste toujours l’enseignement…
Plus
fondamentalement, « Le Bain » lui est apparu comme un récit
morcelé, construit comme une série d’anecdotes triviales, de
bribes sans conséquences (suosui
琐碎),
mais suscitant la réflexion, et une attention soutenue. Elle y
voit une histoire d’amour non advenu, non finalisé, dans un
contexte débordant de libido, mais corrompu – tous ces
intellectuels de retour au pays n’ont de cesse de se débarrasser
de leur première épouse pour en prendre une plus jeune. En fait,
le problème de Xu Yancheng et de Yaomi est qu’ils n’ont pas
d’espace intime où puisse s’épanouir leur relation.
Quant à
l’histoire des Trois et des Cinq antis, elle est dite tout en
douceur, et avec humour, mais cela « fait froid dans le dos »
rétrospectivement. Parce que, finalement, toutes ces réunions du
Parti, ces séances d’autocritique, cela reste le schéma actuel,
sur fond de dénonciations, y compris des parents (comme Yu Nan
dénonçant son père dans « Le Bain ») – mais aussi de
compromissions juste pour survivre, tel Qian Zhongshu
participant à une équipe de traduction de poèmes de Mao. Et
quand on considère l’histoire de la Chine maoïste, ce n’est
qu’une suite ininterrompue de campagnes politiques. Les
intellectuels, et les écrivains en particulier, ont tenté de se
protéger en renonçant à écrire et en se réfugiant dans la
recherche – beaucoup, comme
Shen Congwen (沈从文),
tentant de se suicider.
On utilise
aujourd’hui sans réfléchir des expressions qui viennent de cette
époque et se perpétuent, comme celles utilisant le terme « les
masses » (qúnzhòng
群众).
Les masses, ce sont les inconnus, le peuple des anonymes qui ont
raison, et qui portent sur tout un regard auquel on est soumis (qúnzhòng
yǎnjing
群众眼睛).
Finalement, il faut se considérer heureux de ne pas avoir vécu
l’époque du « Bain », dit Yanzhao. En se demandant ce
qu’on aurait fait.
Mais, dit
Marion, c’est là le problème de toutes les dictatures, et le
sujet du livre de Pierre Bayard à mettre en parallèle : « Aurais-je
été résistant ou bourreau
? » Ce qui est aussi la problématique du film de Louis Malle « Lacombe
Lucien »,
qui a suscité une immense polémique à sa sortie, en 1974. Lucien
Lacombe, c’est l’ado un peu paumé devenu collabo faute d’avoir
été admis dans le maquis, mais qui tombe amoureux d’une jeune
femme juive… Et nous, on aurait fait quoi ?
Yanzhao
en
revient pour finir aux titres des trois parties du
« Bain », tous trois extraits de poèmes chinois classiques,
porteurs d’un sens emblématique qui ne lui a pas semblé très
clair.
Note
complémentaire sur
les titres des trois parties
On a quelques
indications données en notes par Nicolas Chapuis dans sa
traduction, mais cela demande quelques explications
supplémentaires.
第一部 Première
partie
采葑采菲
cǎi
fēng cǎi fēi
« Il
effeuille le radis / Comme il effeuille le navet »*
第二部 Deuxième
partie
如匪浣衣
rú
fěi huànyī
« Du linge
trop souillé pour être lavé »*
第三部 Troisième
partie
沧浪之水清兮
cānglàng zhī
shuǐ
qīng xī
« Quand l’eau est si claire… »*
* Traduction
Nicolas Chapuis.
1) Il s’agit
d’un extrait d’un poème du « Classique de la poésie » : « Le
vent de la vallée » des « Airs de Bei » (《诗经·邶风·谷风》).
Ces « Airs de Bei » (Bèifēng
谷风,
poèmes 26-44) figurent dans la première partie de ce Classique :
les « Airs des États » (Guófēng
國風/国风),
Bei étant le nom d’un ancien État féodal. Le poème « Le vent de
la vallée » Gǔfēng
谷风
dépeint une femme abandonnée qui dénonce l’attitude de son mari
et se plaint en réfléchissant sur le triste sort d’une femme. Le
poème est en
six séquences de huit vers de quatre caractères,
le tout exprimé dans une langue qui joue des contrastes et des
métaphores.
Le début dit :
习习谷风
un vent doux souffle dans la vallée,
以阴以雨
apportant avec lui nuages et pluie.
Nous devrions
(nous, maris et femmes) garder un cœur uni
黾勉同心sans
céder à la colère
不宜有怒。
Lorsqu’on
ramasse radis et navets采葑采菲,
cueille-t-on les feuilles en laissant les racines
无以下体 ?
Ces
« racines » sont la partie cachée de ces plantes, mais celle qui
en est la plus recherchée. Dans le poème, c’est l’image
métaphorique des qualités cachées de l’épouse que néglige le
mari volage. Dans le contexte de cette première partie du
« Bain », il s’agit des qualités des intellectuels négligées par
le Parti.
2) Le deuxième
titre est un extrait d’un autre poème de la même partie du
« Classique de la poésie », le premier poème des « Airs de
Bei » : « La
barque de pin » (Bǎi
zhōu《柏舟》).
Ce poème est aussi l’expression de la tristesse et du
ressentiment d’une femme noble
,
délaissée, qui n’a personne auprès de qui se plaindre, et qui en
perd le sommeil. Dans la préface du Classique, il est dit que ce
« bateau de pin » est une image métaphorique représentant les
qualités non appréciées par le pouvoir – le Parti dans le
contexte du « Bain ».
La citation
choisie par Yang Jiang pour le titre de sa deuxième partie est
la conclusion du poème :
心之忧矣,如匪浣衣。静言思之,不能奋飞。
Cette
tristesse que j’ai au cœur, c’est comme un vêtement que l’on ne
peut laver.
J’ai beau y
songer calmement, je ne peux étendre mes ailes et m’en dégager.
3) Le titre de
la troisième partie est tiré d’un ancien chant populaire du nord
de la rivière Han pendant la période des Printemps et Automnes
et des Royaumes combattants, « Le chant de la rivière Canglang »
(《沧浪歌》),
qui a été repris dans plusieurs classiques, dont le Mencius (《孟子·离娄》)
et le Chuci (《楚辞·渔父》).
Dans le Mencius, il est dit que Confucius aurait entendu un
enfant le chanter, d’où le titre : « Chant d’un enfant » (rúzǐ
gē
孺子歌).
沧浪之水清兮,可以濯我缨。Si
l’eau de la Canglang est claire, j’y lave mon bonnet.
沧浪之水浊兮,可以濯我足。Si
l’eau de la Canglang est trouble, j’y lave mes pieds.
Il faut donc
s’adapter à la nature de l’eau – s’adapter aux changements du
monde, éventuellement en s’en retirant.
_____________
La conclusion
de la séance a été donnée in fine par Christiane P.,
tout juste de retour de Taipei, qui était venue bien que n’ayant
rien pu lire : « Eh bien tout cela me donne terriblement envie
de lire ces livres ! »
_____________
Prochaine
séance :
Le mercredi
15 janvier 2025
Après la trêve
des confiseurs, la séance du 15 janvier sera consacrée aux
nouvelles de
Lao She (老舍),
pour apprécier un autre style d’humour :
-
L’homme qui ne mentait jamais (《不说谎的人》),
trad. Claude Payen, éd. Philippe Picquier, 2003, Picquier poche
2021.
Recueil de 14
nouvelles datant de 1934 à 1939 :
1/ L'homme qui
ne mentait jamais (《不说谎的人》).
1936
2/ Vieille
tragédie pour temps modernes (《新时代的旧悲剧》).
1936
3/
L’ordonnance (《抓药》).
1934
4/ Le crachoir
de maître Niu (《牛老爷的痰盂》).
1937
5/ Les
lunettes (《眼镜》).
1934
6/ Notice
nécrologique (《哀启》).
1936
7/ Un
vieillard romantique (《老年的浪漫》).
1935
8/ Ménage à
trois (《也是三角》).
1934
9/ La chenille
(《毛毛虫》).
1935
10/ Li le noir
et Li le blanc (《黑白李》).
1934
11/ La mort
d’un chien (《杀狗》).
1939
12/ Buffle de
fer et canard malade (《铁牛和病鸭》).
1934
13/ Le nouveau
Hamlet (《新哈姆雷特》).
1936
14/ Le nouvel
Emile (《新爱弥儿》).
1936
[pastiche de
« Émile ou De l’éducation » (《爱弥儿:论教育》)]
On pourra lire
en complément :
- Écrits de la
maison des rats, essais publiés entre 1934 et 1959, trad. Claude
Payen, Philippe Picquier, 2010, Picquier poche 2016.
- La
philosophie de Lao Zhang (《老张的哲学》),
trad. Claude Payen, Philippe Picquier, 2009, Picquier poche
2011.
|

