|
|
Club de lecture de littérature
chinoise (CLLC)
Compte rendu de la séance du 12
mars 2025
et annonce de la séance suivante
par Brigitte
Duzan, 17 mars 2025
Cette
troisième séance de l’année 2025 était consacrée aux « Notes
diverses sur la capitale de l'Ouest » (《西京雜記》),
de Liu Xin (劉歆/刘歆),
texte
établi, traduit et annoté par Jacques Pimpaneau, Les Belles
Lettres, Bibliothèque chinoise, 2016
.
| |
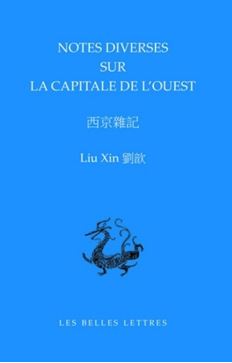 |
|
L’idée de
programmer ce texte au club de lecture avait une double source :
d’une part la visite de
l’exposition du Musée Guimet
(qui s’est achevée le 3 mars) initialement intitulée
Chang’an, resplendissante capitale de l’empire Tang, et
d’autre part le séminaire sur le Baopuzi (《抱朴子》)
de Ge Hong (葛洪)
au Collège de France, dans le cadre de la chaire d’Anne Cheng,
lectures par Béatrice l’Haridon commencées en 2023 et
poursuivies jusqu’en 2025. En effet, comme le précise
l’introduction de Jacques Pimpaneau, ainsi que la postface de Ge
Hong traduite par Béatrice l’Haridon qui figure à la fin du
volume des Belles Lettres, le manuscrit de ces « Notes »
provenait à l’origine de la bibliothèque de la famille de Ge
Hong (283-343, ou 363) – éminent lettré de la dynastie des Jin
suivant la période des Trois Royaumes
.
L’impression
d’ensemble était une joie de lecture, inattendue car c’était la
première fois qu’était programmé au club un texte aussi ancien.
Ø
Laura
était en congé
mais avait rédigé auparavant un « coup
de cœur »
soulignant le plaisir du voyage dans le temps au fil des 138
notules du texte, dans le plus parfait désordre, révélant une
ville fastueuse mais recélant derrière les somptueuses façades
complots, rumeurs et violence.
Elle souligne
aussi l’appareil critique qui donne toute la valeur à cette
édition : avant-propos de Damien Chaussende, introduction et
innombrables notules du traducteur, qui tiennent parfois autant
de place que le texte lui-même et forment un ensemble de
commentaires explicatifs inestimables, en particulier sur tous
les personnages évoqués.
Ø
Dorothée MS
a trouvé pour sa part que le plaisir commençait avec le livre
lui-même, un bel objet, agréable à tenir dans la main, puis se
poursuivait en découvrant toutes les notes du traducteur, comme
un livre dans le livre. Certaines des descriptions lui ont
rappelé des expositions,
l’exposition de 2016 sur le jade au musée Guimet,
par exemple, pour ce qui est des armes et autres objets de
l’empereur décrits dans le texte.
Elle a été
frappée par le luxe des ornements, en particulier par les
éventails en plumes de martins pêcheurs, dans des couleurs
bleu-vert extraordinaires, et ce d’autant plus que l’oiseau est
aujourd’hui parmi les espèces protégées. Et puis elle a été
arrêtée par l’évocation du palais « de Sans-Souci » [traduction
de
忘忧之馆,
littéralement « le palais qui fait oublier les soucis », notule
97], évocation qui l’a aussitôt ramenée des années en arrière, à
Berlin…
Ø
Christiane P.
a particulièrement apprécié qu’il ne s’agisse pas d’histoire
événementielle, mais d’anecdotes, sur les thèmes les plus
divers, avec de telles précisions dans les descriptions qu’elle
en a imaginé l’utilité pour les réalisateurs de cinéma et de
feuilletons télévisés.
Le thème
principal est le luxe : faste de la vie quotidienne, splendeur
des parcs et beauté du moindre objet artisanal, les pierres à
encre par exemple, ou les nattes de jade, les parfums à toute
heure du jour et de la nuit et les éventails à sept roues pour
lutter contre la canicule (notule 28). On réalise qu’il y avait
déjà à l’époque des fenêtres en verre ! Les détails permettent
une vision précise des us et coutumes du quotidien : ainsi
l’empereur avait une table basse en jade, couverte en hiver de
brocart de soie, mais les nobles, eux, n’avaient droit qu’à une
table en bambou, couverte de feutrine en hiver, car la soie
était réservée à l’empereur… On a des descriptions très précises
des jeux, le jeu de go en particulier. Lors des concours de
poésie, les perdants sont condamnés à boire des pichets de vin,
les meilleurs sont récompensés par des rouleaux de soie.
Christiane
également beaucoup aimé les descriptions des fêtes, des banquets
et des chasses. Mais un détail l’a frappée (notule 105) :
l’évocation du personnage qui élevait des faisans sauvages pour
qu’ils attirent leurs congénères, si bien qu’ensuite il pouvait
les tirer sans difficultés. Cela lui a rappelé la coutume
qu’elle a vu pratiquer en Sologne, de lâcher des animaux élevés
en captivité à la veille d’une chasse.
Les mentalités
l’ont particulièrement intéressée. Par exemple les excès de
piété filiale de l’empereur Gaozu : comme son père se morfondait
à la cour, il lui fit construire toute une ville semblable au
bourg d’où il venait, avec les marchands, les bouchers les
vendeurs de galettes et les combats de coqs qu’il aimait ; il y
fit même transporter le temple du dieu du sol (notule 40) ! Les
descriptions ne sont pas sans une pointe d’humour, par exemple
quand il s’agit de prouver que le fils du prince de Liang était
trop jeune pour se marier, contrairement à ce que prétendait
l’impératrice douairière ; quand il se prend les pieds dans la
barre de seuil et en perd une chaussure, l’empereur convient
qu’il est effectivement trop jeune et en informe sa mère (notule
100).
[et c’est
d’autant plus subtil qu’il s’agissait en fait d’affaiblir la
lignée du prince de Liang, frère de l’empereur, en mariant son
fils très jeune, ce qui n’est que suggéré entre les lignes.]
Ce qu’elle a
également trouvé savoureux, ce sont toutes les descriptions de
superstitions, de pratiques magiques, des présages et des rêves.
Les rêves ont un pouvoir performatif ; les présages sont
importants pour déterminer la voie à suivre, pour légitimer un
souverain, mais aussi pour prévoir les événements du quotidien,
la visite d’un visiteur, annoncée par une pie, par exemple :
étant réponse à la vertu de certains hommes, « un présage est un
trésor en lequel on peut avoir confiance » est-il dit (notule
85)… « sans la confiance en ce trésor qu’est un présage faste,
comment pourrait-on obtenir le trône par le seul usage de la
force ! ».
Elle a trouvé
intéressant le mode de raisonnement et de preuve, par anecdotes,
précédents et analogies. Par exemple pour la détermination de
l’aîné et du cadet lors de la naissance de jumeaux (notule 86).
Mais elle a été frappée par la violence des comportements, et en
particulier chez les impératrices, l’impératrice Lü tout
particulièrement : comme elle voulait faire assassiner le prince
de Zhao qui partageait la chambre de l’empereur, elle le fit
étouffer un jour que l’empereur était parti à la chasse ;
l’empereur fit couper à la taille l’homme de main qui l’avait
tué, mais à l’insu de l’impératrice est-il précisé - de toute
évidence il avait peur qu’elle se venge.
[L’impératrice
Lü Zhi (呂雉),
épouse de l’empereur Gaozu (高祖),
avait la réputation d’une femme puissante et cruelle. Après la
mort de l’empereur, leur fils devint l’empereur Huidi (惠帝).
Mais c’était un être faible qui ne s’intéressait pas aux
affaires de l’Etat, c’est donc Lü Zhi qui exerça le pouvoir
véritable. Elle fit tuer la concubine favorite de l’empereur
défunt qui représentait une menace car son fils avait été le
prétendant au trône du vivant de l’empereur, et elle concentra
le pouvoir entre ses mains en gouvernant avec l’aide de son
clan. Après la mort de son fils, elle plaça successivement sur
le trône deux empereurs en bas âge, ce qui lui permit de
continuer à gouverner pendant 16 ans. Elle est reconnue pour ses
capacités à administrer le pays, et elle est la première femme,
dans l’histoire chinoise, à avoir détenu seule le pouvoir aussi
longtemps. Il est caractéristique de la voir dénigrée dans
l’histoire officielle.]
Ø
Sylvie D
dit avoir « picoré », une note puis une autre, en savourant
la richesse des descriptions, des arbres et des textiles en
particulier. Pour ceux-ci, elle a été impressionnée par la
description des rouleaux de soie préparés pour faire des
cadeaux (notule 17), avec le moindre détail des broderies sur
brocart et sur satin damasquiné.
[ce qui
représente aussi une prouesse de traduction, autant pour les
noms des différents arbres et noms d’animaux que pour les
nombreux types de tissus et de broderies.]
Ø
LLP
a
partagé le même émerveillement pour les descriptions et les
anecdotes, ainsi que les portraits de personnages, mais a
apprécié le texte comme un véritable document historique, et
d’ailleurs, d’après l’introduction, ce seraient les notes que
n’auraient pas retenues Bang Gu (班固)
lors de sa compilation du Livre des Han (le Hanshu《漢書》/《汉书》 ).
L’ont particulièrement retenue et frappée, d’abord, toutes les
descriptions du faste des palais.
- La
description de la notule 24 du luxueux palais Zhaoyang (昭阳殿)
de Zhao Zhaoyi (赵昭仪),
la sœur cadette de Zhao Feiyan (赵飞燕),
concubine de l’empereur Cheng (成帝),
puis impératrice - la notule 29 décrivant les cadeaux somptueux
envoyés par Zhaoyi à sa sœur quand elle fut élevée au rang
d’impératrice.
- La liberté
sexuelle : description des ébats de Zhao Feiyan, notule 39,
«plus d’une dizaine de jeunes gens déguisés en fille entraient
chaque jour dans les appartements impériaux du palais et elle se
livrait avec eux à des ébats sexuels sans un instant de répit »,
topos qui sera repris pour critiquer Wu Zetian sous les Tang.
- Le
raffinement des réceptions, en lien avec la poésie.
- La
description des instruments de musique dont certains
représentent une véritable prouesse technique (notule 74).
-
L’énumération des plantes et arbres fruitiers : la notule 27
donne un catalogue détaillé des arbres du parc impérial. On a de
même des énumérations de noms donnés aux animaux, ainsi ceux des
« neuf chevaux remarquables » de l’empereur Wen, fils de Gaozu
(notule 35), ou les noms des chiens de chasse de la notule 106.
Les princes faisaient des dépenses considérables pour les
animaux, tel (notule 59) le Prince Gong de Lu qui aimait les
combats de coqs et autres volatiles, qui élevait des paons et
des hérons et qui dépensait deux mille boisseaux de céréales
pour nourrir toutes ces bêtes. Animaux qui avaient en outre des
accessoires somptueux, en particulier les chevaux :
« L’empereur fit faire des selles en jades de couleur rose
incrusté d’or, d’argent et de cuivre jaune » (Notule 36).
Christiane
P.
se demande d’ailleurs comment les chevaux pouvaient supporter
des selles de jade !
Outre le luxe,
LLP a aimé toutes les précisions sur les pratiques
funéraires et les superstitions :
- La
description du mobilier funéraire et les détails des tombes
pillées par un prince (notules 125 à 131)
- Les
pratiques funéraires, dont mention d’une première auto-épitaphe
et du rapatriement du corps du défunt dans son pays natal ; il
était même possible de demander une retraite anticipée de
manière à « rapatrier ses os » de son vivant pour limiter les
dépenses, explique Jacques Pimpaneau dans la note 179 !.
- Le passage
sur le Yin et le Yang et leur influence sur les saisons et la
météo, en citant Dong Zhongshu (董仲舒),
le grand spécialiste de la pensée Yin/Yang sous les Han
(notule118) : « Tout en étant différents, Yin et Yang forment
une seule même énergie. »
-
Parallèlement, il est aussi fait référence aux éléments
surnaturels, et aux animaux en particulier : le « renard
blanc » qui apparait au prince pilleur de tombe dans la
notule 131, mais surtout les dragons, par exemple : « Lorsque
le fleuve jaune rompit ses digues à l’embouchure de la rivière
Huzi, un dragon et neuf de ses enfants à sa suite entrèrent dans
la rivière en remontant le courant » (notule 53) –
inondation qui a effectivement eu lieu, en 132 av. J.C. précise
Pimpaneau. Ou encore (notule 56) : en 188 av. J.C. eut lieu un
orage sur une montagne qui provoqua un immense incendie, des
milliers d’arbres furent brûlés, et par la suite les habitants
du lieu trouvèrent là « un squelette de dragon et deux de
dragons aquatiques » (家人就其间得龙骨一具,鲛骨二具).
La distinction
entre dragon et dragon aquatique ici suscite des questions car
Jacques Pimpaneau précise juste (dans sa note 130) que « les
dragons aquatiques pouvaient provoquer des inondations ». En
fait, explique W. Lei, ce sont deux dragons différents :
lóng (龙/龍)
et jiāo (蛟),
ce dernier étant le dragon pouvant provoquer des inondations.
L’infinie
précision de la langue est aussi ce qui a frappé LLP dans
ce texte, avec l’utilisation de caractères rares, par
exemple dans la description des chevaux de l’empereur Wen
(notule 35), comme l’explique Jacques Pimpaneau (notes 93 et
94), le caractère piào (驃/骠)
désigne « un cheval à la robe jaune et à la crinière blanche »,
et le caractère liú (騮/骝)
« un cheval roux à la crinière et la queue noires ». Précision
du même genre encore dans la dernière notule (138) : le
caractère pú (璞)
désigne à la fois le jade brut et la viande de souris pas encore
sèche, et le caractère shuò (朔)
le premier jour du mois, mais aussi le timon d’un char. Tout
cela juste pour souligner la nécessité de faire des
distinctions !
[Et Jacques
Pimpaneau d’ajouter en note une anecdote tirée des « Stratagèmes
des Royaumes combattants » (Zhanguoce《战国策》)
qui
donne une étymologie différente de pú en fonction du
lieu, avec des clés différentes : « Les hommes de Zheng
désignent le jade brut par le terme de pú (璞),
les hommes de Zhou quant à eux désignent la viande de souris non
séchée par le terme de pú (檏) »
Alors quand un homme de Zhou vient proposer du pú à un
homme de Zheng, et que celui-ci lui voit sortir de la viande de
souris, évidemment il décline la proposition… ]
Ce qui laisse
admiratif devant la traduction et l’érudition du traducteur.
Ø
MRC a
trouvé intéressant de programmer un tel texte au club de
lecture. Il l’a lu dans une édition chinoise alliant le texte
original, des commentaires explicatifs et la traduction en
chinois moderne.
Ces Notes lui
ont rappelé, pour l’aspect anecdotes historiques, un livre de
Stefan Zweig, très populaire en Chine, qu’il aime beaucoup : « Les
très riches heures de l’humanité »
(Sternstunden der Menschheit). Cependant, il l’a surtout
trouvé comparable aux « Mémoires
historiques » (Shiji《史记》)
de Sima
Qian (司马迁),
mais sans le style et la construction qui font du Shiji
une véritable œuvre littéraire.
Il a
d’ailleurs trouvé dans ces « Notes » des anecdotes qui sont
aussi dans les « Mémoires historiques », par exemple l'histoire
de « Li Guang tirant sur un tigre » : Li Guang, ayant pris un
rocher pour un tigre, a tiré sans coup férir pour le tuer et la
flèche s'est enfoncée profondément dans le rocher. Après avoir
découvert que c’était un rocher, il a essayé de tirer à nouveau,
mais sans plus pouvoir enfoncer la flèche dans le rocher.
Sima Qian raconte
cette histoire sans faire de commentaire, mais il est clair
qu’il sous-entend que « lorsque l'esprit est sincère, la force
de l'esprit peut percer même un rocher ». En revanche, Liu Xin,
lui, commente cette histoire en donnant plusieurs
contre-exemples par analogie pour montrer que certaines
personnes, bien que sincères dans leur volonté d’accomplir
quelque-chose, ne parviennent pourtant pas à le faire car elles
manquent de détermination. Cela brise l'aspect idéalisé et
héroïque de cette histoire. C’est un autre regard, et on peut
préférer celui de Sima Qian.
Par ailleurs,
les
« Notes »
évoquent de nombreux personnage intéressants, des belles femme
comme Zhaojun昭君,Zhao
Feiyan赵飞燕,
des écrivains comme Sima Xiangru司马相如,
Sima Qian司马迁.
Mais celui qui a particulièrement intéressé MRC, c’est
Dong Fangshuo (东方朔),
car il est très spécial.
De manière
générale, il se distingue de la plupart des fonctionnaires, car
il est très drôle et doué pour improviser rapidement des
réparties. Dans les « Notes » de Liu Xin, il y a deux histoires
qui parlent de lui : notules 33 et 110.
- Notule
33 : Dong Fangshuo a utilisé une stratégie habile pour
sauver la nourrice de l’empereur. Il n’a pas conseillé
directement à l'empereur Han Wudi de ne pas la tuer, mais il
s'est adressé subtilement à la nourrice en lui disant :
« L'empereur a grandi maintenant, comment pourrait-il encore se
souvenir de la gratitude qu'il te doit pour l'avoir nourri
autrefois ? » Finalement, l'empereur a décidé de lui laisser la
vie sauve. Cette stratégie est efficace parce que Dong Fangshuo
sait pertinemment que l’empereur n'aime pas qu’on lui donne des
conseils, et encore moins des leçons, mais il a été rappelé à
son devoir de gratitude envers sa nourrice. Cependant,
cette même stratégie aurait peut-être eu un effet inverse sur
quelqu’un d’autre et n’a été efficace que parce que Dong
Fangshuo connaissait bien l’empereur.
MRC
rapporte une autre histoire assez similaire qu’il a lue sur le
même personnage, mais qui n’est pas dans les « Notes diverses »
: quelqu’un ayant offert à l’empereur Han Wudi du "vin de
l'immortalité", Dongfang Shuo l’a bu en totalité avant que
l'empereur ait pu y toucher, donc l'empereur furieux a voulu le
tuer, mais Dongfang Shuo lui a dit : « J’ai fait cela pour
tester l'authenticité de ce vin. Si vous pouvez me tuer, cela
signifie que le vin n’était pas véritablement un vin de
l’immortalité, mais un faux. Si ce vin était vrai, en revanche,
même si vous voulez me tuer, vous ne pourrez pas. » Finalement,
l'empereur l'a donc épargné.
Alors que
presque tous les fonctionnaires, ses collègues, ne font que
flatter l'empereur, il ose le contredire sans pour autant
l'irriter. Cela montre qu'il est non seulement doué pour
improviser des réparties, mais aussi qu'il comprend très bien la
mentalité de l'empereur.
- Notule
110 : Dongfang Shuo était très doué pour siffler. Chaque
fois qu'il sifflait longuement, il soulevait la poussière si
haut qu’elle retombait sur les chapeaux.
C’est une
histoire très courte et très simple, mais qui montre son
habileté dans un jeu que les fonctionnaires traditionnels
méprisaient généralement. C'est donc quelqu'un qui ne respectait
pas les traditions et ne se souciait pas de ce que pensaient les
autres.
Une autre
anecdote savoureuse le concernant n’est pas mentionnée dans les
« Notes diverses » : il utilisait les récompenses et les cadeaux
que l'empereur Wu lui accordait pour épouser de nombreuses
femmes, chaque nouvelle femme étant abandonnée au bout d’un an
et remplacée par une nouvelle. Ceci pour souligner encore qu'il
avait une forte personnalité et ne se souciait pas du regard et
de l’opinion des autres. Il assumait ses défauts sans les
cacher, et n’avait pas l’hypocrisie des autres fonctionnaires
qui prenaient eux aussi des concubines, mais ne le faisaient pas
de manière aussi ostentatoire.
Ø
Zh.
Guochuan,
pour sa part, a lu le texte original en chinois classique après
avoir vainement cherché l’édition bilingue des Belles Lettres à
la Bulac : le seul exemplaire de la bibliothèque était déjà
sorti… pour le club de lecture !
Ce qui l’a
frappée, d’abord, c’est la taille de Chang’an à l’époque des Han
occidentaux : plus de 240 000 habitants ! Dans le texte, comme
Christiane, elle a trouvé amusante, mais pointue,
l’explication pour déterminer l’aîné et le cadet de deux
jumeaux. Et comme MRC, elle a aimé l’histoire de Dongfang
Shuo soulevant la poussière si haut en sifflant qu’elle
retombait sur la tête des gens. Elle s’est demandé comment cela
pouvait se faire … Le texte dit : le lettré Dongfang était doué
pour siffler (善啸
shàn
xiào),
et chaque fois qu’il sifflait de manière prolongée (每曼声长啸
měi
mànshēng chángxiào),
la poussière soulevée tombait sur les chapeaux (辄尘落帽).
En fait, c’est le souffle prolongé du sifflement qui soulevait
la poussière.
Mais ce qui a
surtout frappé Guochuan, c’est que, alors que l’auteur
donne des descriptions extrêmement détaillées des palais, des
parcs, des arbres, des animaux, etc., il évoque des banquets
fastueux mais sans donner aucune précision sur les plats qui
étaient servis. La cuisine est absente de tout le texte. Cela
lui a rappelé un livre dont le titre lui a échappé sur le
moment, et dont elle s’est souvenue le lendemain (en envoyant le
titre par mail) : c’est le recueil de recettes de Yuan Mei (袁枚),
grand lettré de la dynastie des Qing (1716-1797) qui s’est
retiré loin de la cour à la fin de sa vie et, rentré chez lui,
dans un jardin qu’il s’était fait construire, a écrit des poèmes
et récits divers, dont un recueil de recettes (《随园食单》),
traduit en français, par Isabella Henderson, « Recettes du
Jardin du Contentement ». C’est évidemment bien plus qu’un
simple recueil de cuisine et, bien qu’écrit à une époque bien
différente, ce pourrait être le complément idéal pour boucher le
trou laissé vacant par Liu Xin.
Ø
W. Lei a
trouvé le contenu du recueil de Liu Xin extrêmement riche,
couvrant une telle variété de domaines qu’il est d’une valeur
indéniable.
Cependant,
sans classification ni organisation thématique, il lui a semblé
hétéroclite, et elle a eu l’impression, après une première
lecture, d’avoir absorbé une grande quantité d’informations,
mais sans qu’il lui en reste grand-chose de précis, mis à part
des anecdotes intéressantes. Difficile, par exemple, de savoir
quelles concubines, quels lettrés, quels fonctionnaires et quels
empereurs avaient vécu à la même époque. Pour mieux clarifier
ces aspects, elle a donc entrepris de classer et de réorganiser
les 138 notules du texte en fonction de différents thèmes.
[et non
seulement elle a fait ce travail de classification en chinois, à
partir du texte original, mais elle l’a en outre traduit en
français, on en a donc une
version bilingue qui est maintenant en ligne,
en
complément du présent compte rendu.]
Pour compléter
en outre ce qu’on dit les autres membres du club, elle a partagé
ses préférences, d’abord parmi les personnages historiques.
Personnages
historiques préférés
Yang Xiong
(notules 42, 64, 71) : brillant lettré passionné par l’étude des
dialectes,
Wang Zhaojun
(notule 32) : droite et intègre,
Zhuo Wenjun
(notule 84) : dévouée à son amour,
Cao Chang
(notule 69) : fidèle et loyal,
Gongsun Hong
(notule 92) : soucieux de découvrir et former des talents,
Sima Xiangru
(notules 43 et 81) : éminent lettré, remarquable notamment en
poésie en prose,
Dong Zhongshu
(notule 118) : philosophe et original,
L’empereur Han
Gaozu (notule 40) : d’une grande piété filiale envers ses
parents,
Gu
Ao (notule
113) : également exemplaire dans la piété filiale.
Œuvre
littéraire préférée
Parmi toutes
les œuvres littéraires mentionnées dans le livre, celle qu’elle
a le plus appréciée est le Fu Niao Fu (《鵩鸟赋》)
de Jia Yi (贾谊),
c’est-à-dire le poème en prose « La Chouette » (notule 121). Comme son contenu n’est pas donné dans
l’ouvrage, elle l’a recherché et l’a lu en entier, et elle a
trouvé que ce poème avait le pouvoir de l’apaiser quand son
esprit était trop préoccupé.
En revanche,
malgré leur beauté littéraire, elle s’est trouvé moins
d’affinité avec les fu destinés à flatter les empereurs
et les hauts dignitaires, comme ceux mentionnés dans les notules
97 et 123.
Expressions
idiomatiques et dictons chinois :
Elle a
découvert que de nombreuses expressions idiomatiques et dictons
chinois trouvent leur origine dans ce livre. Par exemple :
-
“Záo
bì tōu guāng”
(凿壁偷光)
: littéralement « faire un trou dans le mur pour voler la
lumière » [du voisin], chengyu tiré de l’histoire de
Kuang Heng (匡衡),
un jeune avide de savoir mais qui n’avait pas de lampe
(notule 46). Cet idiome est très important dans l’éducation
chinoise et enseigné dès l’école primaire pour encourager
les enfants à aimer l’étude.
-
“Jīng
chéng suǒ zhì, jīn shí wéi kāi”
(精诚所至,金石为开)
: « quand on a la force d’âme voulue, même la pierre et le
métal peuvent être entamés » (histoire de Li Guang, notule
122), chengyu signifiant que toute difficulté peut
être surmontée avec une volonté inébranlable.
-
“Nìng
dé yī rén xīn, bái shǒu bù fēn lí”
(宁得一人心,白首不分离)
: expression tirée de la « Complainte des cheveux blancs » (《白头吟》)
de Zhuo Wenjun (卓文君),
épouse du poète Sima Xiangru (司馬相如),
décrivant un amour profond et fidèle, souhaitant qu’il
perdure jusqu’à la vieillesse (notule 84).
[Zhuo Wenjun
avait été séduite et enlevée par Sima Xiangru, elle avait des
raisons de souhaiter qu’il lui reste fidèle et ne prenne pas de
concubine].
D’autres
expressions liées à Zhao Feiyan, mentionnée à plusieurs reprises
dans le livre, sont courantes :
-
“Shēn
qīng
rú yàn”
(身轻如燕)
: « aussi légère
qu’une
hirondelle »
(donc
comme Zhao Feiyan).
-
“Huán
féi yàn shòu”
(环肥燕瘦)
: expression décrivant la diversité des idéaux de beauté
féminine à travers les âges. Elle fait référence à deux
beautés : Yang Guifei, voluptueuse sous la dynastie des
Tang, et Zhao Feiyan, connue pour sa silhouette mince et
légère sous les Han de l’Ouest.
-
“Hóng
yán
huò
shuǐ”
(红颜祸水)
: chengyu habituellement traduit par « femme fatale »,
signifiant qu’une femme d’une grande beauté (红颜)
peut provoquer des calamités (祸水)
et être source de troubles.
[chengyu
justifiant que les femmes soient limitées à la sphère intime du
gynécée].
Et enfin,
parmi toutes les merveilles et objets précieux décrits dans le
livre, ceux que W. Lei aimerait le plus posséder de nos
jours sont le brûle-parfum pour la literie pour l’hiver et
l’éventail à sept roues pour l’été (notule 28) : le summum du
luxe !
Ø
Zh.
Dengyan
a créé un moment de stupeur en dévoilant, comme une cerise sur
le gâteau, le livre qu’elle s’était fait apporter tout
spécialement de Pékin : une édition du recueil de Liu Xin en
chinois ancien et traduction en chinois moderne avec
commentaires explicatifs, mais en outre une édition superbement
illustrée, en couleur – remarquant au passage que la plupart des
illustrations proviennent… de la bibliothèque
François-Mitterand ! Stupeur faisant place à l’émerveillement
tandis que le livre circule dans les rangs…
Dengyan
apporte en complément une note d’humour et de bonne humeur en
disant son étonnement à voir, justement, toutes ces expressions,
coutumes et superstitions trouvées au fil des notules encore
très vivantes aujourd’hui, chez elle, dans le Gansu, alors
qu’elles datent des Han, il y a plus de deux mille ans !
Elle a été
impressionnée par les excès que pouvait prendre la piété
filiale, dans le cas de l’empereur Gaozu, par exemple, allant
jusqu’à faire construire une ville entière pour que son père
soit heureux à la cour et s’y sente chez lui (notule 40). Ou
l’attention portée aux invités dans le cas de ce lettré vivant
modestement, mais traitant ses invités avec faste.
Mais c’est
surtout la perpétuation des us et coutumes qui l’a frappée. Le
rapatriement du corps du défunt, par exemple, dont il est
question à propos de Du Ye (notule 78), est une chose à laquelle
tient viscéralement sa mère : venue en France rendre visite à sa
fille, elle n’avait qu’une peur, c’est de mourir en France,
parce qu’elle voulait être enterrée chez elle, selon le dicton
courant « la feuille tombée retourne à ses racines » (落叶归根).
De la même manière, les superstitions sont toujours vivantes,
celles concernant les pies, ou celles touchant à la malédiction
qui frappe les femmes nées sous le signe du mouton, une année
yang, qui portent malheur à leurs maris - une de ses tantes
qui avait perdu son mari jeune étant dans ce cas se l’est vue
reprocher toute sa vie : « c’est de ta faute » ! Quant aux
calculs complexes pour prédire l’avenir, les dates fastes pour
une cérémonie ou les compatibilités entre futurs époux, le
suànmìng (算命)
dont il est question dans le texte, c’est aussi toujours actuel.
[Calculs très
précis, comme ceux de ce Song Zhen (嵩真)
de la notule 88 qui avait prédit le jour et l’heure exacte de sa
mort, et qui mourut bien à l’heure dite, mais un jour plus tôt…
il s’était trompé d’un trait dans un caractère.
LLP
dit avoir
remarqué, aujourd’hui, la précision des divinations faites par
des devins chinois, comparées à celles, bien plus floues, faites
par leurs homologues français]
Dengyan
a rêvé comme tout le monde du luxe de la cour impériale à
Chang’an, et s’est amusée des batailles entre concubines, source
inépuisable d’histoires pour les feuilletons télévisés. Elle a
ri des histoires de magiciens, comme le Ju Daolong (鞠道龙)
de la notule 62, magiciens dont aimait à s’entourer le prince de
Huainan qui mourut, dit la notule 63, entouré de ses amis.
[histoire à
relativiser, comme l’insinue Jacques Pimpaneau dans sa note
138 : en fait le prince en question, petit-fils de l’empereur
Gaozu, accusé d’avoir fomenté une rébellion, se suicida. Et se
fabriqua lui-même sa légende d’immortel disparu dans une
ascension céleste au milieu de ses amis magiciens. C’est aussi
ainsi que s’écrivait l’histoire.]
Les élites
cherchent à se forger une légitimité par des présages qui
tiennent aussi de la divination, telle l’impératrice destinée à
l’être pour avoir avalé un caillou apporté par une hirondelle.
Tout cela tient des fake news, dit en riant Dengyan. Et
termine sur l’infinie richesse des prénoms, qui vaudraient à eux
seuls un développement, coutume que l’on a conservée
aujourd’hui, à commencer par les bébés auxquels il s’agit de
donner un premier prénom dérisoire pour qu’ils n’attirent pas
l’attention de quelque mauvais esprit.
C’est sans
doute ce qui contribue au plaisir de lecture de ces Notes :
c’est d’y trouver une image satirique tellement actuelle du
monde moderne.
Prochaine
séance :
Le mercredi
9 avril 2025
Cette séance
sera consacrée au roman de
Chan Koonchung (陈冠中)
:
- Les années
fastes (《盛世》),
trad. Denis Bénéjam, préface Julia Lowell, Grasset 2012.
|
|

