|
Club de lecture de littérature
chinoise (CLLC)
Compte rendu de la séance du 12
février 2025
et annonce de la séance suivante
par Brigitte
Duzan, 17 février 2025
Cette deuxième
séance de l’année 2025 était consacrée à des nouvelles de
Liu Na’ou (劉吶鷗/刘呐鸥),
tirées de l’unique recueil qu’il nous a laissé, avant de
disparaître prématurément à l’âge de 35 ans :
- Scènes
de vie à Shanghai,
recueil de douze nouvelles sur les quinze du recueil original (Dushi
fengjing xian《都市風景線》/《都市风景线》),
sous-titré « Scène », traduit et postfacé par
Marie Laureillard,
Serge Safran, 2023.
1. Jeu
Yóuxì
游戏
2. Paysages Fēngjǐng
风景
3. Flux
Liú
流
4. Un cœur
ardent Rèqíng zhī gǔ 热情之骨
5. Rituels et
hygiène Lǐyí he wèishēng
礼仪和卫生
6. Deuil Cánliú
残留
7. L’équation
Fāngchéng shì 方程式
8. Sous les
tropiques Chìdào xià 赤道下
9. La
couverture ouatinée Mián bèi 绵被
10. Tentative
d’assassinat Shārén wèisuì 杀人未遂
11. A Lady
to keep you company
12. Un éternel
sourire Yǒngyuǎn de wēixiào 永远的微笑
Textes
originaux en ligne (en caractères simplifiés) :
https://www.kepub.net/book/762039
|

édition originale 1930 |
|
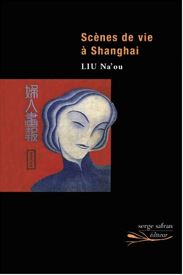
traduction française* |
*Illustration
de couverture par Guo Jianying (郭建英)
,
rédacteur en chef à partir de janvier 1934 du
Furen huabao
(《婦人畫報》 )
où a été publiée la nouvelle « La couverture ouatinée » (Mián
bèi
绵被).
L’illustration est empruntée au
numéro 17 du 25 avril 1934.
Une
découverte !
Personne ne
connaissait Liu Na’ou : ce fut donc une découverte totale, et
surprenante à bien des titres.
La séance a
commencé par les impressions de lecture de Zh. Dengyan :
elle avait lu les nouvelles dans l’édition originale de 1930 !
Lecture très
difficile qui l’a fascinée, mais laissée désorientée : d’abord
en raison de l’édition à l’ancienne, en caractères composés en
impression verticale, mais surtout en raison du style, allant
jusqu’à des phrases carrément incompréhensibles.
Bien plus,
l’effet de surprise passé, c’est un style qui lui a semblé trop
« fleuri » (huálì
华丽),
avec une tendance un peu artificielle à multiplier les simples
majuscules à la place des noms et les mots anglais ou français,
voire les transcriptions de mots anglais, au lieu des mots
chinois.
On peut donc,
pour la suite de la séance, distinguer les réactions sur le fond
et celles sur la forme, réactions mitigées dans un cas comme
dans l’autre. Commençons par le fond.
I. Le
fond : de l’intérêt au questionnement et au rejet
Ø
Pour ce
qui est du contenu de ces nouvelles, Dengyan a trouvé
qu’il s’agissait là de fantasmes d’un macho caractéristique.
Sous sa plume,
les femmes sont petites, elles ont des petits pieds, des bouches
cerise, des joues d’un bel ovale, des sous-vêtements
transparents, et quand, par hasard, l’une d’elles est dépeinte
sous un jour différent, avec un corps plus sportif et la peau
légèrement tannée, elle est « comme un homme ». En fait, toutes
les femmes, chez Liu Na’ou, sont des séductrices, ce sont elles
qui vont vers les hommes et elles qui mènent le jeu.
[Ce qui était
sans doute le reflet de sa vie personnelle et du milieu dans
lequel il vivait.
Voir :
Shanghai années 1920 : la ville comme laboratoire, entre
littérature et cinéma.]
Ø
Giselle H.
a bien aimé la peinture de Shanghai avec tous les mythes
afférents, en particulier celui de la meinü, justement,
et tout le monde des concessions. Cela lui a rappelé le film de
1932 de Josef von Sternberg « Shanghai Express », avec Marlène
Dietrich dans le rôle de l’aventurière brise-cœurs Shanghai
Lily qui n’aurait pas déparé la galerie de portraits de Liu
Na’ou.
Si la femme
est dangereusement séductrice, la ville, elle, « engloutit les
gens dans la foule comme un démon affamé », tel le malheureux
personnage à la fin de la nouvelle « Jeu » (Yóuxì
游戏) [他就混在人群中被这饿鬼似的都会吞了进去了].
Quand les personnages tentent un retour à la campagne, dans
« Paysages » (风景),
la femme est « comme un oiseau libéré de sa cage », l’homme,
lui, se sent envahi « d’une ardeur primitive » (同时又觉得一道原始的热火从他的身体上流过去。).
Mais
finalement, dit Christiane P., c’est la ville qui a le
dernier mot.
[il y a là un
aspect caricatural, la caricature de l’époque étant justement
l’un des axes de recherche de la traductrice,
Marie Laureillard,]
Ce qui domine,
c’est l’impression de vitesse, comme au tout début de cette même
nouvelle : le train file, les champs, les ruisseaux défilent (原野飞过了。小河飞过了),
« les gens sont assis sur la vitesse même » (人们是坐在速度的上面的。).
Cela a rappelé à Giselle les
propos sur la vitesse
d’Alain, qui datent aussi de 1932.
Quant aux mots
étrangers qui émaillent le texte, ils lui ont semblé pur
snobisme.
Ø
Christiane P.
a bien aimé ce style très moderne, très vivant, comme
kaléidoscopique. Ce n’est pas intellectuel, tout est dans la
sensation du moment. Ce sont des fragments de vie, avec la ville
moderne en arrière-plan. Et cela change agréablement, dit-elle,
de tous les textes confucianistes.
Christiane
partage l’analyse de la nouvelle « Flux » (流)
faite par Marie Laureillard en postface à sa traduction,
concernant la fluidité des images, des lumières et des couleurs,
et la sensation de réalité fragmentaire (traduction p. 174).
Pour elle, Liu
Na’ou est à l’opposé de Tanizaki, et en particulier de son roman
« Un amour insensé » qui se passe dans le Japon des années 1920
et qu’elle trouve quasiment névrotique, avec un personnage de
jeune serveuse de 15 ans qui rêve de « devenir moderne »,
c’est-à-dire occidentalisée ; c’est une histoire d’amour
destructrice et de désir brutal, qui frôle le sadomasochisme.
Rien de cela dans « Flux » - elle a bien aimé, dans cette
nouvelle, le portrait de Xiaoying (晓瑛) :
cheveux courts, « femme moderne d’allure masculine, au teint mat
et aux membres fermes et solides », « comme un animal femelle »
(她可以说是一个近代的男性化了的女子。肌肤是浅黑的,发育了的四肢像是母兽的一样地粗大而有弹力。).
Et en plus c’est quelqu’un qui lit des livres sérieux, comme la
« Théorie du matérialisme historique » de Boukharine dont elle
ne comprend pas tout, à commencer par le titre !
Christiane
a
par ailleurs bien aimé « Un cœur ardent » (Rèqíng zhī gǔ
热情之骨)
et le portrait du Français Pierre, mais surtout « La couverture
ouatinée » (Mián bèi
绵被)
pour sa satire sociale dont on trouve aussi un écho dans
« Flux » : évocation des mouvements ouvriers à Shanghai, avec
manifestants dans la rue brandissant des petits drapeaux rouges,
le protagoniste de l’histoire se laissant entraîner dans la
foule « pour agir » au lieu de se laisser exploiter !
Ø
Françoise J.
a elle aussi apprécié l’évocation du prolétariat urbain dans
cette nouvelle : « Cette ville n’existait que grâce à ces gens
sales, à la peau basanée… Oui, ils étaient le sang de la
métropole, ils se tuaient à la tâche pour actionner les machines
et permettre aux gens de manger et de s’habiller… Ils avaient
bâti de leurs mains tout ce qui s’y trouvait… pourtant on le
faisait trimer comme des bêtes de somme… »
Elle a bien
aimé aussi les pages sur la peinture, et la peinture de nu en
particulier, dans « Rituels et hygiène » (礼仪和卫生) :
le modèle comme dépourvu de sentiments tenant la pose sans
bouger, laissant au visiteur tout loisir de l’observer, comme un
paysage. Ce qui lui a rappelé le livre de François Jullien « Le
Nu impossible ».
Etant un
monologue intérieur, « Le deuil » ( 残留)
lui a semblé intéressant dans sa forme, mais aussi dans
l’évocation d’une grande solitude, tandis que « L’équation » (方程式),
au contraire, lui a paru une caricature très drôle, avec cette
femme dont le seul élément de séduction est son talent pour
réussir les salades vertes ; le veuf n’est guère éploré, il lui
manque juste ses salades, et finalement accepte de se remarier
sans broncher ni choisir : la femme est tout juste un élément de
confort dans la vie.
Dans la
nouvelle qui se passe « Sous les tropiques » (赤道下),
elle a trouvé drôle aussi que l’homme ait voulu quitter la ville
pour éloigner sa femme de ses prétendants, mais juste pour se
retrouver aux prises avec la concurrence inattendue du
domestique indigène. Françoise a trouvé particulièrement
savoureuse la visite du village indigène, avec danses sauvages
« à faire rougir une femme civilisée », « bananes du chef » et
durians au menu. L’atmosphère de la nouvelle « Tentative
d’assassinat » (杀人未遂)
lui a rappelé Tanizaki, mais la fin de la dernière, « Un éternel
sourire » (永远的微笑),
lui a semblé être parfaitement à l’image de tous ces récits : ce
ne sont finalement que des impressions fugitives.
Ø
Dorothée MS
rebondit sur la nouvelle « Rituels et hygiène » : la scène de
l’atelier avec le modèle impassible lui a aussitôt rappelé
l’Olympia de Manet.
[on pourrait
aussi penser à la « Moderne Olympia » de Cézanne avec son voyeur
impénitent comme dans la nouvelle]
Elle a bien
aimé la description de la ville au printemps comme une promesse,
au début de cette même nouvelle, et de même, dans le monologue
du « Deuil », l’évocation de l’air revivifiant de la rue, dans
la nuit : « Moins il y a de monde, mieux c’est : je peux
profiter du silence de la nuit dans la ville déserte ! » (越没有人越好的,干脆的这都市尽变了沙漠吧!让我一个人来领略深夜的寂静。啊,这大气真爽快!这是活力素,很有裨益。)
L’atmosphère
de la Shanghai de la fin des années 1920 telle qu’elle apparaît
dans ces nouvelles lui a rappelé celle de « Berlin
Alexanderplatz » d’Alfred Döblin, publié en 1929, avec de
manière analogue, une écriture mâtinée de dialecte berlinois qui
fut décriée par les professeurs d’allemand et les puristes de la
langue allemande, comme le chinois hybride de Liu Na’ou a pu et
peut surprendre, voire choquer. Le roman de Döblin fut
d’ailleurs la cible des autodafés des nazis dès 1933. Par
ailleurs, Döblin a réécrit « Berlin Alexanderplatz » après avoir
lu le « Ulysses » de James Joyce (paru en 1922 à Paris), si bien
que l’on peut se demander, comme l’a fait Giselle, si ce
roman a également influencé Liu Na’ou…
[Ce n’est
peut-être pas directement « Ulysses » qui a inspiré Liu Na’ou et
ses confrères du néosensationnisme. mais plutôt les techniques
du flux de conscience (“意识流”). En
novembre 1922,
Mao Dun
a écrit un court article dans le « Mensuel de la fiction » (Xiaoshuo
yuebao《
小说月报》)
pour présenter « Ulysses ». Et Xu Zhimo (徐志摩)
de son côté y a fait allusion dans la préface de son poème
« Crépuscule dans la nature sauvage à l’ouest de Cambridge » (《康桥西野暮色》).
L’année suivante, en 1923, Lin Ruji (林如稷)
a publié, dans la revue littéraire « Asakusa » (《浅草》杂志)
qu’il avait fondée, la nouvelle « Le passé » (《将过去》)
qui est considérée comme la première nouvelle chinoise écrite en
flux de conscience. En 1929, Zhao Jingshen (赵景深)
a publié dans le même Xiaoshuo yuebao un article intitulé
« La fiction britannique des vingt dernières années » (《二十年来的英国小说》)
dans lequel il fait un lien entre Joyce et la psychanalyse, et
interprète la théorie du flux de conscience de Virginia Woolf.
Les
néosensationnistes ont été les premiers en Chine à écrire des
récits en flux de conscience : la nouvelle « Deuil » dans le
présent recueil en est un exemple.]
Ø
Sylvie D.
a été attirée par le titre du livre et sa couverture, a aimé
les descriptions de Shanghai, mais a été déçue, car rien ne lui
évoquait vraiment la ville. Et dans « Paysages », de même, les
champs, les chaumières, les ponts de pierre, les saules
défilent, mais en fait on ne voit rien. Donc artifice d’écriture
sans attrait pour elle. Elle fait une exception pour « Flux »,
qui l’a intéressée pour son aspect social.
Ø
Françoise J.
a bien aimé la couverture elle aussi, et comme Giselle
elle a apprécié la peinture de Shanghai comme un mythe avec ses
« belles femmes » comme sur les cartes postales. C’est toute une
époque qui revit dans ces histoires. Mais elle a trouvé excessif
l’utilisation récurrente de mots étrangers.
Dans
l’ensemble, elle n’a pas trouvé la peinture des femmes vraiment
négative – après tout ce sont les hommes qui demandent le
mariage ! Parmi les caractéristiques des femmes, déjà notées :
les petits pieds. Ce n’est pas une nostalgie des pieds bandés ;
cela reste un élément de beauté, même chez les hommes, en Asie,
dit Françoise en citant un souvenir personnel (d’une amie
qui avait été fascinée par son mari parce qu’il avait des petits
pieds). Et Christiane d’ajouter que, selon son professeur
de qigong, le sourire vient d’abord des pieds…
Quant à la
scène dans l’atelier de peinture, pour aller dans le sens des
nombreuses références à Derain dans ces nouvelles, elle lui a
plutôt rappelé le « Nu
à la cruche »
de 1925 du musée de l’Orangerie, pour le visage atone du modèle.
Tous ces
couples lui ont évoqué Jules et Jim. Au passage, elle a trouvé
amusant que les horoscopes fassent une distinction entre vie
affective et vie dans le mariage.
Ø
Marion J.
avait de son côté, par erreur, lu le livre au programme de la
prochaine séance, les
Notes diverses sur la capitale de l'Ouest,
dans lesquelles elle avait plongé avec délices. C’est donc avec
le sentiment de tomber de haut qu’elle a ouvert le recueil de
Liu Na’ou, et elle l’a trouvé tellement insupportable qu’elle
n’est pas allée au-delà de la quatrième nouvelle.
Elle en a
ressenti une véritable antipathie pour les idées exprimées par
l’auteur, un désaccord profond avec l'amalgame de deux idées
très éloignées : d'une part celle de la femme se libérant du
rôle qui lui est assigné par la tradition et la société, de
l'autre le fantasme masculin de liberté sexuelle assumé par la
femme, sans indépendance économique. Les femmes ? Un désir
primaire au même titre que les bonbons et le foot. La vitesse ?
Malraux l’a dit dans ses entretiens des années 1960, elle
modifie le rapport à l’écrit, de même qu’Isaac Babel regrettait
ne pas avoir le temps d’écrire.
Frustrée de ne
pas avoir réussi à bien exprimer ce qu’elle ressentait, car sa
lecture était trop fraîche, elle a ajouté par mail ensuite que
la Shanghai de Liu Na’ou lui rappelait les années Batista à
Cuba. Un pays en transition, un exil rural, une ville
concentrant une présence étrangère, une cohabitation de mœurs
jusqu'alors incompatibles, et la prostitution comme moyen de
survie.
Ou encore une fin de règne comme celle illustrée par les
caricatures grinçantes de George Grosz. Et au Döblin évoqué par
Dorothée elle aurait volontiers joint Musil, et Céline
pour New York : des écrivains qui ont su voir la détresse
au-delà du mirage.
[George Grosz,
d’ailleurs, est une référence particulièrement intéressante ici,
car il a peint (en 1916-1917) deux tableaux intitulés « Metropolis »,
véhiculant une vision cauchemardesque de la ville aussi bien que
le profond dégoût pour l’humanité propre au peintre. Un critique
de l’époque a parlé des « rouges d’une palette suicidaire ». Car
l’épicentre des deux tableaux se situe aux alentours de la gare
de la Friedrichstrasse, haut-lieu de la vie nocturne berlinoise,
avec ses cafés… et ses prostituées. Otto Dix poursuivra en 1928
par un triptyque dans son réalisme cynique usuel, simplement
intitulé Großstadt ou « La
Grande Ville »
(mais qui peut aussi se traduire par Metropolis). Le film
de Fritz Lang auquel se réfère Liu Na’ou pour sa part est d’une
approche totalement différente, conférant à la ville une
dimension mythique.]
Ø
Laura,
pour sa part, avait lu le recueil il y a un an pour préparer la
rencontre avec
Marie Laureillard
et son
éditeur Serge Safran à la librairie
le 19 janvier 2024.
Le recueil s’inscrit dans le cadre des recherches de la
traductrice sur la caricature, en particulier à Shanghai dans
les années 1930, sujet qui est celui de son prochain ouvrage qui
devrait paraître sous peu.
Laura
a bien aimé la manière dont Liu Na’ou observe, sans chercher à
moraliser ni passer de jugement. Il observe les relations
hommes/femmes dans un monde nouveau, où chacun cherche sa place
et où se définissent de nouveaux rôles. Ainsi, dans le train
(dans « Paysages »), la réaction de la femme est inattendue, et
ambivalente. Mais le sentiment qui domine toutes ces nouvelles,
c’est la solitude. Solitude au milieu de la foule de la ville,
de la foule des bars, des dancings, des restaurants, des
cinémas.
La nouvelle
que Laura n’a pas aimé – et c’est l’avis général – c’est
A Lady to keep you company : tentative d’écriture de
scénario ratée. Elle n’a pas beaucoup aimé non plus le
personnage de la banquière dans « Tentative d’assassinat ». Mais
ce qu’elle a apprécié, c’est qu’il s’agit dans ces nouvelles de
quelque chose d’autre, de différent. Avis que partage aussi
LLP : c’est rafraîchissant, dit-elle, comme du Murakami.
Ø
LLP
a été frappée, justement, par plusieurs caractéristiques de
l’écriture de Liu Na’ou qui changent sur ce qu’on a l’habitude
de lire en littérature chinoise, à commencer par l’omniprésence
de l’érotisme et le caractère pictural de l’écriture.
-
L’érotisme est omniprésent,
d’abord dans
l’écriture du phantasme masculin de la femme fatale, sans cesse
offerte au regard et au désir masculin, et dans une mise en
scène d’une sexualité libre : ainsi fait-il dire à une veuve qui
vient de perdre son mari « Ah ! Avoir la poitrine dégagée est
si agréable. Regardez mes seins reprennent vie comme s’ils
avaient reçu la rosée bienfaisante. Qu’ils sont beaux à balloter
comme ça !... » (« Deuil », trad. p. 91) – ce qui,
paradoxalement, n’empêche pas une représentation féministe de la
femme moderne et émancipée dans le sillage du mouvement du 4 mai
1919 :
§
« De
caractère intrépide et spontané, elle semblait exprimer à la
fois par ses paroles et à travers ses mouvements tout le
ressentiment face à l’oppression masculine subie par les femmes
depuis des siècles » (« Paysages » p. 18)
§
:
« elle avait plutôt l’air d’une femme moderne d’allure
masculine » - elle a une coupe à la garçonne (Xiaoying dans
« Flux » p. 32).
J’ignorais,
dit LLP, que la littérature chinoise moderne pouvait
abordait ces thématiques de manière aussi libre, et pouvant
aller jusqu’à des scènes de tentative de viol ou carrément de
viol (viol de la banquière dans la chambre forte, dans
« Tentative d’assassinat » p. 138 ; dans « L’éternel sourire »
Luo Kuang se met à boire et « tenta de déshonorer la jeune
fille » p. 163-164, etc.). Et cela peut même aller
jusqu’à des phantasmes pédophiles (Jingqiu, dans « Flux », est
ému d’entendre une fillette lui déclarer son amour : « Il eut
brusquement une envie irrépressible d’enlacer ce corps frêle »
et il finit par l’embrasser p. 36) ; on a des personnages de
prostituées mineures de 14-15 ans, et Mister Y quant à
lui « a une préférence pour les teens »…
-
L’écriture picturale donne
des descriptions impressionnistes : « Le clair de lune
faisait danser sur l’onde des écailles de poisson dorées »
(« Un cœur ardent » p. 54). On trouve de nombreuses références
picturales occidentales : Derain et les expressionnistes
allemands dans « Paysages » et dans « Rituels et Hygiène », mais
aussi Gauguin dans « Sous les tropiques » (« Quiconque aurait
vu la scène sans connaître Zhen aurait eu le sentiment de voir
une peinture de Gauguin », p. 117). Mais, dans « Rituels et
Hygiène », c’est la peinture orientale qui devient métaphore de
l’écriture : « Il n’en va pas de même pour la peinture
orientale : ces lignes et ces formes imprécises ne
stimulent-elles pas l’imagination ? L’imagination évoque la
réalité comme l’ombre révèle le corps » (p. 74).
LLP
a été
frappée par l’ouverture sur l’étranger, mais aussi par la bonne
connaissance du Paris underground de l’époque. Ainsi dans « Un
cœur ardent » : « Au Bois de Boulogne, il déflorait les
étudiantes à la belle étoile » p. 50, ou « les femmes
peinturlurées dansant frénétiquement le charlestone sur les
tables » p.51. En revanche la pléthore d’anglicismes lui a
rappelé les personnages dont se moque
Qian Zhongshu (钱钟书)
dans « La
Forteresse assiégée » (《围城》).
C’est un humour différent que celui de Liu Na’ou, mais
qui peut être très drôle, comme dans « L’équation », quand il
ironise sur l’amour des salades vertes de Mister Y.
Enfin, malgré
le modernisme, LLP a noté des éléments de merveilleux
empreints de tradition : présence d’un esprit-renard dans
« Rituels et Hygiène » et dans « Flux » (Jingqiu est « comme
ensorcelé par un esprit-renard » p. 38, « Deux renards
jaunes bondirent et se perchèrent sur les épaules d’une fille
aux yeux bleus. Alors Jingqiu entra soudain dans un conte de
fées. » p. 39). Et ce conte de fées se retrouve dans « Un
cœur ardent » (« Une jolie fille surgit de cet environnement
floral telle une fée » p. 48, « Vous semblez venir tout
droit du jardin du dieu du printemps » p. 49). Elle a même
cru noter une allusion au
Mudanting (《牡丹亭》)
et au personnage de la Fée des fleurs, outre la mention de la
« mélancolie printanière » (chūnchóu春愁)
dans « Rituels et Hygiène », en latin puis en anglais.
Ces nouvelles
sont dénuées de dimension politique, même dans la mise en scène
des prostituées contrairement à
l’écriture de Lao She (老舍)
[et en particulier la nouvelle « Le croissant de lune » (《月牙儿》)].
La nouvelle la plus politique est « Flux » avec les allusions
aux mouvements de grève à Shanghai dans les années 1920.
Les autres
membres du club présents avaient lu les nouvelles en chinois,
mais, contrairement à Zh. Dengyan, dans des éditions
plus récentes, en caractères simplifiés. Elles se sont elles
aussi étonnées des bizarreries d’une langue fortement teintée de
termes japonais, mais aussi souvent grammaticalement
« exotique » et d’une lecture malaisée.
II. La
forme : un chinois étrange, mâtiné de japonais
Ø
L’impression première ressentie par MRC en lisant ces
nouvelles en chinois, sur WeChat-lecture comme précédemment
celles de Lao She,
a été « d’avoir déjà lu ce style d’écriture quelque part ». Il
s’est dit que c’était un style fortement japonais, et quelques
noms d’écrivains lui sont venus à l’esprit : Kawabata pour
« Pays de neige », Dazai Osamu pour la ressemblance entre les
personnages, perdus dans leur émotions.
Tous ces
récits sont des histoires d’amour entre hommes et femmes, chacun
ayant au moins un personnage qui est plus ou moins fou d’amour,
ou obsédé par l’amour. Si on compare les personnages, cependant,
les femmes paraissent plus riches et complexes ; certaines
peuvent être réalistes et pragmatiques (« Un cœur ardent » ),
d’autres ambivalentes, avec un rien de mystère, comme dans
« Tentative d’assassinat ». La description des femmes est celle
d’un regard masculin, avec deux exceptions : « La couverture
ouatinée » et « Deuil », écrites d’un point de vue féminin.
Malgré tout, MRC rejoint l’avis général dans le groupe :
on sent toujours que c'est une vision de la femme imaginée par
un homme.
Sa nouvelle
préférée est « Tentative d’assassinat ». parce qu’il aime ce
genre de description détaillée, un peu psychanalytique.
L’héroïne est adorable, mais a aussi un côté froid et
inconstant, ce qui la rend mystérieuse. En même temps, le héros
semble morbide et hystérique. Toutefois, le personnage féminin
lui a semblé malgré tout « un peu incomplet, comme un trépied
auquel il manquerait un pied ». Mais le style ne l’a pas gêné,
au contraire.
C’est
cependant ce qui a le plus surpris Zh. Guochuan et W.
Lei, comme Zh. Dengyan.
Ø
Guochuan
avait lu les
nouvelles dans l’édition de 1997 trouvée à la Bulac,
et elle a tout de suite été arrêtée par ses phrases aux
tournures bizarres qui demandent un effort de compréhension.
Ainsi dans la
nouvelle « Paysages » (风景) :
“夫人直线的地请我,我只好直线的地从命是了。”
Si une dame
me sollicite aussi directement, je ne peux qu'obtempérer.
Dans
l’expression
"直线的地",
on reconnaît l’idée de
"打直球",
qui signifie exprimer son souhait de manière directe, sans
détour. Mais ce n’est pas usuel.
Le recueil est
préfacé, et l’auteur de la préface (Zhang Guo’an
张国安)
explique l’écriture de Liu Na’ou en l’opposant à celle de
Shen Congwen (沈从文),
grand maître du
courant littéraire opposé, le jingpai
:
沈从文的单纯和全然,是自然而然的。刘呐鸥的则矫揉造作,是造作人为的单纯和全然。
« La
simplicité de Shen Congwen est d’un grand naturel ; celle de Liu
Na’ou est artificielle. »
Ce qui est
normal, ajoute le préfacier : l’une est celle de la nature du
Xiangxi, l’autre a le côté artificiel de la ville. Bien plus :
Liu Na’ou a fait ses études au Japon, il maîtrise mal le chinois
et quand il écrit, c’est en s’appuyant sur sa propre traduction
d’un recueil de nouvelles japonaises (« Culture érotique »
《色情文化》).
Et Zhang Guo’an de conclure : « Lire ses nouvelles sans y
percevoir toute leur étrangeté serait anormal ».
[On notera ici
que cette édition des nouvelles de Liu Na’ou, en 1997, est à
replacer dans un contexte où Shen Congwen représentait un modèle
inégalé. C’est en 1995 qu’est parue, entre autres, aux
Etats-Unis la traduction d’un recueil de ses nouvelles, éditée
et présentée par Jeffrey C. Kinkley (« Imperfect Paradise : 24
stories by Shen Congwen », University of Hawai Press). Shen
Congwen lui-même s’était élevé contre une littérature où il
voyait un risque de dégénérescence de l’esprit créatif,
demandant aux écrivains comme aux éditeurs de « balayer cette
influence néfaste » (扫荡这种海派的坏影响).]
Cela reste une
tendance générale dans la critique chinoise, telle cette
appréciation relevée par W. Lei :
« M. Na’ou est
un citadin hypersensible qui, avec une précision chirurgicale,
dissèque le monde moderne dominé par l’aviation, le cinéma, le
jazz, les gratte-ciel, l’érotisme effréné…. À travers ses
œuvres, on distingue nettement les silhouettes d’une bourgeoisie
décadente, corrompue et malsaine, tout en devinant l’émergence
imminente d’une nouvelle force en gestation. » (Nouvelle
Littérature, vol. 2, n°1)
Ø
W.
Lei,
justement,
n’avait jamais entendu parler de cet écrivain auparavant, elle a
donc ouvert le recueil avec curiosité – dans l’édition plus
récente de 2004.
Elle y a
trouvé « un portrait saisissant de la décadence de la métropole
de Shanghai » : l’ivresse du luxe, la quête effrénée des
plaisirs, la vacuité et la déchéance de la bourgeoisie, mais
aussi la misère tragique des classes populaires et l’éveil
progressif d’une conscience de révolte chez certains groupes
marginalisés (dans « Flux »). Mais la place accordée aux
descriptions de la sensualité lui a semblé parfois excessive, au
point de générer une certaine lassitude. À force de lire, elle a
fini par se demander : “À part le désir charnel, y a-t-il
autre chose qu’il puisse aborder ?”
Au fur et à
mesure de sa lecture, un certain malaise a commencé à
s’installer, avec le sentiment, diffus mais insistant, d’une
possible misogynie sous-jacente dans ces récits. En
général, ce sont les femmes qui éveillent et attisent le désir
des hommes, et elles semblent considérer cette quête de plaisir
comme une banalité du quotidien, aussi ordinaire que boire du
thé ou prendre un repas. Cette légèreté excessive confère aux
figures féminines une superficialité déconcertante. Même
aujourd’hui, ce serait exagéré, alors en faire le modèle
dominant du monde urbain de l’époque le semble d’autant plus. La
nouvelle « Deuil », en ce sens, lui a paru sortir du lot par la
finesse et la profondeur de son analyse psychologique.
Malgré tout,
chaque nouvelle a un ton différent et un intérêt propre :
expérience immersive pour « Jeu », retournement de situation
habilement mené pour « Coeur ardent », ironie mordante pour « Rituels
et hygiène », chaleur humaine et tragique pour « La couverture
ouatinée », intrigue dramatique et chute inattendue pour
« Tentative d’assassinat », écriture scénaristique condensée
pour « Un éternel sourire ». On peut cependant regretter un
manque de profondeur descriptive, dû sans doute au rythme
trop rapide.
Le style,
cependant, n’a pas aidé sa lecture, en ajoutant au manque de
profondeur ressenti. Elle a remarqué une technique
d’écriture récurrente : l’accumulation de qualificatifs
précédant un nom dont ils sont épithètes, formant une structure
du type “的..的..的..的..的...
+ N”. Si cette méthode peut témoigner d’une certaine
maîtrise linguistique, elle donne parfois l’impression d’une
affectation stylistique excessive, rendant certains passages
inutilement alambiqués. Il lui est arrivé de devoir relire un
paragraphe plusieurs fois pour en identifier le sujet principal
et en comprendre pleinement le sens des phrases.
Par exemple :
“从泊拉达那斯的疏叶间漏过来的蓝青色的澄空,掠将颊边过去的和暖的气流,和这气流里的不知从何处带来的烂熟的栗子的甜的芳香,都使着比也尔薰醉在一种兴奋的快感中,早把出门时的忧郁赶回家里去了。”
(热情的骨,第一段)
Le ciel d’azur à travers les feuillages clairsemés des platanes,
l’air chaud caressant les joues, le doux parfum des châtaignes
mûres venu de nulle part, tout cela enivrait Pierre d’un plaisir
exaltant qui chassait la mélancolie qu’il avait ressentie en
sortant de chez lui » (Un cœur ardent, trad. ML, p. 47)
“启明是不愿意一个愉快的有美丽的妇人的茶会的时间被他那不大要紧的艺术论占了去。”
(礼仪与卫生)
“Qiming ne souhaitait pas qu’un agréable moment passé à prendre
le thé en compagnie de jolies femmes fût accaparé par ses propos
sur l’art qui n’avaient que bien peu d’importance.”(Rituels et
hygiène, trad. WL/BD)
[La traduction
en français ne permet pas de ressentir tout ce que les phrases
comportent d’alambiqué et de répétitif, comme un hoquet. Même si
en français on alignait les adjectifs, on n’aurait pas le même
effet.
Outre les
的
à répétition, on notera aussi, dans le premier exemple, le terme
boladanas (泊拉达那斯)
pour platane, qui est la translittération du latin platanus,
selon une méthode courante dans les années 1920 pour importer
des mots étrangers en chinois au lieu de les traduire, avec un
effet d’ « exotisme » comme celui ressenti par Qiming dans « Rituels
et hygiène »
]
Par ailleurs,
un autre aspect frappant du style de Liu Na’ou est l’usage
fréquent de mélanges de termes sino-anglo-français et
l’insertion de nombreux termes étrangers, translittérés comme
platane ci-dessus, mais le plus souvent de l’anglais, par
exemple
mìsītuō
(密斯脱)
pour Mr. ou
lǔbóte
(鲁伯特)
pour robot. Cependant, dans certains cas, l’emploi d’anglicismes
paraît artificiel, voire superflu. Ces mots viennent briser
l’harmonie du texte et semblent parfois en décalage avec le
reste du récit, rendant la lecture plus laborieuse.
En ce sens,
au-delà de l’aspect narratif « décadent » et de la peinture des
femmes « modernes », Lei a trouvé dans ces nouvelles
l’une des caractéristiques stylistiques notée dans un ouvrage
récent sur la littérature des années 1930 :
« Une
écriture plurilingue et hybride qui met en exergue son aspect
transculturel. ».
[Ce style
mérite des précisions complémentaires. Il est dû en grande
partie à l’éducation japonaise de Liu Na’ou qui, rentré en
Chine, de l’avis même de ses proches, ne maîtrisait pas bien le
chinois. On en a fait une marque d’originalité, mais c’est resté
une expérience isolée. Voir à cet égard l’analyse d’un chercheur
chinois que j’ai ajoutée à la
fin de
la présentation de Liu Na’ou et
qui est d’autant plus intéressante que l’auteur élargit la
réflexion au contexte de l’évolution de la langue chinoise dans
les années 1920.]
Conclusion
La séance
s’est donc terminée sur des questions concernant le style autant
que l’écrivain. Il a brièvement été question aussi de son
engagement dans le milieu du cinéma, dont on sait peu de choses,
au-delà du film de Li
Pingqian (李萍倩) inspiré
de « La Dame aux camélias » (《茶花女》)
qu’il a produit en 1938 et des quelques scénarios qu’il a
écrits.
On peut, sur
ce sujet, se référer à l’article d’une chercheuse de
l’université de Hong Kong sur « Liu
Na’ou et le "Soft Film Movement" des années 1930 à Shanghai »
- le concept de « soft film » étant en opposition avec les
« hard films », c’est-à-dire les films dits « de gauche » qui
se sont développés à partir du début des années 1930, en
parallèle avec la littérature.
En même temps,
la fin des années 1920 est le moment charnière du passage du
muet au parlant, le premier film « sonore » chinois étant « La
Chanteuse Pivoine rouge » (《歌女红牡丹》)
de
Zhang Shichuan (张石川)
sorti en 1931. Cependant, le cinéma parlant était en mandarin.
Or beaucoup des actrices du muet parlaient… le dialecte de
Shanghai ; certaines ont appris le mandarin, beaucoup ont
abandonné le cinéma. Ce qui pose à nouveau le problème de la
langue…
Prochaine
séance :
Le mercredi
12 mars 2025
Séance
consacrée aux
Notes diverses sur la capitale de l'Ouest,
de Liu Xin (劉歆/刘歆),
texte
établi et traduit par Jacques Pimpaneau, Les Belles Lettres,
Bibliothèque chinoise, 2016.
En lien ou non
avec
l’exposition du Musée Guimet
initialement intitulée Chang’an, resplendissante capitale de
l’empire Tang (jusqu’au 3 mars 2025).
Le nu
comme sujet artistique « légitime » a longtemps été
interdit en Chine. Il n’a été autorisé qu’après un
procès intenté dans les années 1920 par un peintre formé
au Japon et en France, Liu Haisu (刘海粟
1896-1994), qui a été directeur de l’Institut des
Beaux-Arts de Shanghai. Cependant, comme l’affirme Zhang
Zhen dans son ouvrage « Amourous History of the Silver
Screen » (University of Chicago, 2005, p. 277), son
triomphe « coïncidait avec la présence croissante des
femmes en public, dans une société en plein changement
qui en faisait des sujets à part entière, avec une
conscience croissante de cette évolution. » Cette
évolution se reflète dans la vie et l’œuvre de Pan
Yuliang (潘玉良
1895-1977), peintre, sculptrice et graveuse rachetée en
1913 à une maison close par un riche fonctionnaire
chinois qui en fait sa seconde épouse ; elle entre aux
Beaux-Arts de Paris en 1923 et en 1929 enseigne aux
Beaux-Arts de Shanghai. Les premières études de nus (par
elle-même et d’autres artistes chinoises) sont exposées
à Nankin en 1929, la nudité (féminine) devenant alors un
sujet de controverse dans un débat plus général sur la
beauté.
| |
 |
|
Pan Yuliang,
Nu assis
au peignoir rouge, 1955,
musée
Cernuschi Paris.
|

