|
Club de lecture de littérature
chinoise (CLLC)
Compte rendu de la séance du 9
avril 2025
et annonce de la séance suivante
par Brigitte Duzan, 15 avril 2025
Cette séance du 9 avril 2025 était consacrée au roman de
Chan Koonchung (陈冠中)
:
-
Les années
fastes (《盛世》),
trad. Denis Bénéjam, préface Julia Lowell, Grasset 2012.
Dans ce roman
écrit en 2008, et publié à Hong Kong en 2009, l’auteur imagine
la Chine en 2013. Ce ne sont que quelques années de distance,
mais le pays a changé en profondeur, bien que Chan Koonchung
n’ait fait qu’extrapoler les changements qu’il dit avoir perçus
depuis le début des années 2000, semblable en cela à beaucoup
d’autres observateurs : si les Jeux olympiques sont considérés
comme une période charnière dans l’histoire politique chinoise,
l’histoire ne connaît pas de ruptures, l’évolution est
cumulative.
Ce qui, dans
ce roman, a frappé les membres du club dans leur ensemble, c’est
son caractère quasi visionnaire, mais avec des nuances, et ce
sont les nuances qui nous intéressent.
Ø
Afin de contextualiser le roman de Chan Koonchung, Guochuan
a ouvert la séance par un
bref parcours historique du roman d’anticipation dans la
littérature chinoise. C’est un genre
peu développé, mais qui a ses lettres de noblesse : la « Cité
des chats » (《猫城记》)
de
Lao She (老舍)
en est un exemple célèbre qui dépeint les aventures d’un
astronaute
chinois qui découvre, en arrivant sur Mars, une société
d’hommes-chats qui ont tous
les défauts de la société chinoise. Il a eu tellement de succès
qu’il a été réédité sept fois
avant 1949.
[Publié en
1932, la même année que « Le Meilleur des mondes » (« Brave New
World ») d’Aldous Huxley, alors que les Japonais ont bombardé
Shanghai en janvier, c’est une satire désespérée mais indignée
des compromissions politiques qui déchirent la Chine. En ce
sens, il est effectivement à rapprocher du roman de Chan
Koonchung]
Ce genre de
roman a disparu en Chine en 1949 pour reparaître après la
Révolution culturelle, mais pour être à nouveau censuré dans le
cadre de la
campagne contre la pollution spirituelle (清除精神污染)
lancée en septembre 1983. [En tant que politique-fiction, il
encourt forcément les foudres du pouvoir.]
La préface
chinoise [comme celle de Julia Lowell pour les traductions en
anglais et en français] met l’accent sur la prise de conscience
par l’auteur de la montée du nationalisme et de l’autoritarisme
en Chine avant même l’année des Jeux olympiques de Pékin qui
l’ont mise en relief. Le roman montre l’importance de la crise
comme facteur favorisant l’autoritarisme, ce qui est déjà
inscrit dans l’étymologie du terme chinois, explique Guochuan :
la crise wēijī (危机)
signifie « opportunités générées par le danger ». Ce qui l’a
frappée, et choquée, c’est de lire sous la plume de Chan
Koonchung que la liberté en Occident vient du peuple, et qu’en
Chine elle est concédée par le pouvoir.
Le discours
d’une ironie frisant l’absurde prouvant l’inefficacité de la
démocratie, et par conséquent la supériorité du pouvoir absolu,
lui a rappelé les paradoxes et aphorismes de l’École des noms (名家),
courant de pensée de la période des Royaumes combattants qui
relève de l’art de la controverse et dont le paradoxe le plus
célèbre est celui du cheval blanc qui n’est pas un cheval.
[Le plus
célèbre de ces dialecticiens étant Gongsun Long (公孫龍)
cité au chapitre 33 du
Zhuangzi,
c’est-à-dire le dernier chapitre, Tiānxià 天下,
traitant des Écoles.
]
Mais cela a
également rappelé à Guochuan la philosophie de Hobbes
[dont le « Léviathan », publié en 1651, se fonde sur la
précision des termes et la rigueur du raisonnement pour fonder
une théorie de l’organisation politique et des lois morales de
la nation]. La théorie de Hobbes est fondée sur le postulat que
les hommes sont naturellement violents ; donc, par peur, ils
auront tendance à abdiquer leurs droits naturels, et leur
liberté, en faveur d’un despote qui leur garantira la paix, même
au prix de la répression.
|
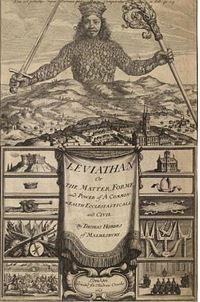 |
|
Frontispice du « Léviathan » de Hobbes
comme représentation emblématique du souverain
absolu
maniant le sceptre et l’épée au-dessus de la marée
humaine
|
[on notera
que l’une des traductions en chinois du titre de l’ouvrage de
Hobbes est Juling lun (《巨灵论》),
littéralement « discours sur l’esprit géant », Juling
étant textuellement cité dans le roman de Chan Koonchung, voir
note 5].
Ø
La lectrice la plus enthousiaste a été Sylvie, qui a
trouvé le roman peu ordinaire, et
intéressant pour son aspect prémonitoire de la réalité
contemporaine. Elle en a
particulièrement admiré la construction, l’épilogue final étant
très bien amené.
Elle a
beaucoup apprécié les biographies des divers personnages (dont
elle s’est dressé une liste pour ne pas s’y perdre), et
l’histoire de l’église souterraine qui, bien que grossie, reste
réaliste.
Il faut dire
cependant que quelques autres lectrices n’ont pas dépassé la
moitié du roman. C’est le cas de Dorothée, par exemple,
qui s’est perdue, elle, dans les personnages et a été rebutée,
de manière générale, par les longueurs et le ton dystopique.
Ø
LLP
s’est arrêtée en cours de route, elle aussi, mais pour une autre
raison : elle avait
lu le roman en 2013, lors de sa parution, et elle avait alors
littéralement dévoré cette
histoire qui prenait un sens particulier pour elle qui habitait
alors à Pékin. C’était juste
après l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping.
Reprenant le
roman douze ans plus tard, elle l’a trouvé lent et long et l’a
refermé au bout de 120 pages. Mais elle lui reconnaît un
caractère visionnaire, encore aujourd’hui : le mois perdu comme
les événements de 1989 aussi bien que la Grande Famine, toujours
passés sous silence et tombant dans l’oubli collectif, les
dénonciations des professeurs qui évoquent des cas récents ou
encore les achats compulsifs de nourriture comme pendant la
crise du covid. La situation actuelle est cependant bien pire et
on le mesure en relisant le roman, justement : si, en 2013, il
restait encore des espaces de liberté, ils ont aujourd’hui
quasiment disparu et on voit combien la disparition progressive
des libertés - dont la liberté d’expression - atrophie la pensée
et anesthésie les intellectuels.
Non seulement
la situation actuelle est pire qu’en 2013, mais il y a certains
faits que Chan Koonchung n’avait pas prévus, et en particulier
la mainmise de Pékin sur Hong Kong ; cela paraissait impensable
à l’époque où il écrivait, surtout pour un Hongkongais : Hong
Kong serait toujours Hong Kong.
LLP
a été intriguée par ce « groupe d’étude SS » dont il est
question dans le roman, écrit SS aussi dans le texte original
chinois ; il s’agit d’un jeu de mots à consonnance nazie sur les
initiales de deux théoriciens allemands qui ont fortement
influencé la pensée politique chinoise comme l’a souligné Anne
Cheng, rappelle LLP, dans son cours du Collège de France :
Carl Schmitt
et
Leo Strauss.
[Le premier
s’est prononcé à partir de 1930 en faveur d’une dictature
présidentielle, ses théories étant considérées comme le
fondement idéologique de la dictature nazie, prenant racine dans
« la discipline et le sens de l’ordre » du peuple allemand. Le
second, philosophe juif allemand réfugié aux États-Unis en 1937,
a réfléchi sur la crise des démocraties à son époque à partir de
ses études sur les libéralismes antiques : crise selon lui liée,
en grande partie, à la recherche du bonheur matériel par « le
plus grand nombre », avec une conception très particulière de la
liberté, les droits individuels étant ceux garantis par un État
puissant.]
Elle a trouvé
pénible, enfin, de ne pas savoir, très souvent, si ce que
raconte l’auteur est vrai ou de l’ordre de l’imaginaire – par
exemple le fait que les hôpitaux psychiatriques relèvent de la
sécurité publique. En y réfléchissant, on se dit que c’est faux,
mais c’est tellement vraisemblable, au fond, qu’on en conçoit
quelques doutes.
[Ce qui fait
penser au film de
Wang Bing (王兵)
« À
la folie » (《疯爱》),
documentaire de 2013 (justement) sur un hôpital psychiatrique du
Yunnan qui ressemble lui-même à de la fiction. Il repose sur les
mêmes idées que « L’histoire de la folie à l’âge classique » de
Michel Foucault : le fou étant le hors norme, dangereux pour
l’ordre social, donc à enfermer pour le canaliser ]
Ø
Marion
a été troublée par l’épilogue, présentant « l’idéalisme à la
chinoise » (中国式理
想主义者) :
les idéaux de toute une génération, celle de Xiao Xi [d’où son
prénom
initial de Xihong (希红),
l’espoir rouge] et de son ami Fang Caodi (方草地),
ont tourné
au cauchemar, mais sans leur faire abandonner leur idéalisme de
jeunesse. D’où
leurs recherches désespérées du « mois perdu » pour tenter de
comprendre ce qui
s’est passé.
Elle n’a pas
toujours compris ni mesuré l’ironie des propos, elle aussi
flottant entre réalité et fiction. Mais elle a trouvé certaines
formulations percutantes – le peuple a exécuté Socrate - et elle
a beaucoup aimé les anecdotes et faits divers, comme l’histoire
de l’esclave de la briqueterie, deux fois sauvé et revendu, qui
rappelle beaucoup d’histoires du même genre dans l’actualité
chinoise. L’idée d’une « harmonie autoritaire » comme celle
officialisée par Hu Jintao lui a fait froid dans le dos, de même
que la haine agissant comme aphrodisiaque ou l’idée que l’on
puisse être inadapté pour avoir fait des études de droit romain.
Elle s’est amusée de voir « Le Bain » (《洗澡》),
de
Yang Jiang (杨绛),
récemment
au programme du club,
parmi les ouvrages introuvables, et même « inexistants ». Mais
elle est restée marquée par la vision de l’avenir comme « une
nuit sans fin » (长夜漫漫),
avec évocation du « bon enfer » perdu de Lu
Xun (鲁迅),
comme un paradis perdu, justement.
[« Le bon
enfer perdu » (《失掉的好地狱》)
est le 14e des poèmes en prose du recueil « La
mauvaise herbe » (yěcǎo《野草》)
de
Lu Xun (鲁迅),]
Elle trouve
que Chan Koonchung est malgré tout resté en deçà de la réalité
actuelle, n’ayant pu prévoir ni le sort de Hong Kong, ni
l’évolution du régime actuel, et encore moins le chaos mondial
créé par Trump. Mais ce que Marion a trouvé de plus déprimant,
c’est l’idée que l’anarchie est nécessaire pour pouvoir
instaurer la dictature car elle permet de faire appel au désir
d’ordre social. Et en ce sens, le chaos actuel est favorable à
l’image du régime chinois comme garant de stabilité. La vision
du roman garde toute sa valeur.
D’ailleurs, à
ce propos, Lingling dit avoir noté, non sans étonnement,
l’expression dans son entourage (universitaire) d’une
satisfaction à tonalités nationalistes vis-à-vis de la capacité
affichée par le régime chinois à résister à la crise en
garantissant une certaine sécurité à la population. Cependant,
la confiance dans le régime a été fortement secouée par la crise
du covid ainsi que par la montée des problèmes économiques,
certains fonctionnaires, par exemple, attendant le paiement de
leurs salaires, modère Guochuan, ce qui a tendance a
créer un certain malaise.
Ø
Lingling
est arrivée à la séance du club de lecture après avoir lu in
extremis les
dernières pages du roman qui l’a fascinée. Mais elle s’est
demandé s’il l’aurait autant
intéressée
si elle l’avait lu
à sa parution, en 2009. Elle était au lycée et n’aurait
certainement pas pensé que tout ce que Chan Koonchung avait
imaginé puisse être
aussi proche de la réalité.
Constater que
la politique-fiction est maintenant la réalité fait peur.,
dit-elle. Surtout quand elle voit que l’euphorie générale
procurée dans le roman par l’ecstasy mélangée à l’eau du robinet
est semblable à celle de la population chinoise aujourd’hui,
comme anesthésiée par le discours officiel et l’amélioration des
conditions de vie matérielle. Elle compare les jeunes
d’aujourd’hui à ceux de sa jeunesse : c’était une jeunesse en
colère, et à l’époque on avait encore la possibilité de
l’exprimer. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune liberté
d’expression, donnant l’impression d’un apaisement général de la
population.
En fait, la
réalité est bien pire que la fiction de Chan Koonchung : il n’a
pas imaginé le cauchemar du covid et de la sortie brutale du
confinement, ni le mécontentement larvé provoqué par la crise
économique. Cependant, bien des choses dans le roman sont
ambigües. Lao Cheng est l’alter ego de l’auteur, mais on ne sait
jamais trop jusqu’où va l’ironie. Il n’attaque pas à fond les
intellectuels qui font des compromis avec le système.
Ø
MRC,
lui aussi, a trouvé le roman intéressant pour son aspect actuel
et pour ses
qualités à la fois narratives et formelles. L’ayant lu en
chinois, il l’a trouvé
particulièrement bien écrit, d’autant plus qu’on ne sait pas,
bien souvent, distinguer
l’anticipation
de la réalité.
Du point de
vue de la narration, il a retrouvé dans ce roman des
éléments typiques des romans policiers que l’auteur avait écrits
auparavant, surtout dans la dernière partie, le kidnapping de He
Dongsheng. On voit comment les deux parties en présence se
manipulent mutuellement et parviennent à un équilibre de la
terreur. Plusieurs détails des épisodes précédents servent de
préparation à cet épisode conclusif. Par exemple, dans les
chapitres précédents, un policier a contrôlé une première fois
la voiture de He Dongsheng ; par conséquent, plus tard, lors du
kidnapping, quand la même voiture est contrôlée une deuxième
fois par le même policier, il connaît déjà l’identité du
passager et le laisse passer sans problème. Il y a ainsi
beaucoup d’autres effets d’écho qui créent une grande cohérence
dans la structure narrative du roman.
En lisant le long monologue
explicatif de He Dongsheng qui constitue toute la dernière
partie, cependant, MRC s’est dit que le récit aurait pu
être plus vivant s’il avait été écrit sous forme de dialogue
entre Dongsheng et ses kidnappeurs. Mais la discussion pendant
la séance du club de lecture l’a fait changer d’avis : le
monologue est intentionnel et significatif,
la
théorie de gouvernance exposée par Dongsheng est tellement
convaincante qu’elle ne permet pas de contradiction, Lao Chen et
Xiao Xi restent sans voix [après avoir vainement tenté de le
convaincre des avantages de la démocratie].
Il a trouvé la galerie de
personnages très intéressante dans sa diversité. Wei Guo,
par exemple, est représentatif des jeunes qui rêvent de devenir
hauts fonctionnaires pour se donner à fond pour le pays et en
accroître la puissance. Mais la plupart ne se soucient pas de
politique et préfèrent vivre en profitant de la prospérité, bien
qu’illusoire. La réalité est tellement amère et difficile,
autant se donner du bon temps. Dans la réalité, il n’y a pas
besoin d’ecstasy dans l’eau… L’auteur, en fait, montre une
grande empathie envers ces personnages-là qui, grandissant dans
un environnement où tous les moyens d’expression sont contrôlés,
finissent par se contenter de leur quotidien dans
l’indifférence, sans (se) poser de questions. Les individus
comme Xiao Xi qui recherchent la vérité sont solitaires et
marginalisés et ne constituent qu’une partie infime de la
population, sans qu’elle soit négligeable pour autant.
MRC
a aussi beaucoup aimé le style, en remarquant les
différences correspondant à l’identité des personnages. Il a
ainsi noté les particularités du langage et du vocabulaire de
Wei Guo, qui est pékinois, et de Lao Chen qui a des inflexions
taïwanaises. Il a noté divers termes devenus populaires… ce qui
entraîne une discussion, entre autres sur le terme
xiao fenhong
(小粉红),
les « petits roses », ces nationalistes agressifs du web dont
Wei Guo, justement, est un exemple.
[sur lesquels, souligne Lei,
on trouve un chapitre dans le livre récent de Gilles Guiheux
« Quand la Chine parle » (p. 83)]
Ø
Lei,
justement, a été
particulièrement sensible au style du roman, qu’elle a lu en
chinois dans une version téléchargée sur internet. Les
romans et les films de science-fiction étant souvent perçus
comme une forme de prophétie du monde réel, en tant que roman de
politique-fiction, « Les Années fastes » lui est apparu comme
une réussite remarquable : l’auteur parvient à anticiper de
manière frappante les dynamiques sociales chinoises entre 2008
et 2013. Il réussit à peindre une Chine relevant presque du
réalisme magique (魔幻现实主义).
Le roman
couvre un large éventail de sujets : politique, économie,
relations internationales et diplomatie, religion, système
judiciaire chinois, société urbaine et rurale, vie quotidienne
et relations sociales en Chine. Dans ce contexte, les
personnages incarnent chacun une communauté ou un groupe : Xiao
Xi représente les intellectuels engagés (公知),
Lao Chen les intellectuels des régions de Hong Kong, Macao et
Taïwan, Wei Guo les jeunes idéalistes à ambition politique (小粉红),
Wen Lan une « intellectuelle égoïste raffinée » (精致利己主义),
et He Dongsheng un haut fonctionnaire du gouvernement chinois.
Les liens entre les personnages sont savamment tissés. Des
individus sans lien apparent se retrouvent subtilement
connectés. Par exemple, Zhang Dou, inconnu de Xiao Xi, s’avère
être le jeune homme qui avait pris sa défense lors d’un
rendez-vous arrangé des années auparavant.
Le style
change radicalement entre les deux parties du roman : la première partie, de facture narrative
classique, présente les personnages et les événements à travers
dialogues et descriptions ; la seconde, en revanche, adopte un
ton plus discursif, proche du discours politique.
Les
thématiques du roman peuvent être analysées en termes lexicaux.
1/
Le sentiment
de bonheur et l’amnésie collective de la population chinoise
(中国人的幸福感和集体失忆),
thème qui fait écho à la réalité sociale de la Chine actuelle :
le peuple ne parle plus des « grands événements » passés, chacun
est tourné vers l’avenir, occupé à gagner et dépenser de
l’argent (« 大家都向前看,忙着赚钱和花钱 » ). La
population se sent satisfaite de sa vie en Chine, ne rêve plus
du mode de vie à l’étranger (notamment en Europe et en Amérique
du nord), et se satisfait des contenus des média chinois. À cet
égard, l’idée de « boisson euphorisante » (« 快乐水
») diffusée dans tout le pays est une métaphore claire. Dans la
Chine d’aujourd’hui, l’abondance matérielle, notamment
alimentaire, et le confort quotidien génèrent un plaisir
chimique assimilable à de la dopamine (多巴胺)
comparable à celui provoqué par cette mystérieuse boisson. La
dopamine ainsi créée pourrait être le véritable ingrédient de
cette potion du bonheur.
La quête de
Fang Caodi pour comprendre les raisons de cette amnésie
collective reste vaine. L’explication de He Dongsheng en fin de
roman apporte un éclairage et des éléments de réponse :
« Si le peuple
n’avait pas choisi d’oublier, nous n’aurions pas pu le forcer à
le faire. C’est le peuple lui-même qui a volontairement pris le
médicament de l’oubli. » (“如果老百姓没有选择忘记,我们也不可能强迫忘记,是老百姓主动选择了吃健忘药。”),
« Peut-être
l’homme est-il une créature oublieuse par nature, ou bien les
gens désirent-ils oublier certaines pages de l’histoire. » (“对于集体失忆,我也无法解释,可能人就是善忘的动物,可能人们渴望忘记某些历史。”).
« Dans une
société modérément prospère, le peuple craint davantage le chaos
que la dictature. » (“小康社会,人民怕乱多于怕专政”。)
Ces propos
reflètent profondément l’optimisme et l’esprit pragmatique,
autrement dit certaines croyances culturelles des Chinois, comme
« le peuple dépend de la nourriture pour vivre » (民以食为天)
- importance primordiale du confort matériel - et « la paix dans
la famille mène à la prospérité » (家和万事兴)
- la stabilité est la condition essentielle de toute réussite.
2/ Concernant
le système autoritaire, les positions des intellectuels publics
(Xiao Xi et Fang Caodi), des représentants gouvernementaux (He
Dongsheng) et du peuple apparaissent nettement contrastées.
L’idée selon laquelle « seul le régime autoritaire convient à la
Chine » ou que « seules de grandes crises peuvent
légitimer le pouvoir autoritaire » (comme le dit He Dongsheng :
“只有大危机才能让老百姓心悦臣服地相信专制政府”), aussi bien
que la croyance du peuple en un « esprit géant » (jùlíng巨灵)
salvateur ou sa foi dans la capacité du gouvernement chinois à
faire d’un danger une opportunité (转危为机),
tout cela représente un ensemble de slogans largement répandus
en Chine aujourd’hui. Dans la seconde partie du roman, les rares
tentatives de contre-argumentation de Xiao Xi, Fang Caodi et Lao
Chen face au discours monopolistique et quasi-officiel de He
Dongsheng apparaissent faibles et désespérées.
3/ Concernant
l’économie, le roman évoque le virage des grandes puissances
vers un modèle économique axé sur la consommation intérieure (nèixū内需)
plutôt que sur le commerce extérieur. Ce constat s’inscrit dans
la réalité récente, en particulier en Chine. L’idée d’une
« société généralisée de commerçants » (quánmín
jiēshāng全民皆商)
fait aussi écho à la Chine post-COVID : économie du stand (ou
économie informelle, bǎitān
jīngjì
摆摊经济),
popularisation des influenceurs en live-streaming (wǎnghóng
zhíbō网红直播),
emploi à mi-temps comme livreurs ou chauffeurs de taxi privé (wàimài
yuán & dīdī sījī
外卖员和滴滴司机)…
chacun cherche des revenus complémentaires dans une économie
plus ou moins informelle.
À ce sujet,
Lei renvoie à nouveau à l’ouvrage de Gilles Guiheux déjà
cité [« Les petits grands frères de la livraison » peisong
xiaoge
配送小哥,
p. 31], mais aussi au film de Xu
Zheng (徐峥)
« Upstream »
(《逆行人生》)
sorti en Chine pendant l’été 2024 [en provoquant un tollé en
raison de la dérision avec laquelle le film dépeint ces
malheureux livreurs].
4/ La peinture
des relations internationales est incroyablement prémonitoire :
dans son monologue, He Dongsheng expose dans ses grandes lignes
la stratégie diplomatique chinoise du 21e siècle en
évoquant les relations sino-africaines, sino-américaines,
sino-russes, ainsi que les alliances économiques régionales. Le
fait que la Chine cherche à retrouver sa place dans le monde par
l’économie plutôt que par la guerre renvoie potentiellement à
des projets comme l’initiative des Nouvelles Routes de la Soie.
Ces perspectives sont conformes aux dynamiques actuelles, seule
la description d’une amitié sino-japonaise paraît quelque peu
optimiste.
Le roman dans
son ensemble lui a paru étrangement lucide et prémonitoire,
comme si l’auteur avait eu accès à des sources officieuses, au
contact de cercles proches du pouvoir. Elle l’a trouvé assez
déprimant dans son réalisme : pourquoi avoir forcé la population
à oublier, est la question posée à He Dongsheng à la fin. « Mais
parce que, sans cela, le régime n’aurait rien pu faire » ...
Lei
en a
cependant retenu la phrase finale qui lui semble porteuse
d’espoir malgré tout :
“…两人(小希和老陈)半遮着自己的眼睛,迎着刺目的晨光,走着。”
« [Vers l’est
le ciel était clair], et tous deux (Xiao Xi et Lao Chen) s’en
furent en se protégeant à moitié les yeux de la lumière
aveuglante du petit matin. ».
Pour l’an
prochain
Porté par son
succès au box-office après sa sortie en Chine, le 25 janvier
dernier, et par la fierté nationaliste qu’il y suscite, le film
d’animation « Nezha 2 » (《哪吒之魔童闹海》)
va sortir sur les écrans français le 23 avril prochain. Il
arrive avec une publicité tapageuse et des louanges
dithyrambiques uniquement adressées aux prouesses techniques
qu’il représente et au chiffre des recettes qu’il a engrangées.
Nezha sera
donc au programme de la dernière séance de 2026 du club de
lecture (en lieu et place d’un programme de poésie reporté à
plus tard), en partant du roman « L’investiture des dieux » (《封神演义》)
où le personnage trouve sa source :
http://www.chinese-shortstories.com/Clubs_de_lecture_CLLC_programme_2025_2026.htm
Prochaine
séance :
Le mercredi
14 mai 2025
Cette séance
sera consacrée aux nouvelles de
Mo Yan
(莫言) :
-
Lèvres rouges, langue verte, trad. Chantal Chen-Andro et
François Sastourné, Seuil, 2024.
|

