|
Club de lecture de littérature
chinoise (CLLC)
Compte rendu de la séance du 19
octobre 2023
et annonce de la séance suivante
par Brigitte
Duzan, 21 octobre 2023
À la suite de
la
séance du 20
septembre
qui était consacrée à Harry Wu/
Wu Hongda (吴弘达)
en introduction
à
la littérature
du laogai, le programme de cette séance comportait deux
des romans autobiographiques de
Zhang
Xianliang (张贤亮) :
-
La moitié de l’homme c’est la femme (《男人的一半是女人》),
trad. Yang Yuanliang avec la collaboration de Michelle Loi,
Belfond, 1987/2004, 300 p.
-
La mort est
une habitude (《习惯死亡》),
trad. An Mingshan et Michelle Loi, avant-propos de Michelle Loi,
Belfond, 1994/2004, 288 p.
Romans auxquels il était suggéré d’ajouter (suggéré car plus
difficile à trouver)
le
zhongpian (ou novella) de 1984 qui peut être considéré comme
le volet introductif d’une trilogie formée avec les deux romans
écrits par la suite :
- Mimosa (《绿化树》),
coll. Panda 1986/1995, rééd. Favre/Interforum 1987).
| |

La
moitié de l’homme c’est la femme,
édition chinoise, juillet 2000 (association des
écrivains) |
|
Le temps de
compter les présents et regretter les absents, la séance a
débuté par l’avis de la première volontaire.
o
Lingling
a commencé par lire « La moitié de l’homme c’est la femme » mais
n’a pas accroché et l’a abandonné sans le terminer. Elle a
préféré « La mort est une habitude », mais avec des réserves, et
des questions.
Elle a
apprécié le style en courant de conscience jouant avec les
pronoms, mêlant passé et présent, avec des contrastes à chaque
instant entre le présent de l’écrivain et les souvenirs du camp,
le tout lié à ses relations avec les femmes. Mais elle s’est
demandé comment comprendre ces relations, essentiellement
sexuelles : comme une libération ? ou comme une fuite pour se
préserver du passé ? Car il doit toujours lutter contre
l’omniprésence de la mort, et du désir de mort, comme hérité de
ce passé.
Elle s’est
aussi demandé à quoi tenait ses sentiments envers son pays en
opposition aux pays étrangers où il lui arrive de voyager ou
séjourner : nostalgie du pays natal ? ou une sorte de
ressentiment envers les étrangers (vous n’avez pas vécu ce que
nous, nous avons vécu) ? En même temps elle a apprécié le ton
ironique de certains passages, par exemple quand il compare les
livres très sérieux d’un ami sinologue aux illustrations de
Playboy.
| |

La mort est une
habitude, même éditeur, avril 2009 |
|
Dans
l’ensemble, elle a trouvé l’auteur comme égaré, perdu dans sa
vie. Mais elle a été agacée par son regard masculin/misogyne, un
regard très traditionnel, un peu déplacé aujourd’hui, sur la
société et les relations hommes/femmes : les femmes sont là pour
le plaisir, sans plus. Elle n’a donc pas gardé un souvenir
agréable de cette lecture.
o
MRC
a, lui, un regard bien masculin sur Zhang Xianliang et s’en
excuse presque dès l’abord. Il reconnaît aussi avoir bloqué sur
« La mort est une habitude » car il n’aime pas l’écriture en
flux de conscience. En revanche il a trouvé beaucoup d’intérêt
dans « La moitié de l’homme c’est la femme », ainsi que dans
l’auteur.
En fait, il
avait entendu parler de Zhang Xianliang en 2009, alors qu’il
était encore en Chine. Une amie lui avait parlé de lui comme
d’un héros qui avait passé 22 ans de sa vie en camp de laogai,
et qui était resté vierge jusqu’à la quarantaine. En fait, à sa
mort, en 2014, le portail sina lui a rendu hommage en le
présentant comme le premier écrivain chinois (du Continent) à
avoir, dans les années 1990, brisé le tabou des sujets sexuels.
Il parlait ouvertement de ses liaisons, et de sa vingtaine de
liaisons.
Pour en
revenir à son roman, MRC y voit un mélange de réalisme et
de surréalisme, réalisme par exemple dans les descriptions de
paysages, surréalisme lorsque, frappé d’impuissance, il parle à
son cheval, ou lorsque, constatant que sa femme l’a trompé, il
dialogue avec les fantômes de grands personnages et écrivains du
passé, dont Karl Marx.
Il a beaucoup
aimé la façon dont est agencé le récit, chaque relation
amoureuse étant mise en rapport avec la situation politique, en
alternance et en constante évolution, le destin des personnages
étant ainsi lié à celui du pays. Finalement, il a apprécié le
roman par une sorte d’empathie avec l’auteur.
| |
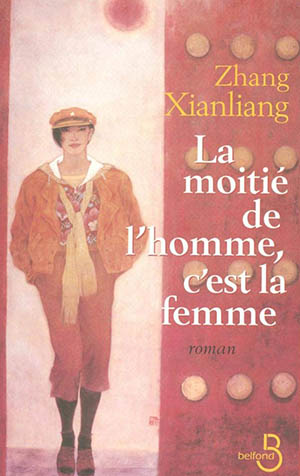
La moitié de l’homme
c’est la femme,
traduction française,
Belfond, rééd. 2004 |
|
Mais il lui
reste un questionnement sur lui : il a vu que, dans les années
1990, réintégré au Parti, il était devenu un homme d’affaires et
s’était enrichi. Aurait-il finalement vaincu les spectres du
passé ? Et aujourd’hui, il semblerait, selon douban,
qu’il soit en passe d’être censuré…
[ce qui
n’aurait rien d’étonnant]
o
Sylvie D.,
pour sa part, a lu les deux romans, en commençant par « La mort
est une habitude » qui l’a désorientée. Elle en retient un
sentiment de malaise : personnages mal définis et caractères
torturés, comme celui de cette femme qui veut absolument
retrouver les os de son ancien amant, quitte à se retrouver avec
un sac d’os anonymes. Elle s’est demandé s’il est juste
d’appeler ce récit « roman ».
Elle a préféré
« La moitié de l’homme c’est la femme » car elle a retrouvé là
les caractéristiques d’un « vrai » roman, dans sa construction,
l’évolution de l’action. En revanche, elle n’a pas aimé les
discussions surréalistes avec les fantômes ; les dialogues avec
le cheval lui sont semblé plus compréhensibles.
o
Dorothée MS
a lu « La
moitié de l’homme c’est la femme » avec grand intérêt, et a
regretté, l’ayant emprunté cet été en bibliothèque, de ne
pouvoir en relire au moins des passages pour se rafraîchir la
mémoire avant la séance.
Il lui reste
donc les souvenirs de ce qu’elle a bien aimé : les descriptions
de la nature, de l’immensité du pays, le détachement vis-à-vis
de son sort. Elle en a gardé des souvenirs visuels, comme de
l’imaginer mangeant accroupi dans sa masure, et le souvenir ému
de l’hommage rendu à la femme qui a réussi à lui créer un foyer.
Elle a trouvé amusant de le voir dialoguer aussi bien avec Marx
qu’avec les héros du « Bord de l’eau ».
o
Martine B.
a lu « Mimosa » et a beaucoup aimé cette nouvelle qui se passe
dans un autre contexte que le camp à proprement parler : le
personnage principal, Zhang Yonglin, est « libéré » du camp où
il a été envoyé après sa condamnation comme droitier et affecté
à une ferme à côté, toujours dans le Gansu – travail toujours
obligatoire et contrôlé certes, mais relativement plus libre.
Martine
a
bien aimé ce portrait de femme qui le recueille et le ramène à
la vie, littéralement, dans ce contexte
,
en lui donnant à manger tout en refusant qu’il fasse quoi que ce
soit dans la maison : le rôle qu’elle lui assigne et qui lui
semble le plus important est de lire. Ironie du sort : le seul
livre qu’il possède est de Marx, et il lui sert d’oreiller. Il
lit donc Marx tous les soirs et il finit non seulement par y
trouver de l’intérêt, mais par comprendre ce texte qui lui avait
semblé des plus obscurs jusque-là. Il en ressort une nouvelle
vénération du Parti, et le sentiment d’être un mauvais élément,
puni à juste titre.
| |
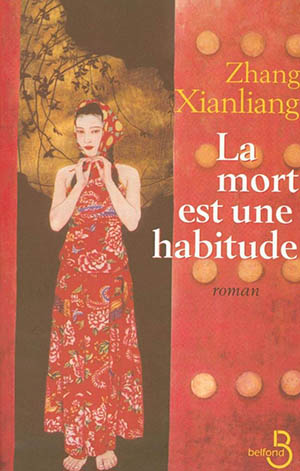
La mort est une
habitude, traduction française,
même éditeur, rééd. mai
2004 |
|
Le récit est
baigné d’un sentiment presque élégiaque de la grandeur du
paysage et de l’atmosphère de l’époque avec les longs voyages à
pied, dans ce paysage, justement. Ce qui n’empêche pas les
pointes d’humour de temps à autre (l’égalitarisme a ses défauts…
pas de kang avant le printemps, saison où justement on n’en a
plus besoin… ). Atmosphère d’époque aussi, mais pas seulement,
dans la timidité des gestes de tendresse à peine ébauchés.
Mimosa reste
un personnage très attachant, figure maternelle, avec Zhang
Yonglin comme avec sa petite fille, avec un côté ambigu dans ses
relations avec les hommes qui viennent lui apporter de la
nourriture sans qu’elle semble leur donner rien en échange.
Figure du souvenir, sans lendemain : renvoyé en camp pour avoir
aidé un détenu à s’enfuir, quand Zhang Yonglin revient à la
ferme quelques années plus tard, Yinghua n’y est plus : elle est
repartie chez elle.
o
Françoise J.
a lu « La mort est une habitude » et a d’abord été désarçonnée
par l’utilisation récurrente des différents pronoms personnels,
mais s’y est habituée, de même qu’aux allers-retours entre les
différentes périodes dans le temps et les différents lieux dans
l’espace (Chine, France, États-Unis… ).
Plutôt qu’un
roman, elle y a vu un témoignage sur la vie dans les camps, et
sur son histoire familiale. L’histoire des os des morts lui a
rappelé « Les âmes mortes » de
Wang Bing (王兵),
mais aussi « Nostalgie
de la lumière »,
le documentaire du réalisateur chilien Patricio Guzmán filmé
dans le désert d’Atacama où se trouvait le camp de
Chacabuco
du temps de la dictature de Pinochet et où, de même, sont
enfouis dans le sable les os des prisonniers morts dans le camp.
Elle l’a lu
aussi comme un essai sur la Chine, Continent et diaspora, avec
une interrogation sur le patriotisme. Mais elle a décroché sur
tout ce qui est dans le livre digression sur les femmes : elle a
trouvé affligeantes les descriptions physiques des femmes,
toujours caricaturales et clichés, l’une des assertions notées
étant que l’homme « est toujours agressé par deux choses : la
politique et les femmes ». Elle s’est demandé si on ne peut pas
voir dans le livre une « analyse par effraction ».
- Geneviève
B.
a elle aussi trouvé peu intéressant tout ce qui touche aux
femmes dans ce roman, mais en se disant que c’est simplement un
prétexte pour remonter vers le passé. C’est en fait chaque fois
que le narrateur se retrouve avec une femme qu’il est frappé
d’une vision fulgurante du passé, qui lui revient alors par
bribes.
Il a été
envoyé en camp parce que droitier, pour son origine de classe,
mais il ne l’explique pas comme Harry Wu, et en ce sens, la
lecture préalable de « Vents amers » lors de la
séance
précédente
l’a aidée à mieux comprendre le roman de Zhang Xianliang.
Les relations
sexuelles apparaissent simplement comme un moyen de se donner le
sentiment d’exister, alors que, sauvé in extremis de la mort, il
a été traumatisé par cette expérience et porte toujours en lui
l’impression d’être un mort-vivant. Il est hanté par le souvenir
du camp d’exécution. Il parle avec admiration de sa mère qui a
continué à vivre dans la pauvreté ; mais la maîtresse de son
père tente elle aussi de se raccrocher au passé pour vivre et
d’en retrouver des traces en tentant de retrouver les os du
disparu.
Elle a été
frappée de voir Zhang Xianliang parler de l’omniprésence de la
peur, comme Harry Wu. Ce qui lui a fait penser au
journaliste français Zhang Zhulin qui dit la même chose dans son
livre « La société de surveillance made in China » paru
en mai dernier aux éditions de l’Aube.
Cette peur
latente, dit Lingling, est due en grand partie au fait
qu’on n’a pas de recul, qu’on ne peut pas prendre la distance
nécessaire pour pouvoir juger du moment.
o
Gisèle H.
a lu « La moitié de l’homme c’est la femme » en appréciant les
descriptions de la nature, mais aussi des discussions avec les
fantômes de Marx et des anciens. Le dialogue avec le cheval lui
a rappelé « Les
fours anciens » (《古炉》)
de Jia Pingwa
.
Elle a trouvé
le roman vraiment trop misogyne : les femmes sont sottes et
incultes. Quant au narrateur, il a son destin à réaliser, donc
ne peut rester avec cette femme illettrée : « la différence
culturelle était trop grande ». En revanche, elle a bien aimé
les descriptions des personnages secondaires.
o
Souffrante, Guochuan n’était pas là, mais a envoyé son
avis rédigé, sur « La moitié de l’homme c’est la femme ».
Ce roman est
caractérisé par son humour noir. Le protagoniste, Zhang Yonglin,
se trouve pris au piège de son exil et de sa longue vie en
rééducation, sans issue. Sa seule option est d'affronter cette
absurdité en riant, comme il le répète maintes fois pour se
donner du courage
.
C’est aussi un
roman controversé, et ce pour deux raisons :
- D'une part,
en raison de sa description de la sexualité (性描写).
Après la publication de son poème « Chanson des grands vents »
(大风歌),
Zhang Xianliang a été étiqueté comme « droitier » et condamné à
la rééducation. La longue période de 22 ans qu’il a passée en
camp l'a privé de toute expérience amoureuse jusqu'à l'âge de
ses quarante ans, ce qui se manifeste dans sa représentation de
la sexualité et de sa profonde frustration sexuelle.
- D'autre
part, le personnage de Zhang Yonglin (章永璘)
est souvent critiqué d’un point de vue moral. Il a besoin de
Huang Xiangjiu (黄香久)
pour satisfaire ses besoins charnels (ou du moins ne le refuse
pas), mais sa manière de la traiter comme une personne de rang
inférieur révèle son égocentrisme et son hypocrisie. Il utilise
son "autorité verbale", qui est une caractéristique propre aux
intellectuels, pour la contrôler et la dominer. Le mariage, le
divorce, la rédaction de lettres, tout est orchestré par Zhang
Yonglin. D'ailleurs, même à la fin du livre, on a du mal à
comprendre sa décision de quitter Huang Xiangjiu. Il s'exclame :
« 啊!世界上最可爱的是女人!但是还有比女人更重要的!女人永远得不到她所创造的男人!»
Ah, dans le monde, le plus cher, c’est la femme ! Mais il y a
plus important ! Jamais une femme ne pourra obtenir l’homme
qu’elle aura créé. »
Cependant, il
est essentiel de considérer le personnage de Zhang Yonglin dans
le contexte de la société dans laquelle il évolue. En ce sens,
il incarne simplement un personnage typique dans un
environnement typique, sa vie reflétant des traits universels
qui témoignent de cette période de l'histoire des intellectuels
chinois. En ce qui concerne l'amour, le parcours de Zhang
Yonglin révèle une longue répression sexuelle, initialement
exprimée et compensée par des rêves : des fantasmes sexuels
intenses suivis d'une idéalisation des femmes. Cependant, une
profonde désillusion survient lorsque son imagination est
confrontée à la réalité, le rendant impuissant face à cet écart.
Cette impuissance reflète son estime de soi, car une fois qu'il
est reconnu par les autres en contribuant à empêcher une
inondation, il retrouve sa puissance sexuelle, ce qui entraîne
des actes de vengeance sexuelle. À travers ce personnage,
l'auteur semble explorer la distorsion de l'humanité, à la fois
sur le plan psychologique et physique.
De plus, il
est possible de discerner une relation secrète entre la
politique et la sexualité. Pendant la Révolution culturelle, les
domaines de la politique et de la sexualité étaient parmi les
plus strictement contrôlés au niveau du discours. Le passage de
Zhang Yonglin de l'« impuissance sexuelle » à l'« activité
sexuelle » peut être interprété comme une métaphore cachée de la
situation des intellectuels de l'époque. Les intellectuels qui
ont survécu à la Révolution culturelle avaient besoin de changer
leur image et de récupérer une identité sociale.
____
Ces deux
romans sont des spécimens rares de fiction dans le domaine de la
littérature du laogai. La littérature russe et d’Europe
centrale est à cet égard bien plus riche
.
Yan Lianke se distingue nettement dans ce contexte.
Prochaine
séance :
Le mercredi
22 novembre 2023
Troisième
volet de notre trilogie sur les camps de laogai, cette
séance est plus spécifiquement en lien avec la Grande Famine, et
la responsabilité des intellectuels, thème récurrent chez Yan
Lianke :
- Les
quatre livres (《四书》),
de
Yan Lianke (阎连科),
trad. Sylvie Gentil, Philippe Picquier 2012, Picquier poche
2015.
Et en
parallèle : « Le mythe de Sisyphe » de Camus, Gallimard,
coll. « Les
Essais », 1942,
coll. « Folio Essais » 1985.
«不给自己找点乐子,怎么熬过这漫长的刑期?»
(第一部 第三章)
[si on
ne rit pas un peu, comment réussir à passer une aussi
longue peine ?]
«是得找点什么事来乐一下,不然这日子怎么过?»
(第一部 第四章)
[il
faut bien que je trouve de quoi rire un peu, autrement
comment passer le temps ici ?]
|

