|
|
Zhang Xianliang : les grands
textes
III. Grass Soup / My Bodhi Tree
par
Brigitte Duzan, 3 septembre 2022
Après le
triple
récit fictionnel, mais largement autobiographique, que
sont « Mimosa » (《绿化树》)
et « La moitié de l’homme, c’est la femme » (《男人的一半是女人》)
d’une part et « La
mort est une habitude » (《习惯死亡》)
d’autre part,
Zhang Xianliang (张贤亮)
a poursuivi son retour sur le passé dans un style plus
documentaire avec « Grass Soup » (《烦恼就是智慧》)
puis
« My Bodhi Tree » (《我的菩提树》).
Dans ces deux ouvrages, publiés l’un en 1992,
l’autre deux ans plus tard, en 1994, l’auteur décrit avec force
détails sa vie en camp de rééducation à partir des notes
soigneusement elliptiques du journal qu’il a tenu pendant une
année spécifique de sa longue période détention, l’année 1960.
C’était la pire année de la Grande Famine provoquée par le Grand
Bond en avant ; le journal apparaît
dans ce contexte comme un véritable manuel de survie pour
résister non seulement à la faim, mais surtout à la volonté du
pouvoir de briser toute résistance, en brisant les esprits. Les
deux ouvrages sont ainsi un courageux travail de mémoire et de
témoignage autant que de réflexion.
Le premier, « Grass
Soup » (《烦恼就是智慧》),
est initialement paru
dans le numéro de mai 1992 de la revue « Le monde de la
fiction » (《小说界》1992年第5期). C’est un texte fondamental.
| |
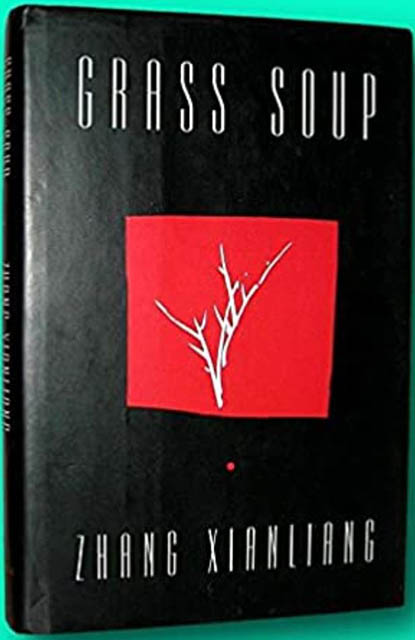
Grass Soup, 1ère édition, 1995 |
|
Le titre anglais
est celui de la traductrice américaine, Martha Avery ; loin de
la « soupe aux herbes sauvages » d’Émilie Carles, cette soupe
aux herbes-là est un condensé symbolique du maigre ordinaire des
camps, à un moment où la Chine entière subissait le tourment de
la faim, d’autant plus obsédant pour les détenus. Quant au titre
chinois, il signifie littéralement « les soucis, c’est la
sagesse » ; c’est un précepte bouddhiste selon lequel la sagesse
procède des difficultés et des peines auxquelles on est soumis,
mais qu’il faut prendre ici avec un certain humour. Le texte
entier est caractérisé par un humour dévastateur qui va bien
au-delà de celui qui émaille ses romans précédents.
Écrire pour survivre,
survivre pour témoigner
Le journal commence par une
ligne laconique le 11 juillet (1960) : « Construction de
capital : traîné des mottes de terre. » Comprenne qui pourra. Il
explique : cela faisait plus de 700 jours qu’il était en camp de
travail, depuis le 18 mai 1958 ; il s’y était habitué, il ne
ressentait plus de douleur ni de peine, seulement la faim. Si
son journal n’était pas là pour en témoigner, trente ans plus
tard, il aurait du mal, dit-il, à croire à la réalité de cette
souffrance. Il écrit donc pour que ce ne soit pas oublié, pour
lutter contre l’amnésie ambiante, en faisant un retour sur le
passé pour décrypter ses notes subtilement lacunaires, écrites
de manière à ne pas s’attirer d’ennuis au cas où le journal
serait découvert et confisqué. Ce qui est arrivé, en 1970, mais
sans lui attirer plus d’ennuis que deux questions, à deux
endroits pourtant anodins, et qu’il a notés.
Pourquoi a-t-il commencé son
journal ce 11 juillet ? Il ne s’est rien passé de spécial ce
jour-là à la ferme. S’il a ouvert son petit carnet et s’est mis
à écrire, c’est peut-être tout simplement parce qu’il avait un
stylo, dit-il. Et s’il lui restait un stylo, c’est parce que
c’était un objet qui n’avait aucune valeur d’échange dans le
contexte du camp, tout le reste avait été échangé, contre de la
nourriture. En même temps, ce que le stylo lui offrait, c’était
un mode de survie. Au moment de sa réhabilitation, selon la
réglementation d’alors, les documents incriminants de son
dossier ont été détruits ; seul, à sa demande expresse, lui est
resté ce journal pour le rattacher au passé, et ainsi pouvoir en
témoigner, au prix d’un effort de mémoire considérable pour
reconstituer les faits derrière le laconisme des entrées.
| |
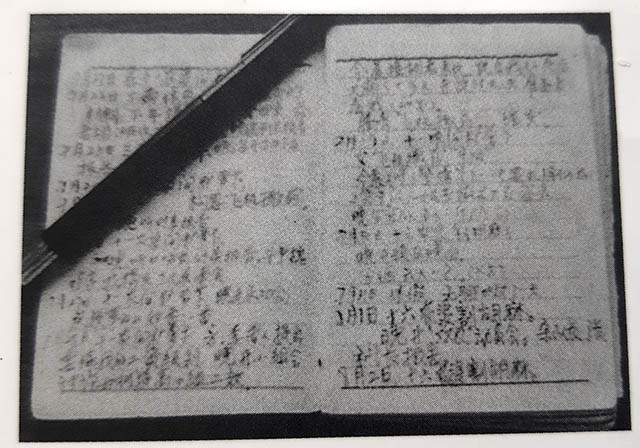
Au
dos de la couverture : le manuscrit du journal |
|
En fait, ce laconisme fait pour
camoufler la réalité était du même ordre que celui des autorités
invoquant des « désastres naturels » pour déguiser la
catastrophe induite par l’inanité de leur politique négligeant
l’agriculture pour faire un « grand bond en avant ». En ce mois
de juillet où le temps était superbe et aurait dû annoncer une
moisson abondante, les récoltes étaient en fait en chute libre,
et les autorités venaient d’annoncer une politique de baisse des
rations, désormais uniquement à base de légumes et d’herbes,
sans que personne ne songe à se demander comment il pouvait en
être ainsi.
Pour cette première journée de
son journal, Zhang Xianliang poursuit en expliquant ce
qu’étaient les briques de terre qu’il avait à transporter, et en
quoi consistait le travail dans les rizières au même moment. Ce
travail se faisait les jambes dans l’eau toute la journée ;
elles étaient vite couvertes de cloques qui provoquaient des
démangeaisons insupportables. Le seul moyen de s’en guérir était
de sortir de l’eau. C’est justement ce qui lui était arrivé ce
11 juillet : il avait été affecté à la construction d’une
maison, d’où l’allusion des briques de terre à porter sur le
dos. C’est la joie d’avoir échappé à la rizière et de pouvoir
rester en terrain sec qui l’avait incité à prendre la plume ce
jour-là.
Cette première journée
représente donc une introduction non tant au journal qu’à son
mode d’écriture et de décryptage, décryptage qui passe par des
explications détaillées de la vie dans le camp. Ces explications
sont données dans un style utilisant des expressions nées de la
pratique quotidienne dans le camp et formant comme un glossaire
plein d’humour, même les termes usuels recouvrant dans le
contexte une réalité toute autre : contexte de famine, de misère
et de lutte constante pour la survie.
L’humour pour dire
l’absurdité
Petit à petit, au fur et à
mesure que passe l’été, la nourriture se fait de plus en plus
rare, la fatigue augmente, la santé se délabre, tousser devient
un effort quasiment insurmontable, la mort plane. Les détenus
mangent ce qu’ils trouvent, y compris les crapauds et les
champignons vénéneux, ce qui donne l’occasion d’expériences
nouvelles où se distinguent les intellectuels. On se souvient
longtemps des pages sur la toux : toux collective déchirante, en
plein canicule d’août, parce que les poumons n’en peuvent plus
et ne supportent plus d’avoir à inspirer et expirer cet air
chaud.
Ce qui frappe, cependant, et
fait de « Grass Soup » un document littéraire unique dans ce
genre de littérature mémorielle sur un passé aussi douloureux,
c’est l’humour avec lequel il est écrit. Cet humour est bien
plus terrible que les récits tragiques de la « littérature
des cicatrices » (伤痕文学)
qui, manquant de recul, restent au niveau de la narration
linéaire classique, au premier degré. Bien plus terrible aussi
que les lourds réquisitoires contre les injustices et les
souffrances subies.
Chaque page de « Grass Soup » a
un côté emblématique qui dépasse l’expérience individuelle pour
dénoncer le système inhumain et aberrant qui a permis de telles
dérives. Un système tellement aberrant que les esprits en
étaient affectés et que seul l’humour peut en rendre compte, a
posteriori.
Mémorables sont les pages sur
le troc, par exemple, où il est expliqué comment les détenus
pratiquaient le troc pour se procurer de misérables suppléments
de nourritures, une valise italienne s’échangeant contre cinq
bols de nouilles et une cravate contre un radis – la cravate
servant bien sûr de ceinture. On n’est pas étonné que le texte
chinois soit quasiment introuvable quand on lit, par exemple,
les pages hilarantes sur la « poésie socialiste », dont il nous
donne un mode d’emploi.
L’astuce était « d’emprunter un
corps pour y mettre son âme », c’est-à-dire rediriger ses
sources d’inspiration (nature, amour, vie et autre) vers l’éloge
d’un leader ou à la limite de travailleurs modèles ; c’est ce
qui permet d’insuffler une nature politique à son poème. Sur le
modèle des poèmes du grand poète prolétaire Maïakovski, continue
ironiquement Zhang Xianliang, le poème socialiste est ainsi une
eulogie d’un grand leader permettant d’exprimer ses émotions, et
non destiné à faire l’éloge du leader. C’est ainsi, dit-il en
marge du 16 juillet qui fait état de plusieurs poèmes envoyés au
journal du Ningxia, qu’il a écrit un hommage à la Commune
populaire, disant que toute la Chine devrait devenir une immense
Commune populaire, et que ceci serait conforme à l’idéal de
grande harmonie prôné par Confucius… Étonnant, dit-il encore
avant de passer au 17 juillet, qu’il ait pensé à écrire de la
poésie alors que les gens mouraient comme des mouches autour de
lui et dommage qu’il ait souffert autant de la famine, il aurait
pu écrire tellement d’eulogies socialistes s’il avait eu le
ventre plein….
On pense aux pages de
Lu Xun (魯迅)
sur le sujet, dans son recueil d’essais publié en 1926 « Sous le
dais fleuri » (《华盖集》)
où il fait d’ailleurs preuve du même humour. Au début de l’essai
intitulé « Après avoir "heurté le mur" » (《“碰壁”之后》),
il dit en particulier :
我平日常常对我的年青的同学们说:古人所谓“穷愁著书”的话,是不大可靠的。穷到透顶,愁得要死的人,那里还有这许多闲情逸致来著书?我们从来没有见过候补的饿殍在沟壑边吟哦;
…
Je dis souvent à mes jeunes élèves qu’il ne faut pas accorder
trop de crédit à ce que disaient les anciens : que « misère et
soucis font les grands romans »
.
Ceux qui sont dans la misère noire, qui sont accablés de soucis
à en vouloir mourir, comment auraient-ils le loisir et l’envie
d’écrire ? On n’a jamais vu des gens épuisés par la faim
psalmodier des poèmes sur le bord d’un fossé…
Mais l’humour a ses limites. Et
ce qui reste en fin de compte, qui émerge quand tout semble être
dit, c’est un souvenir lancinant, obsédant, une image qui
symbolise toute l’atrocité de la période.
L’atroce réalité de la
faim
Cette image, c’est celle d’une
femme venue d’un village lointain du Gansu, avec sa petite
fille, voir son mari pour lui apporter dans un misérable petit
sac ce qu’elle a pu économiser de nourriture pendant dieu sait
combien de temps. Et lui, comme une bête, de se précipiter sur
elle pour lui ravir son offrande et l’emporter pour l’engloutir
seul, sans même songer à le partager. Puis, repus, se suicidant,
de manière incompréhensible.
Après réflexion, nous dit Zhang
Xianliang, ce qui s’est sans doute passé, c’est qu’il a
brusquement été atterré de réaliser à quel point d’inhumanité la
faim dans le camp l’avait réduit. Voilà ce qui est arrivé le 4
septembre, dont on ne trouve pas mention dans le journal. Le
souvenir semble s’être inscrit dans l’esprit de Zhang Xianliang
comme au fer rouge.
La réforme par le travail ne
fait pas perdre à un homme tout sentiment humain, dit-il, la
faim, si. La faim avait annihilé les sentiments humains.
L’ultime pensée, en refermant le journal, est pour la petite
fille… « Grass Soup » atteint dans ces dernières pages une
intensité émotionnelle parfaitement maîtrisée qui laisse secoué,
et admiratif.
-
Grass Soup (《烦恼就是智慧》),
David R. Godine publisher, 1995.
- My Bodhi Tree
(《我的菩提树》),
Secker and Warburg, 1996.
Cette femme du
Gansu en rappelle une autre, venue elle aussi rendre
visite à son mari, dans un autre camp à la même époque,
celui de Jiabiangou. C’est « la femme de Shanghai » (《上海女人》)
du recueil de nouvelles de
Yang Xianhui (杨显惠)
paru en 2003, « Adieu à Jiabiangou » (《告别加边沟》),
écrites à partir de témoignages d’anciens déportés
survivants. Dans son cas, l’horreur est différente mais
horreur il y a aussi.
|
|

