|
|
Wencheng
(La ville introuvable) : un conte plein de bruit et de fureur de
Yu Hua
Écrit par
Brigitte Duzan et Zhang Guochuan, 12 octobre 2023
C’est en mars
2021, huit ans après « Le
Septième jour » (《第七天》),
qu’est sorti en Chine le sixième roman de
Yu Hua (余华)
intitulé « Wencheng » (《文城》).
Le roman a aussitôt agité la sphère littéraire et médiatique ;
il a été couronné en
octobre 2022 du prix
Shi Nai’an (施耐庵文学奖),
puis, en mai 2023, du prix littéraire décerné par la revue
Shouhuo (《收获》)
qui fêtait en même temps son 65e anniversaire : un
nouveau Yu Hua est toujours un événement.
| |
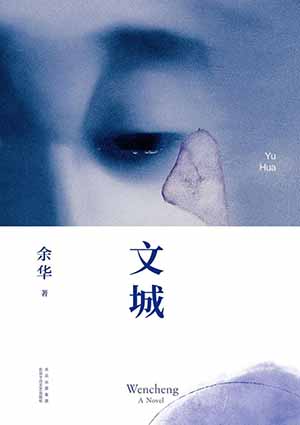
Wencheng, édition de Chine continentale, mars 2021 |
|
Un journaliste
a titré
:
« Huit ans plus tard, Yu Hua est de retour avec un tout nouveau
roman » (时隔八年,余华全新长篇重磅归来!).
En précisant : est sérieusement de retour (重磅).
·
Trente ans après « Vivre ! »
En fait, ce
n’est pas tant huit ans après « Le Septième jour » (《第七天》)
qui importe – ce n’est qu’une donnée chronologique. Le véritable
rapprochement est à faire avec « Vivre ! » (《活着》),
publié en 1993.
En effet, comme Yu Hua l’a expliqué, il a commencé à écrire
« Wencheng » juste après « Vivre ! », comme une préquelle, en
quelque sorte, pour dresser une chronique du même ordre un
demi-siècle auparavant ; mais il a laissé le roman inachevé
pendant longtemps, et ce n’est qu’en 2020, pendant le
confinement, qu’il a repris son texte et l’a terminé.
o
Vivre dans la Chine post-impériale
Bien que le
récit ne le précise que fugitivement, on devine vite qu’il se
situe au début du 20e siècle, dans le contexte
chaotique de la période charnière entre la chute de la dernière
dynastie impériale et les débuts de la République. C’est un
moment typique des transitions dynastiques : aucun pouvoir fort
n’ayant émergé après la chute de l’empire, la Chine est partagée
entre « seigneurs de la guerre » et sombre dans le chaos créé
par les bandes de brigands (土匪)
qui mettent la plupart des régions à feu et à sang, et sont
d’ailleurs souvent liés au précédents
.
o
L’histoire de deux personnages
C’est un récit
en deux parties, autour de deux personnages principaux. Lin
Xiangfu (林祥福)
et Ji Xiaomei (纪小美).
Le premier vit dans un village du nord, il est charpentier,
humble et taciturne, et n’est toujours pas marié malgré les
efforts de son père pour lui trouver une épouse. Mais voilà
qu’un jour débarquent à sa porte deux jeunes venus du sud ; se
disant frère et sœur, ils demandent l’hospitalité pour la nuit.
Le lendemain, cependant, le frère repart seul en laissant sa
sœur aux soins de Lin Xiangfu, en promettant de revenir la
chercher dès qu’il le pourrait. Promesse creuse, on s’en doute :
les jours passent, Ji Xiaomei se révèle être une épouse idéale
pour Lin Xiangfu qui en est tombé amoureux. Et puis un jour elle
disparaît, en emportant une partie des lingots d’or économisés
par Lin Xiangfu…
| |
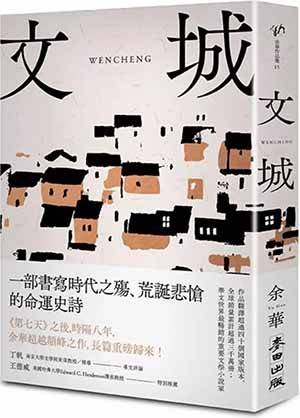
Wencheng, édition
taïwanaise, avril 2021 |
|
Les jours
passent, Lin Xiangfu a repris sa vie calme lorsque soudain Ji
Xiaomei réapparaît : elle est enceinte et revient donner
naissance au bébé, l’offrir à son père en quelque sorte. Et la
vie reprend, à trois cette fois, au rythme de la croissance de
la petite fille. Une vie heureuse et paisible, comme dans un
conte. Mais le conte déraille à nouveau : une nuit, Xiaomei
s’enfuit derechef, cette fois sans rien emporter, pas même sa
fille.
Alors Lin
Xiangfu décide de partir à sa recherche, avec le bébé. Le
problème est qu’il ne sait rien de Xiaomei. Il n’a que deux
pistes, très vagues, pour tenter de la localiser : d’une part,
le « frère » lui a dit qu’ils venaient du sud, d’une ville
nommée Wencheng, et d’autre part ils parlaient entre eux une
langue différente de la langue du nord, très rapide. Lin Xiangfu
part ainsi vers le sud à la recherche de la ville de Wencheng,
en portant le bébé emmailloté sur la poitrine.
On pourrait
résumer le roman en disant qu’il s’agit de l’histoire d’un homme
parti à la recherche de sa femme qui a disparu.
o
Un
conte douloureux
La quête de
Xiaomei, cependant, est une quête du Graal : Lin Xiangfu finit
par se rendre compte – mais le lecteur l’avait deviné bien plus
tôt – que Wencheng est un mythe, une invention pour brouiller
les pistes, pour que, justement, Lin Xiangfu ne puisse pas
retrouver les deux fuyards. Il finit cependant par s’installer
dans une ville, Xizhen (溪镇),
qui lui semble correspondre à ce qu’il imagine être Wencheng ;
en tout cas, on y parle la même langue que celle parlée par
Xiaomei. Le bébé lui sert de passeport dans la ville,
l’introduit auprès d’une famille de charpentiers comme lui.
Il s’installe
avec eux et reproduit dans le sud la vie qu’il menait dans le
nord, mais dans un cadre familial chaleureux et un réseau social
où il s’intègre parfaitement. La vie continue, la petite fille
grandit tandis qu’il poursuit sa quête inaboutie.
Conte certes,
mais où le rêve de vie paisible est battu en brèche par la
réalité du terrain, dans un contexte de chaos croissant, de plus
en plus dangereux, la région de Xizhen étant livrée aux
exactions de bandits qui y sèment la terreur, surtout d’ailleurs
quand ils tombent sur des troupes de l’armée nationaliste qui ne
font qu’ajouter au chaos.
o
Un
roman en deux parties
On reste
malgré tout dans le domaine du conte, car les atrocités décrites
sont d’une telle cruauté qu’elles finissent par prendre un
aspect tout aussi irréel que le reste malgré la précision des
détails, comme dans un cauchemar dont on ne parvient pas à
s’éveiller.
Le roman est
en deux parties, la première partie étant centrée autour de Lin
Xiangfu, et laissant des zones d’ombre autour du personnage de
Xiaomei. La deuxième partie, beaucoup plus courte, vient, comme
un repentir, combler les lacunes de la narration principale et
enlever tout le flou qui entourait Xiaomei, en revenant en
flashback sur sa vie et les motivations de ses actes.
o
Un
chuanqi signé Yu Hua
Yu Hua a
expliqué à la sortie du roman qu’il l’avait en fait commencé
après « Vivre ! », mais qu’il n’était pas parvenu à le
terminer ; il l’avait laissé inachevé au bout de 200 000
caractères, en 1998. « Wencheng » est donc à replacer dans ce
contexte. L’idée initiale était de revenir à la forme du
chuanqi
(传奇),
ces contes dans le genre fantastique – ou de l’étrange – de la
tradition chinoise que Yu Hua avait déjà illustré dans ses
zhongpian
de
la fin des années 1980
– la période dite « d’avant-garde ».
On retrouve dans « Wencheng » la trame d’une histoire d’amour
analogue à celle de
Liang Shanbo et Zhu Yingtai (《梁山伯与祝英台》) ;
l’analogie est même soulignée à la fin du roman, quand les
fidèles serviteurs de Lin Xiangfu, ramenant son cadavre chez
lui, dans le nord, et prenant un chemin détourné pour éviter une
zone de combat, débouchent sur des tombes, dont celles de
Xiaomei – rencontre post-mortem des deux amants comme celle des
amants-papillons de la tradition.
| |
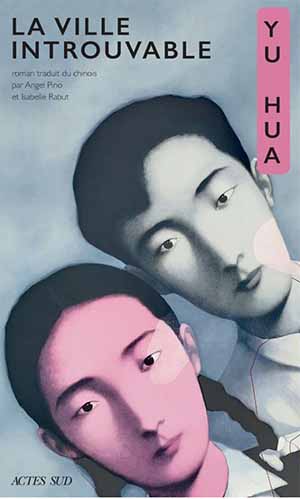
La Ville introuvable,
traduction française, 2023 |
|
« Wencheng »
est aussi un récit empruntant au genre du
wuxia
,
avec ses brigands évoquant ceux du grand classique « Au bord de
l’eau » (Shuihuzhuan《水浒传》).
Cependant, les descriptions des atrocités commises par ces
bandes de hors-la-loi rappellent l’horreur cauchemardesque des
zhongpian de la fin de la décennie. C’est une sorte de
carnaval macabre décrit dans un raffinement de détails. Cette
minutie dans le détail, dans « Wencheng », suggère que ces
scènes de tortures ont été écrites dans les années 1990, alors
que Yu Hua était encore sous l’emprise de ses cauchemars
récurrents, comme il l’a expliqué pour éclairer la genèse de ses
zhongpian. Cependant, dans ceux-ci, la cruauté est nimbée
d’une aura de mystère et sublimée en quelque sorte par la
concision de l’écriture. Ce n’est pas le cas dans « Wencheng »
où le récit est au premier degré, et d’une crudité excessive.
On conçoit que
Yu Hua n’ait pu poursuivre son écriture ; mais, en reprenant son
texte, il aurait pu alléger ces passages qui sont en outre très
longs, dénués de la légèreté machiavélique et jouissive des
supplices dépeints par
Mo Yan
dans « Le
Supplice du santal » (《檀香刑》).
On a l’impression d’un manuscrit repris pour le terminer afin de
s’en libérer, impression que vient renforcer la dernière partie
comme rajoutée en appendice au dernier moment
,
et qui vient à l’encontre du style elliptique du chuanqi
traditionnel, et de ceux de Yu Hua en particulier. Cet apologue
final fait de « Wencheng » une histoire d’amour impossible sur
fond de rencontres ratées.
« Wencheng »
apparaît ainsi comme le reflet d’une aspiration à une vie
paisible dans un monde qui ne l’est pas, aujourd’hui comme hier.
Il apparaît aussi comme un refuge dans une histoire d’une
période passée pour un écrivain qui ne peut guère écrire autre
chose, et surtout pas une histoire du temps présent, encore
moins contée avec son humour habituel.
Mais Yu Hua
reste Yu Hua : il a présenté son roman comme une histoire
« d’amour et de destin ». Il comporte de très beaux passages,
pleins de sensibilité et d’émotion, que l’on peut choisir de
privilégier, comme l’a fait Zhang Guochuan.
·
« Wencheng » entre souffrance et tendresse
(par Zhang
Guochuan)
J'ai beaucoup
apprécié le roman de Yu Hua, à l'exception, bien sûr, de toutes
ces longues descriptions détaillées des atrocités commises par
les bandits que j'ai rapidement parcourues. C'est tellement
horrible, cette narration de la violence. […] Yu Hua va même
jusqu'à transformer cette cruauté en un jeu compétitif et semble
éprouver une certaine satisfaction à le décrire par le menu, en
privilégiant cette « écriture au degré zéro », une écriture
neutre, voire inhumaine, le narrateur semblant refuser de
pénétrer la psychologie des personnages pour offrir ainsi aux
lecteurs une observation extérieure et détachée.
À côté de la
violence des bandits, il y a également la cruauté de l'époque et
de la nature. Dans le passage de la mort de Xiaomei, le
narrateur nous révèle la période précise de l'histoire : c'était
après la fondation de la République, pendant la tumultueuse
période des seigneurs de la guerre (民国初立,军阀混战),
une époque chaotique. La nature ne ménageait pas non plus les
pauvres gens. Dans le roman, la tempête détruit de nombreuses
maisons, et la neige recouvre les corps d'une centaine de
personnes priant le Ciel pour que la neige cesse de tomber.
Comme le dit Laozi, « Ciel et Terre n'ont pas de bonté : ils
traitent les dix mille êtres comme des chiens de paille. » (天地不仁,以万物为刍狗).
Dans cet environnement hostile, heureusement, les gens pouvaient
encore apprécier l'amour, la famille, l'esprit fraternel. Tous
ces petits bonheurs constituaient leur seule arme contre la
violence extérieure.
La souffrance
et la tendresse sont deux thèmes récurrents dans les écrits de
Yu Hua. L'auteur ne se contente pas de mettre en avant le
désespoir des personnages, il y insuffle également une touche de
tendresse, c’est cela qui est vraiment touchant. Lin Xiangfu
retrouve sa fille après une tempête dévastatrice ; il abandonne
sa famille pour émigrer, mais est accueilli avec bienveillance
par la famille de Chen Yongliang (陈永良)
; Lin Xiangfu et Gu Yimin (顾益民),
l’édile locale, se mobilisent pour former une milice et
combattre les bandits, collectant de l'argent pour sauver des
otages… Dans l'incertitude du destin et le chaos de la vie, ces
personnages incarnent l'amitié fraternelle et la bonté de la
nature humaine, apportant de la chaleur à une époque
tumultueuse.
Ainsi peut-on
dire que le contenu de ce roman suit la tradition de l'écriture
de l’auteur, sans grande surprise pour les lecteurs de Yu Hua,
mais avec toujours autant d’émotion. Cependant, par rapport aux
précédents romans, « Wencheng » présente une innovation dans sa
structure : une narration en deux parties. À la fin de la
lecture, on se demande si l'ajout d'un épilogue était réellement
nécessaire :
- d'une part,
on pourrait dire que cela nuit à la structure du roman, car le
mystère entourant le personnage de Xiaomei, construit dans la
première partie, maintient la curiosité du lecteur. L'épilogue,
où l'histoire est racontée du point de vue de Xiaomei, perturbe
le rythme narratif et restreint l'espace imaginaire du roman.
- mais,
d'autre part, on peut considérer que la partie principale du
roman et l'épilogue construisent deux systèmes narratifs
distincts : l'un centré sur Lin Xiangfu, qui commence au nord du
fleuve Jaune, et l'autre centré sur Xiaomei, qui commence au sud
du fleuve Yangtsé. L'existence de cet épilogue permet au lecteur
de reprendre un point de vue omniscient dans le texte, le point
de vue narratif n'est plus restreint. Ces deux lignes narratives
se croisent brièvement et forment une boucle, boucle qui devient
absurde lorsque le mystère est révélé : Lin Xiangfu recherche
une femme décédée, et une ville introuvable. Sa quête constitue
le fil conducteur principal du roman, mais l'épilogue rend cette
quête dénuée de sens, laissant le lecteur à la fin de sa lecture
face à un vide. Cela rejoint le titre du roman en français,
« ville introuvable »
.
Cette ville, objectif de la quête de Lin Xiangfu, symbolise une
certaine utopie d'amour et de paix, elle est une métaphore
devenue introuvable. L'absurdité atteint son paroxysme, ce qui
n'aurait pas été possible sans cette deuxième ligne narrative.
J'ai donc bien apprécié ce roman dans sa globalité.
Note sur
l’illustration de la couverture
C’est Yu Hua
qui a choisi l’illustration de la couverture du roman édité à
Pékin, par les éditions d’Octobre (北京十月文艺出版社).
Il s’agit d’un tableau du peintre Zhang Xiaogang (张晓刚)
de la série « Amnésie et mémoire » (“失忆与记忆”系)
intitulé « Amnésie et mémoire : Homme » (《失忆与记忆:男人》).
Pour la
traduction française, l’éditeur Actes Sud a retenu un autre
tableau du même peintre évoquant les deux personnages du roman :
tableau de la série « Bloodline » (《血缘-大家庭》),
Big Family n° 3 (《大家庭3号》).
| |
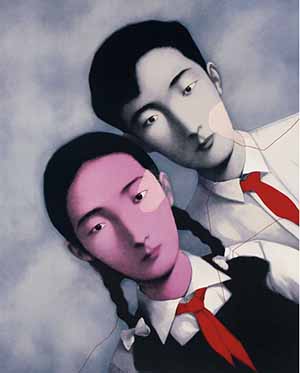
Bloodline: Big Family n°
3. |
|
Ce
roman reste le bestseller incontesté de Yu Hua, au point
que l’auteur et le roman se confondent dans l’esprit de
la plupart des lecteurs : Yu Hua est « l’auteur de
"Vivre !" », de même que
Su
Tong (苏童)
est « l’auteur d’"Épouses et concubines" », et dans les
deux cas en grande partie grâce à l’aura médiatique
apportée par les films adaptés des deux œuvres.
|
|

