|
Yu Hua
余华
II. Les nouvelles
« moyennes » de la fin des années 1980
par Brigitte
Duzan, 13 mai 2023
Neuf nouvelles
« moyennes » (zhongpian xiaoshuo
中篇小说) de
Yu Hua (余华)
publiées entre 1987 et 1990 sont caractéristiques de
l’écriture d’avant-garde
de la fin des années 1980 en Chine dont l’auteur est à ce titre
l’un des principaux représentants
.
Ce sont des récits d’une rare violence qui sont aussi des
modèles d’écriture.
o
L’Incident du 3
avril
《四月三日事件》
o
1986
《一九八六年》
o
Un monde
incertain《世事如烟》
o
Pages
pour Yang Liu《此文献给少女杨柳》
o
Un
incident fortuit《偶然事件》
o
Erreur
au bord de l’eau
《河边的错误》
o
Un
destin inévitable
《难逃劫数》
| |
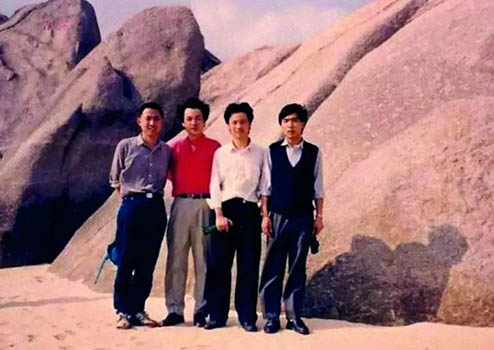
Fin des années 1980 :Yu
Hua et ses amis de l’avant-garde littéraire
De droite à gauche : Ge Fei (格非), Yu Hua, Cheng
Yongxin (程永新) et Ye Zhaoyan (叶兆言) |
|
Yu Hua a dit :
“这是从噩梦出发抵达梦魇的叙述。为此,当时有人认为我血管里流淌的不是血,而是冰碴子”。
Ce sont des récits nés de rêves cauchemardesques qui se
terminent en cauchemars. Aussi y avait-il des gens pour penser
que ce n’était pas du sang qui coulait dans mes veines, mais de
la glace.
À partir de
1991, le mode narratif évolue avec des nouvelles où la violence
est repoussée à l’état de menace latente et fait place à une
narration fondée sur l’impossibilité d’appréhender le réel
autrement que par bribes imprécises en même temps qu’apparaît
une note d’humour, toujours aussi froid :
o
Typhon estival
《夏季台风》1991
o
Mort d’un
propriétaire foncier
《一个地主的死》
1992
o
Frisson
《战栗》
1994
Une
certaine réalité
Ce récit écrit
en 1986-1987 et publié à l’automne 1987 est emblématique de
cette période d’écriture.
Histoire
inspirée d’un fait divers
Yu Hua s’est
inspiré d’une histoire vraie qui s’est passée dans le nord du
Zhejiang. Il en a fait une fable d’une indicible cruauté qui
plonge aux sources de l’inconscient collectif de l’après-maoïsme
tout en évoquant les histoires classiques de wuxia et
leurs héros éternellement en quête de vengeance.
Le récit est
construit selon un enchaînement de faits parfaitement
symétriques, la symétrie commençant avec les deux personnages
principaux : les deux frères Shangang (山岗)
et Shanfeng (山峰),
l’aîné ayant un fils de quatre ans, Pipi (皮皮),
et le cadet un bébé. La chaîne de vengeance se déploie quand la
symétrie est rompue et avec elle, en quelque sorte, l’ordre des
choses : alors qu’il portait le bébé, le trouvant trop lourd,
Pipi le laisse tomber ; le bébé meurt sur le coup. Shanfeng tue
Pipi d’un coup de pied vengeur. Sur quoi Shangang fait subir à
son frère un supplice digne des raffinements des bourreaux
impériaux ; Shanfeng meurt. Le cycle de vengeance n’est pas
achevé pour autant : Shangang est condamné à mort ; sa veuve se
faisant passer pour celle de Shangang donne son corps « à la
science » ; le récit se termine par une description détaillée du
dépeçage du cadavre par les médecins ravis de l’aubaine qui se
partagent la peau et les organes pour les greffer… avec des
succès divers.
Froideur et
violence
Ce qui a frappé
quand la novella a été publiée, et qui dérange toujours,
c’est la froideur avec laquelle l’histoire est contée, froideur
qui est caractéristique aussi des autres récits de Yu Hua écrits
ces années-là. Ce style fait de concision sans surcharge
émotionnelle culmine dans l’extrême précision de la description
finale du démembrement du cadavre. Il découle d’une volonté de
réalisme, ou plutôt d’une fausse prétention au réalisme affichée
dans le titre : « une sorte » de réalité. Ce style dénué du
moindre sentiment a pour effet de souligner et de mettre à nu la
violence aveugle qui multiplie inéluctablement les victimes.
Le critique
Chen Sihe (陈思和)
a dit des nouvelles de Yu Hua écrites en 1986-1987 qu’il faut
les lire comme des allégories. « Une certaine réalité » est de
cet ordre. Le récit traduit une réflexion anti-traditionnelle
sur le thème de la vengeance, liée au modernisme de l’écriture.
Ce thème est une constante des
histoires classiques de wuxia
et le moteur de nombreux récits qui en sont inspirés, dont la
nouvelle « Forger
les épées » (Zhujian《铸剑》)
du recueil « Contes anciens sur un mode nouveau » (《故事新編》)
de
Lu Xun (魯迅)
pour ne citer que lui.
| |
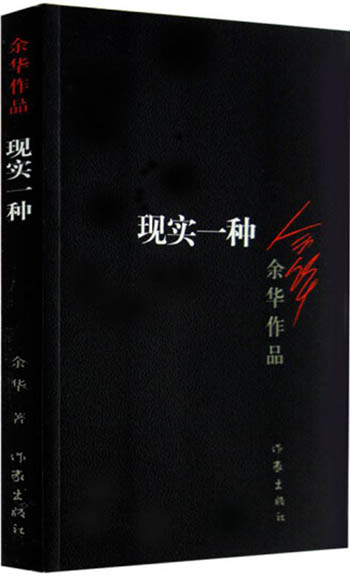
Une certaine réalité |
|
Selon certains,
d’ailleurs, Lu Xun lui-même aurait médité des idées de vengeance
au moment où il écrivait son conte, à l’automne 1926, après
la manifestation d’étudiants du 18 mars à Pékin pour protester
contre l’ingérence du Japon dans les affaires chinoises ; la
troupe avait tiré sur les étudiants, faisant 47 morts et 150
blessés. Lu Xun écrivit : « Il faut que la dette de sang soit
acquittée par un paiement de même nature… ».
Yu Hua a
d’ailleurs traité ce thème de la vengeance dans une autre de ses
nouvelles de la même période qui est un pastiche d’une histoire
de wuxia comme la nouvelle de Lu Xun. C’est la nouvelle
courte « Sanglantes fleurs de prunier » (Xianxue meihua《鲜血梅花》)
parue dans le numéro de mars 1989 de la revue Littérature du
peuple (《人民文学》).
Dans les deux cas, un jeune garçon est chargé par sa mère de
partir venger son père et il accepte sans poser de question.
Dans la nouvelle de Lu Xun, le jeune garçon se sacrifie pour
satisfaire une vengeance abstraite, tandis que, dans le récit de
Yu Hua, le jeune Ruan Haikuo (阮海阔)
erre à l’aventure car c’est son destin, mais sans remplir sa
mission car le meurtrier de son père a été tué par deux héros de
wuxia rencontrés en chemin. La nouvelle est une réflexion
sur l’absurdité de sa quête, voire de toute quête individuelle,
mais une réflexion comme apaisée après la sanglante cruauté de
l’histoire des deux frères d’ « Une certaine réalité ».
Dans« Une
certaine réalité », Yu Hua prend le contre-pied des images
positives du héros vengeur des histoires de wuxia. Son
récit est à replacer dans une réflexion générale sur les ravages
commis par la violence perpétrée pendant la Révolution
culturelle, mais en allant au-delà des faits récents pour
réfléchir sur la violence latente dans la société. C’est en ce
sens que son récit devient allégorique : il reprend le thème
classique de la vengeance et de la violence qu’elle entraîne en
s’opposant à la tradition pour resituer le thème dans la réalité
de l’âge moderne – d’où le titre. Son récit est indissociable de
la tradition, mais une tradition déconstruite pour s’en évader
:
- la vengeance
n’obéit pas à une quelconque éthique, c’est une suite
d’enchaînements dramatiques à partir de l’étourderie d’un
enfant. La manière même dont est décrit le geste, avec
l’innocence de l’enfant, lui enlève toute rationalité, voire
toute réalité.
- la suite de
l’histoire plonge dans la crise des valeurs éthiques
traditionnelles, fondées sur les cinq relations fondamentales de
la société confucéenne, dont trois sont en question dans le
récit : les relations entre frères, entre mère et fils et entre
mari et femme. Toutes ces relations sont ici faussées, la
première surtout, mais aussi celle entre mère et fils car la
mère est en train de mourir.
Yu Hua semble
impliquer que le système traditionnel de valeurs qui fondait
l’éthique de toute la société ne fonctionne plus, mais qu’aucun
autre ne l’a remplacé, laissant libre cours à la cruauté sauvage
qui mène à la ruine de la famille. Le récit pousse la violence à
des extrêmes de cruauté absurde, où elle devient presque une fin
en soi, culminant dans une chute digne d’un film d’horreur, mais
d’un réalisme tout aussi extrême.
1986
La violence
froide est inhérente à tous les récits de cette période, d’une
manière ou d’une autre et à des degrés divers. « 1986 » en est
un autre exemple : initialement publiée fin 1987 dans la revue
Shouhuo (《收获》),
juste après « L’Incident du 3 avril » (《四月三日事件》)
paru dans le numéro d’octobre
,
c’est sans doute l’une des plus célèbres novellas de Yu Hua,
l’une des plus éprouvantes aussi.
| |
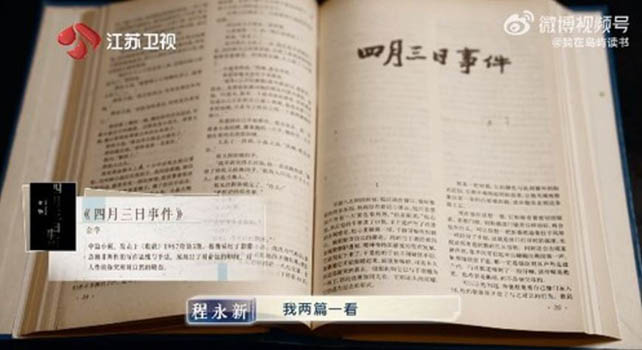
L’incident du 3 avril,
publication dans Shouhuo |
|
Elle dépeint le
retour, au lendemain de la Révolution culturelle, d’un homme qui
n’est plus que l’ombre de lui-même, dans une petite ville où
vivent son ancienne épouse et sa fille qui ont refait leur vie
en tentant d’oublier le passé. Ancien professeur d’histoire
spécialiste des supplices de l’antiquité chinoise, devenu fou,
il finit par les appliquer sur lui-même en s’automutilant
publiquement, dans la rue, selon un processus décrit avec la
même précision clinique que le dépeçage du cadavre de Shangang.
Mais le pire est que son geste n’émeut personne et que ses
restes, après cette mort horrible, sont littéralement balayés
comme des ordures. Les gens ne veulent pas que l’on vienne
troubler leur petite vie tranquille en leur rappelant les
horreurs d’un passé encore récent.
| |

Les célébrités de
Shouhuo |
|
Sang et
violence vécus et rêvés
Yu Hua avait 27
ans en 1987 et la violence de ses récits était celle de ses
cauchemars.
On le trouve
expliqué en détail dans le chapitre « Écriture » (写作)
de « La Chine en dix mots » (《十个词汇里的中国》) :
il y dit
sa frayeur, tous les matins, quand il était enfant et qu’il
allait à l’école avec son frère, de voir le nom de son père
apparaître sur les affiches en gros caractères. Son père venait
en effet d’une famille de propriétaires fonciers et même si son
grand-père avait mené une vie dispendieuse et vendu déjà toutes
ses terres au moment de la fondation de la République populaire
(comme Xu Fugui [徐福贵]
dans « Vivre ! »),
l’histoire familiale continuait à le tourmenter. Et finalement
un matin, ce qu’il redoutait était arrivé : le nom de son père
figurait sur une affiche… Et pendant ce temps, c’était le chaos
autour de lui, la violence et le sang étaient partout…
然后在一九八六年至一九八九年,我突然写下了大面积的血腥和暴力。中国的文学批评家洪治纲教授在二00五年出版的《余华评传》里,列举了我这期间创作的八部短篇小说,里面非自然死亡的人物竟然多达二十九个。
De 1986 à 1989, j’ai soudain écrit des histoires pleines de sang
et de violence. Dans son ouvrage « Commentaires sur Yu Hua »
publié en 2005, le critique littéraire Hong Zhigang, cite huit
de mes nouvelles écrites pendant cette période, dans lesquelles
29 personnages meurent de mort violente.
这都是我从二十六岁到二十九岁的三年里所干我的写作在血腥和暴力里难以自拔。白天只要写作,就会有人物在杀人,就会有人物血淋淋地死去。到了晚上我睡着以后,常常梦见自己正在被别人追杀。梦里的我孤立无援,不是东躲西藏,就是一路逃跑,往往是我快要完蛋的时候,比如一把斧子向我砍下来的时候,我从梦中惊醒了,大汗淋漓,心脏狂跳,半晌才回过神来,随后发出由衷的庆幸:“谢天谢地!原来只是一个梦。”
Pendant les trois années entre mes 26 et mes 29 ans [entre 1986
et 1989], il m’était difficile, en écrivant, de m’abstraire du
sang et de la violence. Quand j’écrivais pendant la journée, il
y avait des gens qui se tuaient, donc mes personnages aussi. Et
la nuit, quand je dormais, je me voyais pourchassé en rêve ;
j’étais seul, sans défense, je me cachais ou je fuyais, et
c’était souvent au moment où j’allais être tué, quand la hache
allait s’abattre sur moi, par exemple, que je me réveillais, en
nage, le cœur battant la chamade. Il me fallait un bon moment
pour retrouver mes esprits, et je me disais alors avec
soulagement : « Dieu merci, ce n’était qu’un rêve. »
…这三年的生活就是这么的疯狂和可怕,白天我在写作的世界里杀人,晚上我在梦的世界里被人追杀。如此周而复始,我的精神已经来到崩溃的边缘,自己却全然不觉,仍然沉浸在写作的亢奋里,一种生命正在被透支的亢奋。直到有一天,我做了一个漫长的梦,以前的梦都是在自己快要完蛋的时候惊醒,这个梦竟然亲身经历了自己的完蛋。也许是那天我太累了,所以梦见自己完蛋的时候仍然没有被吓醒。就是这个漫长的梦,让一个真实的记忆回来了。
Ces trois années de ma vie ont été de la sorte folles et
terrifiantes. Dans la journée, je tuais dans le monde de mes
récits, et la nuit j’étais traqué dans le monde de mes rêves.
Dans ce cycle infernal, j’avais l’esprit au bord de
l’effondrement, mais je n’en étais pas conscient, j’étais
immergé dans la fièvre de l’écriture, dans une sorte
d’effervescence qui épuisait mes forces vitales. Jusqu’à ce que,
un jour, je fasse un long rêve où, contrairement aux précédents,
je ne me suis pas réveillé sur le point de mourir, j’ai vécu ma
mort. Peut-être étais-je trop fatigué, ce jour-là, pour me
réveiller à temps. Ce rêve, en fait, me rappelait des souvenirs
bien réels.
[souvenir des exécutions publiques auxquelles il avait assisté
non loin de la cour de l’école – dans son rêve il était aussi
« condamné à mort, avec exécution immédiate »
判处死刑,立即执行。
]
Ce rêve a été une prise de conscience et un tournant crucial
dans son écriture :
现在,差不多二十年过去了。回首往事,我仍然心有余悸。我觉得二十年前的自己其实走到了精神崩溃的边缘,如果没有那个经历了自己完蛋的梦,没有那个回来的记忆,我会一直沉浸在血腥和暴力的写作里,直到精神失常。
Maintenant, presque vingt ans se sont écoulés. Pourtant, j’ai
toujours un reste de ces frayeurs en moi. Je pense que j’étais
alors au bord de la dépression nerveuse. Si je n’avais pas fait
ce rêve qui avait resurgir mes souvenirs, j’aurais sans doute
continué à écrire ces histoires de sang et de violence jusqu’à
en devenir fou….
Il y a donc
quelque chose de profondément somnambulique et désaxé dans les
récits de cette époque, mais cela ne suffirait pas à fasciner
autant : c’est la qualité de l’écriture qui en fait des œuvres
d’exception, représentatives à ce titre de l’avant-garde
littéraire de la fin des années 1980.
Violence
transcendée par l’écriture
Les nouvelles,
et surtout les novellas, de cette période ont toutes un style
particulier, au-delà de la concision soulignée de manière
récurrente par les critiques – concision que Yu Hua a un jour
expliquée avec son humour habituel en disant que c’était parce
qu’il n’avait pas pu faire beaucoup d’études et qu’il ne
connaissait pas beaucoup de caractères. On peut les lire comme
des exercices de style, voire des pastiches.
Écriture
fragmentaire et labyrinthique
La novella
« Une certaine réalité » a été publiée en 2004 dans un recueil
de huit nouvelles, courtes et moyennes, de la même période sous
le titre de la dernière qui prend ainsi valeur de symbole : « Un
monde incertain » (shìshì
rúyān《世事如烟》)
.
Yu Hua a expliqué la genèse de l’écriture de ces récits dans son
recueil d’essais (随笔集)
publié en 1998 « Puis-je me croire ? » (ou puis-je avoir
confiance dans ce que je raconte Wo nengfou xiangxin ziji《我能否相信自己》) :
il dit avoir cherché à s’éloigner des faits réels et à s’évader
de toute logique externe en ayant recours à une technique de
structure labyrinthique par juxtaposition non linéaire de bribes
narratives. C’est tout particulièrement le cas d’« Un monde
incertain ».
| |
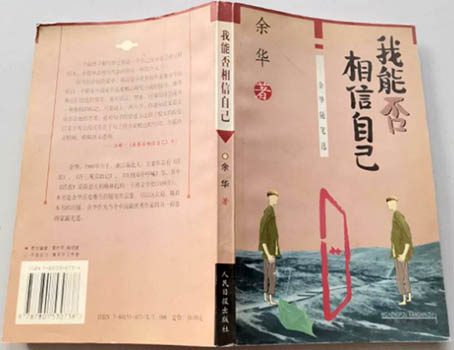
Puis-je me croire ?
Wo nengfou xiangxin ziji |
|
o
Un
monde incertain
shìshì rúyān《世事如烟》
Ce zhongpian
se présente comme une suite de fragments narratifs rapportant
une certaine vision ou interprétation d’incidents et faits
divers intervenus dans un temps incertain et transmis par la
rumeur publique. Les personnages sont voilés dans un mystère
d’autant plus insondable qu’ils ne sont pas désignés par des
noms mais par des chiffres et par leur fonction ou leur
profession : la sage-femme, le devin, la femme en gris, le
chauffeur du camion, l’aveugle. Ils apparaissent ainsi
déshumanisés dès le départ, ombres incertaines dans un paysage
noyé dans la brume. L’histoire, ensuite, est le récit de ce qui
mène à leur mort, inéluctablement, dans un village fantomatique
sur lequel règne un vieux devin de 90 ans arrivé à cet âge en
cultivant son yang grâce à l’appoint de celui de ses cinq fils
morts, voire en violant les jeune filles qu’on lui amène à des
fins de divination.
| |
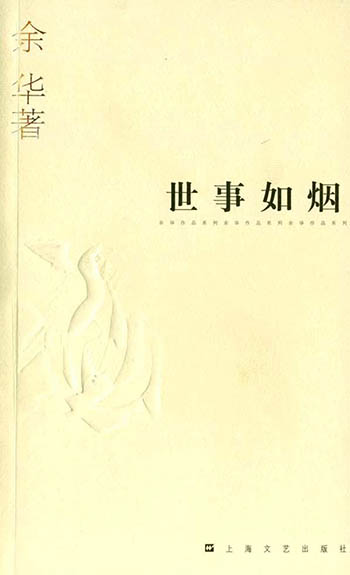
Un monde incertain
Shishi ruyan |
|
Le récit
déroule meurtres, incestes et viols comme des événements
inscrits dans le destin de chacun, la jeune fille 4 étant pour
sa part condamnée par son chiffre même, homonyme de mort.
L’étrange fait partie intégrante du quotidien, le vieux devin
présidant à toutes ces destinées en les manipulant à son profit.
C’est le seul qui n’est pas désigné par un chiffre, mais il est
associé au chiffre 5 : il a eu cinq fils, il a cinq coqs, son
dernier fils survivant meurt à cinquante ans. Il semble être
l’incarnation des croyances et superstitions nées de l’ignorance
et de la peur qu’elle génère. Cependant, contrairement à ceux
des
contes de Pu Songling,
les fantômes chez Yu Hua ne sont pas des apparitions nées
d’illusions, et c’est bien pire : les deux pêcheurs
fantomatiques vus par le père qui vend ses filles lui
apparaissent à l’endroit exact où la plus jeune va se noyer ;
appelée une nuit auprès d’une parturiente froide et pâle, la
sage-femme opère dans un endroit étrange qui se révèle dans la
journée être un cimetière où vient d’être enterrée une femme
morte enceinte, et où elle-même va mourir peu après.
Sur ce récit
fragmentaire plane une peur latente, née de l’impossibilité de
savoir exactement ce qui s’est passé, ou se passe. Yu Hua
emprunte ici au genre des récits fantastiques du zhiguai
(志怪)
et du
chuanqi
(传奇),
en les coulant dans une réalité moderne qui n’est pas coupée de
cette tradition, de ses superstitions, de sa violence latente et
de ses peurs irraisonnées ; l’individu se trouve ainsi pris dans
un réseau d’irrationnalité qui bloque toute compréhension et
suscite l’affabulation. On devine plus qu’on ne sait. Et ce
qu’on devine, c’est une série de suicides, de meurtres et de
violences en tout genre où même les viols sont cautionnés par la
tradition divinatoire, et où tout est conditionné par l’idée de
l’inéluctabilité du destin.
Finalement, les
personnages sont livrés à un destin incontrôlable et opaque sous
la coupe du devin du village au centre du récit, dont le mystère
s’effiloche au fil de la narration, quand la fumée du titre
s’éclaircit un peu de temps en temps. Mais ce destin est en fait
lié à la force maléfique du vieux devin, à la foi absurde qu’il
génère et qui incite les villageois à venir le consulter,
chacune de ces consultations se terminant en drame. Yu Hua
semble suggérer que les anciens contes et légendes ont contribué
à créer un inconscient collectif fondé sur des archétypes
définis par Jung comme l’héritage du passé de l’humanité.
Les fragments
de l’histoire de Shishi ruyan sont en fait inspirés
d’incidents ou événements locaux arrivés dans des petites
localités rurales du sud de la Chine et transmis par le bouche à
oreille sur lesquels sont greffés des éléments fantastiques
typiquement chinois : valeur prémonitoire des rêves,
pratique de la divination, théorie taoïste du yin et du yang,
rites mortuaires, autant d’éléments négatifs de la culture
chinoise traditionnelle contre lesquels s’élève l’auteur.
o
Pages
pour Yang Liu《此文献给少女杨柳》
C’est une
structure fragmentaire et labyrinthique proche que l’on retrouve
dans les « Pages pour Yang Liu ». C’est une histoire de bombes à
retardement laissées dans une petite ville en 1949 par un
régiment de l’armée nationaliste en déroute, les bribes de cette
histoire, contées par un témoin, étant entrecoupées de bribes
d’une autre histoire, celle de la jeune Yang Liu morte dans un
accident de la circulation et dont les yeux ont été greffées sur
un homme qui était en train de devenir aveugle, le tout conté
par un narrateur dont on ne sait trop s’il raconte ce qu’il a vu
ou ce qu’il a rêvé.
L’histoire est
reprise quatre fois, en douze épisodes numérotés qui reviennent
sans rupture au numéro un quand la narration reprend du début,
avec des détails différents chaque fois, mais toujours les mêmes
dates très précises. Cela ressemble beaucoup au style narratif
d’Italo Calvino dans « Si par une nuit d’hiver un voyageur »,
avec une narration en douze fragments aussi, caractérisée par
une série de mises en abyme brouillant les niveaux narratifs.
Par la simple
force de sa structure narrative et de l’ambiguïté des
personnages autant que du narrateur, le récit de ces « Pages
pour Yang Liu » rend la réalité floue, difficile à cerner ; la
violence reste latente, présente dans la menace des bombes, dont
l’une reste encore à exploser à la fin du récit, comme si
c’était emblématique de la réalité de la Chine moderne.
Évocation
des fantômes du passé… littéraire
Ce jeu sur le
caractère fantomatique de la réalité et des apparences prend
aussi les dehors d’un jeu littéraire dans des récits qui font
renaître des spectres littéraires ; mais la réalité, sous la
plume de Yu Hua, subvertit les récits classiques et soumet les
personnages à un sort bien plus cruel que les illusions
d’autrefois.
Cette novella
reprend en effet une histoire des plus classiques : celle des
amants légendaires comme
Liang Shanbo et
Zhu Yingtai (《梁山伯与祝英台》)
ou encore ceux du «
Récit
du Pavillon de l’Ouest » (Xixiangji《西厢记》),
à l’origine un chuanqi de la période Tang développé à
partir de récits antérieurs, le tout dans la grande tradition
littéraire des histoires de « belles jeunes femmes et lettrés
talentueux » (才子佳人).
Le récit de Yu
Hua commence comme un de ces contes traditionnels : un lettré se
rend à la capitale passer les examens mandarinaux, et en chemin,
passant devant une superbe propriété, parvient à se glisser par
une pluie battante sous les fenêtres d’une jeune beauté qui,
pour lui éviter de se tremper, lui offre l’abri de sa chambre
pour la nuit. Au petit matin, le lettré repart en gardant ce
souvenir mémorable, mais il rate les épreuves et rentre chez lui
reprendre ses études. Et quand il revient trois ans plus tard,
sur la même route pour aller passer les mêmes examens, tout a
changé : il traverse un paysage dévasté, la maison n’est plus
que ruine et un terrain vague a remplacé le luxuriant jardin.
Mais on n’est plus chez Pu Songling : la maison n’était pas un
rêve, et la dévastation de toute la région est bien réelle, due
à une terrible sécheresse qui a provoqué une grande famine.
Fini le récit
traditionnel, on est de plain-pied dans un réel atroce où femmes
et enfants sont vendus comme chair à pâté, y compris la jeune
fille retrouvée en train de se faire dépecer dans une auberge.
On retombe dans le fantastique à la fin de l’histoire, un peu
comme dans le « Pavillon
aux pivoines » (Mudanting《牡丹亭》),
mais pas question de résurrection comme dans la scène 35 (回生)
et encore moins de réunion finale comme à la fin de la pièce :
les fantômes n’ont pas droit de cité chez Yu Hua.
o
Un
incident fortuit《偶然事件》
Cet « Incident
fortuit » est un autre exemple de jeu narratif par mise en abyme
tendant à brouiller les pistes d’une histoire très simple : un
homme entre dans un bar et en poignarde un autre qui était en
train d’y prendre un verre. Le reste est un brillant échange de
correspondance visant à déterminer les raisons du meurtre, et se
terminant… sur la scène initiale du meurtre.
Le mode
narratif et le style rappellent Marguerite Duras : celle
d’« Emily L » pour le style et de « Moderato Cantabile » pour le
thème et l’atmosphère, et même une temporalité cyclique très
semblable. « Emily L », c’est le bar de la Marine, où « il n’y
avait presque personne, cet après-midi-là », comme au café des
Gorges chez Yu Hua, et « Moderato Cantabile », c’est l’histoire
d’un meurtre, dans un autre café. « Emily L » date de 1987,
comme l’histoire de Yu Hua qui le précise : septembre 1987.
« Moderato Cantabile », c’est la fin des années 1950, dans le
contexte tragique de l’après-guerre,
post-Auschwitz-post-Hiroshima-post-Staline, atmosphère anxiogène
où plane la peur. « Moderato Cantabile », c’est un travail sur
l’écriture, fondée sur la répétition, l’ellipse, le minimalisme,
« écriture du tâtonnement » que l’on retrouve chez Yu Hua.
La violence
semble être s’être envolée, dans l’histoire, mais elle est
pourtant là, larvée, en attente comme dans les « pages pour Yang
Liu » ; là aussi c’est comme une bombe à retardement, qui finit
par exploser quand la tension a atteint ses limites.
Les autres
nouvelles moyennes de la période comportent la même recherche
sur la forme et l’écriture, dans une atmosphère apparemment
pacifiée, mais où la violence anxiogène est tapie dans les
replis de l’inconscient comme dans la nouvelle (courte) « Je
suis timoré comme une souris » (《我胆小如鼠》)
et où les meurtres sont des histoires de fous, comme dans
« Erreur au bord de l’eau » (《河边的错误》).
Évolution
après 1990
Au début des
années 1990, la narration évolue imperceptiblement. La violence
est toujours là, mais latente et menaçante, même si c’est une
menace naturelle, d’autant plus imprévisible, comme celle d’un
tremblement de terre ou d’un typhon comme dans « Typhon
estival ».
Cette nouvelle
moyenne marque justement un tournant. Le mode narratif évolue
vers une structure alambiquée cultivant le flou et l’incertain,
comme si l’histoire était contée par un fou ou un amnésique, et
qu’il n’en restait que des bribes pour tenter de la reconstituer
– des « cris dans la bruine » (《在细雨中呼喊》)
comme l’annonce le premier roman de Yu Hua, publié en 1991
également, année-charnière donc tant du point de vue de la
thématique que de la forme.
Avec
« Frisson », on voit en outre apparaître dans les nouvelles de
Yu Hua une note d’ humour qui va devenir une caractéristique des
récits à venir, dont « Brothers » (《兄弟》)
bien sûr, dix ans plus tard. Mais c’est un humour grinçant,
toujours aussi froid.
À partir de « Vivre »,
Yu Hua s’oriente vers des narrations plus longues brossant des
tableaux de la société souvent pleins d’humour, mais « Le
septième jour » (《第七天》),
en 2013, revient vers la forme du zhongpian et de la
narration onirique et fragmentaire : c’est une satire sociale
froide et sans concession où la violence revient en force en
reprenant des thèmes antérieurs, et en posant l’au-delà, après
la mort, comme un paradis égalitaire offrant la perspective d’un
apaisant repos éternel aux morts sans sépulture.
Traductions
en français
Voir à la fin
de la
présentation de l’auteur.
À lire en complément
-
Haunted Fiction: Modern Chinese Literature and the Supernatural,
Anne Wedell-Wedellsborg (université d’Aarhus, Danemark), The
International Fiction Review, Vol. 32, No. 1 & 2, 2005.
https://journals.lib.unb.ca/index.php/IFR/article/view/7797/8854
-
The Disenchantment of History and the Tragic Consciousness of
Chinese Postmodernity, Alberto Castelli, Comparative Literature
and Culture 21.4 (2019)
https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3085&context=clcweb
Chinese
“Avant-Gardism”: A Representative Study of Yu Hua's
“1986”
|

