|
Ye Fu
野夫
Présentation
par Brigitte
Duzan, 27 novembre 2012, actualisé 25 novembre 2025
| |

Ye Fu |
|
Ye Fu est l’une
de ces voix originales et singulières en Chine, aujourd’hui, qui
réussissent à se faire entendre grâce à internet, et aux
publications à Taiwan et Hong Kong, dans son cas après avoir été
réduit au silence par une condamnation à cinq ans de prison au
début des années 1990.
Ses écrits sont
d’autant plus intéressants qu’il est porteur d’une mémoire
familiale tragique, qui reflète un pan de l’histoire chinoise
moderne dont on parle très peu.
Carrière
littéraire brisée net en 1990
De son vrai nom
Zheng Shiping (郑世平),
Ye Fu (野夫)
est né en 1962 dans un petit village proche de Lichuan (利川市),
dans la
préfecture autonome tujia et miao d'Enshi
(恩施土家族苗族自治州),
dans le sud-ouest montagneux du Hubei.
Poète dans
l’euphorie de la fin des années 1980
Il a une
enfance pauvre et difficile. Après la Révolution culturelle, à
la réouverture des universités en 1978, il entre à l’Institut
des nationalités du Hubei (湖北民族学院)
pour étudier la littérature
chinoise ; il a seize ans et commence à écrire des poésies. Il
est cependant fermement déterminé à poursuivre ses études
littéraires à l’université de Wuhan, la capitale de la province.
Quatre ans plus
tard, en 1982, il fonde la première société de poésie de l’est
du Hubei, dont le nom est inspiré d’un vers du Shijing,
se replaçant ainsi dans la plus ancienne tradition poétique
chinoise, une tradition populaire
.
Par deux fois, il organise à Lichuan une grande réunion
poétique, au niveau provincial. C’est dans ce contexte qu’il
commence à utiliser le nom de plume de Ye Fu.
En 1985, il
devient directeur général de la Société d’études poétiques des
jeunes du Hubei (湖北省青年诗歌学会).Mais,
en 1986, il réalise son rêve : il entre en cours d’année à
l’université de Wuhan et peut enfin continuer ses études de
littérature chinoise.
Il est ainsi
décrit par l’écrivaine Zhang
Yihe (章诒和),
l’une des premières à le découvrir et le faire connaître :
“他在鄂西土生土长,视武汉大学为教育圣地”
C’est un
enfant de l’ouest du Hubei où il est né et a grandi, mais
l’université de Wuhan a été pour lui la Terre sainte de
l’éducation.
Il crée à Wuhan
le « salon poétique post-moderne » (“后现代诗人沙龙”)
de la province du Hubei et publie son premier recueil de
poésie : « Les pleurs du loup dans la nuit » (《狼之夜哭》).
Il est l’ami et le disciple de Yi Zhongtian (易中天),
personnalité du monde universitaire de Wuhan
.
| |
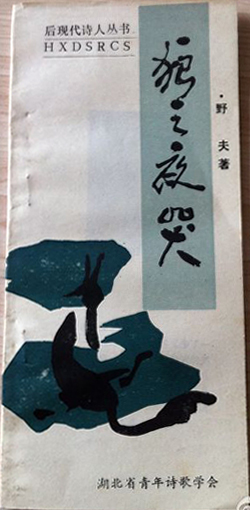
Recueil de poèmes, Les pleurs du loup la
nuit
(titre calligraphié de la main de l’auteur) |
|
| |

Yi Zhongtian |
|
Emblème
d’une génération et d’une époque
Ye Fu termine
ses études en 1988. Il est alors envoyé à Haikou, dans l’île de
Hainan (海南省海口市),
pour travailler au bureau local de la sécurité publique. Mais
brusquement, en 1990, pour avoir sympathisé avec « un certain
mouvement » (“因同情某运动”),
il démissionne de son poste. Il est ensuite accusé d’avoir
« divulgué des secrets d’Etat », accusation classique portée
contre les esprits un peu trop indépendants, et condamné à six
ans de prison.
Ye Fu subit le
sort de tant de ses camarades étudiants et poètes qui, à la fin
des années 1980, ont vécu dans l’effervescence d’une liberté
intellectuelle qu’ils n’avaient encore jamais connue. C’était
une période où soudain les débats culturels et politiques
s’emballaient et où tous les espoirs semblaient permis. Jusqu’à
ce que les événements de Tian’anmen viennent y mettre une triste
fin.
Certains ont
payé leur engagement de leur vie ; Ye Fu l’a seulement payé de
cinq années de détention, mais elles l’ont coupé du monde et
l’ont marqué à jamais. Les événements familiaux particulièrement
pénibles qui ont marqué sa libération ont ensuite contribué à
faire de lui un écrivain détenteur d’une mémoire à préserver et
à transmettre.
Naissance
d’un écrivain indépendant
Ye Fu bénéficie
d’une remise de peine : il est libéré en 1995. Mais le retour à
la vie sans barreaux n’est pas facile : son père est mort d’un
cancer pendant qu’il purgeait sa peine ; après sa remise en
liberté, sa mère se suicide en se jetant dans le fleuve ; son
corps ne sera jamais retrouvé.
Premières
activités d’édition
Pour vivre, Ye
Fu se lance alors dans l’édition. En février 1996, il crée une
société d’édition indépendante à Pékin ; son ami Yi Zhongtian
l’aide à démarrer en lui confiant deux de ses manuscrits à
publier : « Des Chinois » (《闲话中国人》)
et « Hommes et femmes de Chine » (《中国的男人和女人》).
Il lui faut
surtout arriver à surmonter le traumatisme causé par la mort
tragique de ses parents, et avant tout celle de sa mère dont le
souvenir le hante. Il n’est pas encore capable d’en parler, cela
reste pour lui de l’ordre du cauchemar.
La fin des
années 1980 avait été une période de fol espoir en l’avenir,
brutalement détruit ; la fin des années 1990 s’amorce comme une
période de collecte de souvenirs douloureux et une recherche sur
les événements y ayant conduit qui vont nourrir une série de
livres publiés à la fin des années 2000, d’abord sous forme de
textes séparés sur internet.
Alors que se
multiplient les ouvrages sur le mouvement anti-droitiers et la
famine causée par le Grand Bond en avant
,
Ye Fu remonte à une période encore plus rarement traitée en
littérature : le début des années 1950, avec les grandes purges
effectuées dans le cadre de la réforme agraire, et l’éradication
des « bandits » locaux pour renforcer le pouvoir central.
Mais l’époque est évoquée à travers les déboires subis par sa
famille et leurs proches.
Sources
familiales de ses écrits
Ye Fu a des
antécédents très lourds, tout le monde faisait partie des « cinq
catégories noires », d’une manière ou d’une autre, autour de
lui : son père était d’une famille de « propriétaires terriens »
(“地主”),
son grand-père maternel était un ancien « seigneur de la
guerre » (“旧军阀”),
sa grand-mère maternelle venait d’une très bonne famille et sa
mère avait été déclarée « droitière » (“右派”).
Le grand-père
maternel était parti au Japon au tout début de la République, et
avait fait des études de droit pendant huit ans à l’université
de Waseda. A son retour en Chine, vers 1920, il avait été juge
d’instance au Gansu. Son fils avait étudié dans une école
militaire, et aurait été garde du corps de Chang Kai-chek ;
puis, après l’invasion japonaise, il avait été posté à Wuhan
avec grade de sous-officier et s’était remarié.
La mère de Ye
Fu avait alors changé de nom. En 1948, elle avait rejoint la
révolution et avait participé à la réforme agraire à Enshi ainsi
qu’au mouvement de « liquidation des bandits » (剿匪).
Elle avait rencontré là par hasard le père de Ye Fu qui était le
fils d’un notable du coin. En 1957, ensuite, elle avait été
condamnée comme droitière pour être la fille d’un « seigneur de
la guerre ».
La famille de
son père, de son côté, a énormément souffert pendant la réforme
agraire. Parce que le grand-père possédait un champ de dix mus,
il fut classé « propriétaire terrien », persécuté et finit par
se pendre ; son frère aîné se jeta dans le Yangzi, son corps n’a
jamais été retrouvé ; le frère cadet fut condamné aux travaux
forcés ; quant aux deux épouses, elles se sont pendues ensemble,
une nuit, avec la même corde, à la même poutre.
Directeur d’une
mine de charbon, le père de Ye Fu a été persécuté pendant la
Révolution culturelle. Sa mère était comptable dans une
coopérative, et c’est avec son maigre salaire qu’elle
nourrissait toute la famille … Ye Fu et ses deux sœurs ont été
élevés par leur grand-mère. Lui souffrait de tuberculose et
avait besoin d’être soigné, ses deux sœurs n’ont pu continuer
leurs études. Ils habitaient dans une ruelle sans électricité
où, la nuit, on s’éclairait à la lueur de lampes à huile, et la
grand-mère racontait des histoires ….
Avec ses
mauvais antécédents familiaux, la vie ne fut pas facile pour le
jeune Ye Fu. Pendant toute la Révolution culturelle, les autres
enfants le poursuivaient en lui criant les pires insultes qu’ils
pouvaient imaginer : « Fils de propriétaire terrien… ». Ye Fu
est devenu un enfant querelleur. Même quand il est entré à
l’Institut des nationalités, en 1978, l’habitude lui est restée
d’en venir aux mains facilement. Il dit avoir gardé de
nombreuses cicatrices sur tout le corps, témoins des coups de
couteau reçus.
Le choix de son
nom de plume vient de là : il est tiré d’un poème célèbre du
poète des Tang Liu Cha (刘叉)
intitulé « message incident » (《偶书》)
:
日出扶桑一丈高, 人间万事细如毛。
野夫怒见不平处,
磨损胸中万古刀。
Sorti du mûrier, le soleil est déjà haut,
Parmi les choses humaines aussi ténues que les poils sur la
peau.
Le poète regarde avec colère les injustices,
Fourbissant dix mille sabres en son sein.
Jusqu’à la
veille de sa mort, son père a gardé le silence sur
l’extermination de sa famille. Sa mort, suivie du suicide de sa
mère, a été déterminante pour Ye Fu : il s’est résolu à raconter
leur histoire, mais il lui aura fallu longtemps pour arriver à
en parler.
Une œuvre
qui porte témoignage
Tous les livres
de Ye Fu sont constitués de textes qui ont été publiés
séparément sur internet et ont ainsi attiré l’attention
d’éditeurs, à Taiwan et Hong Kong, où ils ont ensuite été
publiés en les regroupant. Certains se retrouvent plusieurs fois
dans des livres différents.
Ye Fu a
commencé par l’histoire de sa mère, puis a continué avec
l’histoire de la famille de son père. Il s’agit d’une
composition en étoile, structurant autour d’un personnage tout
un univers fait de ses amis et de ses proches, et des événements
qui l’ont marqué, et qui finit ainsi par raconter l’histoire
d’une époque, dans le sud-ouest du Hubei…
Mai 2009 :
« Ma mère sur les eaux du fleuve » (《江上的母亲》)
Il lui aura
fallu dix ans pour pouvoir surmonter le souvenir de ce jour
terrible où sa mère s’est jetée dans le fleuve, et évoquer les
soixante huit ans qui l’ont précédé et y ont conduit ; il
commence ainsi son récit :
这是一篇萦怀于心而又一直不敢动笔的文章,是心中绷得太紧以至于怕轻轻一抚就砉然断裂的弦丝,却又恍若巨石在喉,耿耿于无数个不眠之夜,在黑暗中撕心裂肺,似乎只需默默一念…。
Voici un
récit qui m’a hanté jour et nuit, mais que je n’arrivais
pourtant pas à coucher par écrit ; je sentais au fond du cœur
une corde si tendue que j’avais peur de la rompre même en
l’effleurant tout doucement, j’avais comme une énorme pierre
dans la gorge, une pensée obsédante qui me faisait passer des
nuits blanches, tourmenté dans l’obscurité, mais condamné au
silence …
…整整十年了,身寄北国的我仍不敢重回那一段冰冷的水域,不敢也不欲去想象我投江失踪的母亲,至今仍暴尸于哪一片月光下……
… dix ans se
sont écoulés ; de ces terres du nord où je suis parti, je n’ose
toujours pas revenir à ces eaux glacées, n’ose ni ne désire
m’imaginer ma mère disparue dans le fleuve sans laisser de
traces, me demandant toujours sous quelle lueur lunaire reposent
ses restes laissés sans sépulture…
| |
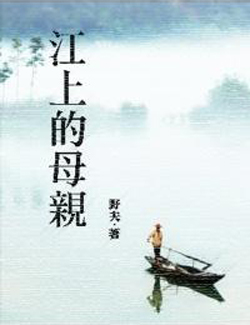
Ma mère, remontant le fleuve |
|
Ces quelques
lignes sont la meilleure introduction à l’œuvre de Ye Fu : une
pensée profonde et poignante, exprimée dans une langue poétique
et raffinée, où affleure à chaque détour de la phrase une
expression recherchée, souvent puisée dans la poésie ancienne.
Constitué de
textes relativement courts, ce livre est, outre le reflet d’un
pan d’histoire personnelle, une réflexion sur cette histoire, et
les souffrances endurées par toute une génération, et même
plusieurs. C’est un récit cathartique et libérateur, mais où
l’émotion reste cependant contrôlée et l’expression concise et
allusive, comme dans un poème. Le premier récit, sur la
disparition de sa mère, constitue une sorte de leitmotif qui
revient ensuite dans ses livres suivants.
Le livre se
poursuit par le récit complémentaire de la vie du père de Ye Fu.
Septembre 2009 :
« Le combat de mon père » (《父亲的战争》)
Ce livre
concerne plus particulièrement l’histoire de la Chine du début
des années 1950 : les persécutions perpétrées dans le cadre de
la réforme agraire, et un mouvement très peu connu et rarement
abordé en littérature.
| |
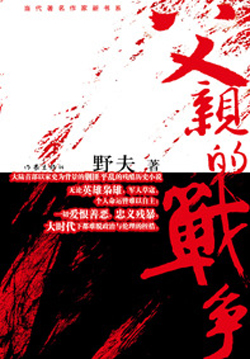
Le combat de mon père |
|
Il s’agit de la
campagne dite de « liquidation des bandits et suppression des
rébellions » (剿匪平乱
jiǎofěi
píngluàn),
ou encore « liquidation des
bandits et lutte contre les despotes » (清匪反霸
qīngfěi
fǎnbà).
Ye Fu part d’un souvenir que lui a confié son père avant de
mourir, et en profite pour relativiser l’histoire telle qu’elle
est contée dans les manuels, de même qu’il revisite celle de la
réforme agraire à partir du traitement infligé à la famille de
son père, annihilée pour avoir possédé une dizaine de mu.
L’existence
desdits « bandits » (匪)
est liée
au chaos qui régnait dans l’empire, puis au début du vingtième
siècle en Chine, le gouvernement central ne parvenant pas à
contrôler la totalité du pays, les différentes régions étant
sous la coupe d’un potentat local. La déliquescence du pouvoir
central s’est accélérée pendant les années de guerre, avec la
multiplication des « seigneurs
de la guerre »
(军阀),
mais elle existait bien avant : on disait « là où il y a un
fonctionnaire il y a un bandit » (有官就有匪).
Quand les
communistes sont arrivés au pouvoir, ils ont voulu éradiquer ces
pouvoirs locaux pour renforcer le pouvoir central, et ils ont
lancé cette campagne contre les « bandits » locaux. Cependant,
de même que les « propriétaires terriens » n’étaient souvent que
de pauvres bougres qui possédaient quelques arpents de terre,
les « bandits » n’étaient souvent guère plus répréhensibles.
Mais ils furent soumis à une campagne tout aussi systématique.
Le combat fut
en outre mené par la population elle même, comme pour la réforme
agraire. Le récit de Ye Fu est révélateur des traumatismes
engendrés, d’autant plus pernicieux qu’ils restaient
nécessairement du domaine du non-dit, comme le reste.
Son père avait
gardé toute sa vie ce poids sur la conscience : il avait remis
un « bandit » aux nouvelles autorités, et l’homme avait été
illico sommairement exécuté. Ye Fu élargit le propos en une
réflexion humaniste relativisant les idées reçues, et les
définitions, et brouillant les différences entre héros et
aventuriers, militaires et voleurs de grand chemin, entre amour
et haine, gouvernement et morale, justice et barbarie, et
finalement, bien et mal.
Toute l’œuvre
ultérieure de Ye Fu est une réflexion complémentaire sur les
mêmes thèmes. Il lui fallait libérer d’abord la parole, mais, ce
premier pas effectué, ce sont dix, voire quinze ans de silence
qui affleurent ensuite sous sa plume.
Dans deux
ouvrages plus récents, Ye Fu est revenu sur ses
deux principaux axes de réflexion : d’une part son pays, et la
recherche d’identité et de racines qui lui est liée, et d’autre
part la vaste notion de jianghu, qui sous-tend en Chine
un concept historique autant que philosophique, lié aux xia
et à toute la littérature de wuxia, et, de façon plus
générale, à toute existence en marge, en marge du pouvoir et en
marge de la société, en marge aussi des idées reçues.
Mai 2012 :
« A la recherche de mon pays natal »
(《乡关何处》)
Cette
recherche, qui est aussi une recherche de racines, une recherche
des origines, est définie dans la seconde partie du titre du
livre : « mon pays natal, les gens et leurs histoires »
(故乡·故人·故事).
C’est une histoire triste,
résumée en quelques caractères, comme le début d’un poème :
千回百转,长歌当哭
mille et un tourments, un long poème plutôt que d’en pleurer
| |

A la recherche de mon pays natal |
|
Ce qui ressort,
effectivement, au long des pages, c’est une extrême tristesse
née de tensions accumulées, beaucoup plus forte qu’une brusque
explosion de larmes. On retrouve beaucoup des textes déjà
publiés, mais comme mis en abyme par le texte final :
故乡,故人,故事——关于拙著几种的注脚并答谢天下同道
mon pays natal, les gens et leurs histoires –
modestes notes
et remerciements à quelques compagnons de route
Le livre a été
publié en Chine continentale.
Août 2012 :
« Invisible jianghu » (《看不见的江湖》)
Avec ce livre,
Ye Fu semble aborder une nouvelle étape, avec une écriture moins
directement liée à la tragédie familiale, une écriture plus
réflexive. Pour une fois, le livre ne commence pas par le texte
commémorant le suicide de sa mère. L’auteur semble avoir tourné
une page.
| |

Invisible Jianghu |
|
Le livre est en
deux parties : 1.
骊歌
lígē :
terme qui, dans la littérature ancienne, désignait les mots
prononcés par un hôte pour annoncer son départ et 2.
尘海
chénhǎi
mer/monde de poussière (d’ici-bas)
La première
partie est comme un dernier hommage aux grandes figures de son
passé, la seconde une réflexion sur le monde actuel qui affirme
le rôle de la littérature comme témoin du temps présent après
l’avoir été du temps passé.
Le livre se
termine par un dernier texte en guise de post-scriptum (代跋) :
se souvenir pour résister – ou la mémoire comme forme de
résistance (让记忆抵抗).
L’ouvrage a été à nouveau publié à Taiwan…
Nouvel
épisode : Chiangmai
Depuis la fin
de 2019, Ye Fu vit dans à Chiangmai, en Thaïlande, où il est
parti très vite quand un médecin de Wuhan lui a parlé d’un virus
qui se propageait dangereusement dans sa province natale du
Hubei. Il fait partie là d’une communauté croissante de
compatriotes chinois, intellectuels, artistes et autres, qui
retrouvent à Chiangmai, dans un cadre idyllique, une liberté de
pensée et d’expression qu’ils avaient perdue en Chine. Une
librairie a ouvert en novembre 2023 : le Nowhere Bookstore,
fondé par la journaliste
Zhang Jieping qui en a créé un autre à Taipei, et maintenant
à Tokyo. Les jeunes Chinois de passage ont ainsi l’occasion
de trouver là des livres introuvables sur le Continent. C’est la
nouvelle « République de Nulle Part ».
Ye Fu n’est
certes pas totalement en sécurité en Thaïlande : fin 2015, le
libraire Gui Minhai (桂敏海)
y a été kidnappé ; détenu en Chine, il a été condamné en février
2020 à dix ans de prison. Mais aucun pays n’est aujourd’hui
totalement épargné, et la Thaïlande reste relativement
attractive, pour son rythme de vie, mais aussi sa culture,
proche de la culture traditionnelle chinoise, surtout Chiangmai,
ancienne ville fortifiée, capitale du royaume de Lanna, et
berceau du bouddhisme.
Interview de Ye Fu par Vivian Wu (吳薇),
Dasheng Media, 2023
https://www.youtube.com/watch?v=zMVuJ0qRocw
Remerciements
Nous tenons à
remercier Victor Rémy de nous avoir fait connaître cet auteur
qu’il a rencontré à Pékin en novembre 2012.
Victor Rémy
était alors étudiant en M2 Asie Orientale Contemporaine, à
l’IEP/ENS de Lyon, et faisait un travail de recherche sur la
littérature chinoise contemporaine "indépendante", sous la
direction de Mme Laurence Roulleau-Berger, pour un mémoire de
sociologie de l'art.
A lire en
complément
Blog de Ye Fu
(jusqu’en 2012) :
http://blog.sina.com.cn/hktjyf
Traduction
en anglais
Hard Road Home, tr. A.E. Clark, Ragged Banner Press, 2014.
Recueil qui
comporte les sept textes suivants :
-
A Mother to the River
Gone
《江上的母亲》
-
The Watcher at Great
Well
《大水井的守望者》
-
Requiem for a
Landlord
《地主之殇》
-
An Education in
Cruelty
《残忍教育》
-
Brother Blind Ma
《瞎子哥》
-
Su Jiaqiao, a Man
Apart 《幽人苏家桥》
-
Tomb Lantern
《坟灯》
Traduction
en français
Ma mère
emportée par le fleuve
《江上的母亲》,
trad. Brigitte Guilbaud, éd. Picquier, 2025.
Selon une ancienne légende, le mûrier est l’endroit d’où
sort le soleil. Quant à yěfú
(野夫),
yě
(野)
signifie sauvage dans son acception habituelle, mais
désigne aussi un homme en dehors des cercles
gouvernementaux, un homme qui n’a pas de fonction
officielle, donc pas de responsabilités publiques, comme
les écrivains et poètes autrefois qui abandonnaient leur
poste officiel par désaccord avec la politique menée à
l’encontre du peuple.
Liu Cha
fut actif de 806 à 820, sous le règne de l’empereur
Xianzong (Tang Xianzong
唐憲宗),
dont les succès militaires réussirent à réprimer un
temps les rébellions et les velléités d’indépendance des
gouverneurs militaires, mais ne furent pas suffisants
pour contrer l’affaiblissement du pouvoir impérial.
Le
poème entier à écouter, avec le texte :
http://v.youku.com/v_show/id_XNDc0NjU5NjI4.html
|

