|
|
« Pluie » : la narration diluvienne de Ng Kim Chew
par Brigitte
Duzan, 8 février 2022
|
L’édition 2021 du prix Émile Guimet de littérature
asiatique a été décerné à « Pluie » (《雨》)
de
Ng Kim Chew (Huang Jinshu
黄锦树),
dans la traduction de
Pierre-Mong Lim
parue aux éditions Picquier en avril 2020
.
Ce cinquième prix Émile Guimet mettait ainsi à
l’honneur un auteur représentatif d’une littérature
encore grandement méconnue : la
littérature dite mahua (马华文学)
ou littérature sinophone de Malaisie – littérature
« des marges » où Ng Kim Chew fait lui-même figure
de marginal. « Pluie » a été couvert de prix, à
Taiwan et en Chine continentale, où il a été le
premier recueil de l’auteur à être édité in extenso.
Un texte envoûtant, et déroutant
Publié à Taiwan en 2016, et en 2018 à Chengdu, en
Chine continentale, « Pluie » nous plonge tout de
suite dans l’univers de Ng Kim Chew : celui de la
forêt tropicale |
|

Pluie, traduction française, Picquier
2020 |
d’hévéas de la péninsule malaisienne (Malaixiya
bandao jiaolin
马来西亚半岛胶林)
caractéristique de son Johor natal, au sud de la péninsule.
Le dépaysement est assuré dès les premières lignes :
incertitude quant au temps de la narration, incertitude
narrative aussi, tout est noyé dans un paysage quasi
aquatique, sous une pluie incessante et tout près d’un
fleuve.
L’eau est
élément primordial, l’élément yin, sombre et maléfique,
c’est l’eau de la Genèse et celle du Déluge, c’est une eau qui
menace de tout engloutir et de tout détruire, à commencer par la
maison de la famille au centre de la narration. À la menace de
l’eau s’ajoute celle des animaux de la forêt, dont le tigre qui
surgit dès le premier « tableau », attiré par les sangliers et
annoncé par son odeur qui vient dominer celle de l’humidité et
de la pourriture.
|

Pluie, édition chinoise 2018 |
|
De ce cadre qui tend vers le mythique sur fond de
superstitions et de fantasmes, se détache un enfant
nommé Sin, quatre ou cinq ans, dont le regard est
celui dans lequel se coule le narrateur pour nous
décrire la famille et ses drames, entourés de
mystère. C’est une famille d’origine chinoise
originaire du Fujian comme celle de l’auteur. Vivant
de la récolte du latex, ils sont réduits à
l’inactivité par la pluie, et de l’inactivité forcée
surgissent fantasmes, cauchemars récurrents et
histoires racontées le temps d’ébouillanter les
fourmis qui envahissent la maison pour tenter de
trouver un endroit sec. Le Roi Singe Sun Wukong du
« Voyage vers l’ouest » (Xiyouji
《西游记》)
vient ainsi se joindre aux animaux de la forêt dans
l’imaginaire de l’enfant.
C’est autour de cet
enfant qu’est bâti le fil narratif principal, mais
s’agit-il bien toujours du même enfant ? On devine à
travers les mots, les allusions, que l’enfant
|
est en
fait aussi irréel et illusoire que la forêt sous la pluie.
Incarnation et réincarnation du même portant le même prénom,
Sin est lui-même et autre, image vivante des croyances
bouddhistes mâtinées de taoïsme qui animent la mère : il
faut aider l’âme d’un enfant mal mort à trouver bien vite
une enveloppe charnelle où se réincarner pour éviter qu’elle
vienne vous hanter.
Si
l’identité de l’enfant est floue, celle du père l’est tout
autant, liée à l’incertitude sur le temps narratif, une allusion
renvoyant à une autre quelques « tableaux » plus loin. Tout est
fait pour semer le doute dans l’esprit du lecteur déjà dérouté
par les événements dramatiques qu’il entrevoit à peine derrière
le rideau de pluie et le flou narratif. Un pan de réalité se
dévoile soudain, comme une accalmie dans le déluge et à travers
une trouée dans les nuages : c’est l’invasion japonaise, avec
ses atrocités contre la population chinoise, soudain dépeintes
avec un réalisme qui tranche sur le reste de la narration, à
coups de rapports de presse cités in extenso.
Si les
drames familiaux avec leurs chapelets de morts vite enterrés
sous un hévéa restent du domaine de la mémoire incertaine et des
peurs diffuses, les exactions des Japonais sont précises car
documentées noir sur blanc dans le journal. La mort est
omniprésente, mais elle n’est pas présente de la même manière.
Le dernier
tableau est l’apogée paradoxale de cette narration, le déluge
verbal se réduisant soudain à une impossibilité de dire, qui se
traduit dans le titre d’abord : dire quoi ? La profusion de
malheurs finit par la négation du malheur même, devenant
indicible. Ce que Ng Kim Chew met en scène, c’est finalement la
déroute du langage, au-delà de ses excès - une déroute
éminemment symbolique.
Un
non-roman
Une construction en chapitres
Tel qu’édité dans la traduction française, « Pluie » se présente
comme une succession de sept « tableaux » et un tableau
conclusif
,
le tout
précédé d’un poème introductif.
雨天
Jours de pluie (Introduction)
老虎,老虎
《雨》作品一号 1er tableau : Au tigre ! Au tigre !
树顶
《雨》作品二号 2ème tableau : Au sommet de l’arbre
水窟边
《雨》作品三号 3ème tableau : Au bord de l’eau
拿督公
《雨》作品四号 4ème tableau : Na Duk, les génies du sol
龙舟
《雨》作品五号 5ème tableau : Le Bateau-dragon
沙
《雨》作品六号 6ème tableau : Sable
另一边
《雨》作品七号 7ème tableau : De l’autre côté
土糜胿《雨》作品八号 8ème tableau : Coâ Coâ Coâ
Les textes
commencent par un poème, « Jours de pluie » (雨天)
,
selon la
vieille tradition, née de l’art des conteurs, des romans dits
« à chapitres », ou encore des récits de
Feng
Menglong (冯夢龙).
Ce poème introductif sert à amorcer le récit en
en créant dès l’abord l’atmosphère, autour de la pluie, mais
elle n’est pas là seulement pour le décor et l’atmosphère : elle
est aussi présage, elle annonce les drames et désastres à venir
dont elle noie ensuite le souvenir et la chronologie. Le poème
annonce également le style elliptique du texte qui suit, et son
mode narratif, brumeux et énigmatique par la volonté
perceptible de déconstruction de la ligne narrative, ou volonté,
plutôt, de ne pas se laisser enfermer dans des codes.
En réalité un recueil de nouvelles
« Pluie » est d’autant plus intéressant qu’il ne s’agit pas d’un
roman : c’est en fait un recueil de seize récits, et c’est le
travail du traducteur, pour l’éditeur français, qui en a fait un
texte rebaptisé roman, en sélectionnant les huit nouvelles dont
les titres reprennent expressément le terme de pluie ; on
pourrait dire « Pluie (histoire) n° 1 », « Pluie (histoire) n°
2 », etc… Cela crée une meilleure lisibilité pour le lecteur
français, qui peut ainsi tenter de suivre les personnages de la
première nouvelle dans leurs péripéties et avatars multiples
contés dans les nouvelles suivantes.
Cela ne recrée pas pour autant une ligne
narrative cohérente là où il n’y en avait pas, mais cela tend
malgré tout à brouiller quelque peu l’image d’un auteur qui
s’est toujours proclamé résolument opposé au « grand récit »
traditionnel, et qui est reconnu en tant qu’auteur de nouvelles,
et non de roman. La requalification du texte en « roman » induit
une lecture un peu biaisée, les critiques saluant un « roman »
déconstruit : il est en fait tellement déconstruit qu’il n’est
pas un roman ; l’auteur est revenu à la forme de la nouvelle,
dans un mouvement de retour aux
origines
du xiaoshuo qui s’intègre
parfaitement dans sa réflexion et sa démarche.
D’ailleurs, quand on pense à des influences, ou des parallèles,
il s’agit toujours de textes courts, nouvelles ou « contes ».
Cependant, la séquence même de ces histoires dont les liens sont
assez flous est par ailleurs représentative de cette démarche.
La troisième histoire non numérotée (et la deuxième insérée
après le poème introductif), par exemple, intitulée « Retour »
(Guilai 归来), est apparemment sans lien avec les nouvelles qui
suivent intitulées « Pluie », mais elle est en fait un texte
précurseur, et une sorte de référence pour les autres. Elle
participe de la méthode complexe de narrations multiples mise en
œuvre ici par l’auteur.
Influences et parallèles
« Pluie » est une narration complexe et novatrice qui évoque de
nombreux parallèles dans la littérature chinoise aussi bien que
mondiale, et ce dans le fond comme dans la forme.
|

La Secte du Lotus blanc, de Pu
Songling, illustration du géant monstrueux du conte |
|
Si l’atmosphère et l’irruption du
surnaturel dans le quotidien rappellent un peu
l’univers de
Pu Songling (蒲松龄)
,
la forme rappelle
beaucoup plus, comme noté plus haut, celle des
récits de
Feng Menglong (冯夢龙),
avec en référence la
tradition plus ancienne du zhiguai (志怪小说), contes de
l’étrange peuplés d’esprits et de fantômes et
nourris de superstitions – les « diables » japonais
venant se surimposer aux démons et fantômes
naturels.
Dans le registre réaliste, le
critique David Der-wei Wang (王德威) a perçu dans la
Malaisie dépeinte par Ng Kin Chew l’évocation d’un
pays natal rappelant les écrits de
Shen Congwen (沈从文),
et surtout ses récits
autobiographiques. Mais c’est sans compter avec les
divergences : « [chez Ng Kin Chew] on a le
sentiment de voir les pages maculées de sang entre
les lignes » (你都感觉字里行间溅着血光).
Le spectre de la mort est omniprésent. |
|
D’autres auteurs ont
également manifesté leur intérêt pour ces nouvelles,
en particulier à Taiwan.
Chu Tien-wen (朱天文),
pour sa part, a préfacé le recueil en intitulant sa
préface : « Poèmes à toute vitesse – lire "Pluie" »
(迅速之诗——读《雨》).
Elle y fait dès l’abord un parallèle avec « La
métamorphose » de Kafka qui représente aussi
l’intrusion du surnaturel dans la vie quotidienne,
mais dans une peinture hyperréaliste de la
métamorphose du narrateur.
C’est surtout la forme narrative qui surprend, dans
« Pluie ». Derrière ce récit désarticulé où l’on
peine à suivre les personnages dans leurs mutations
narratives, certains critiques ont aussi vu se
profiler l’influence du fameux « réalisme magique »
latino-américain. Qui, en Chine, depuis les années
1980, n’a pas été influencé par le réalisme
magique ? Ici, cependant, me souffle
Pierre Mong-Lim
en marge
de
notre entretien
sur
« Pluie », |
|
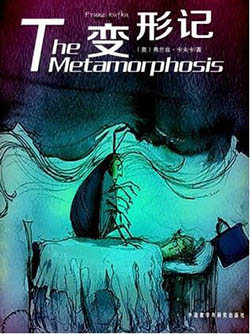
La métamorphose de Kafka,
version chinoise bilingue |
son auteur et la littérature
mahua, il s’agit non tant de García Márquez que de
Borges.
|
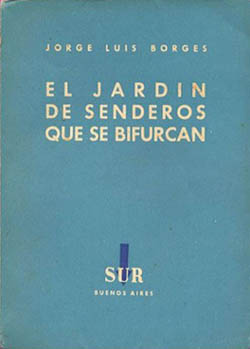
El Jardín de senderos que se bifurcan |
|
Pierre Mong-Lim trouve
dans « Pluie » des analogies, en particulier, avec
« El Jardín de senderos que se bifurcan » (Le jardin
de sentiers qui bifurquent), nouvelle (ou cuento)
qui a donné son titre à un recueil publié en 1941.
C’est l’un des premiers textes qui ont fait
connaître Borges : une fausse histoire policière,
pour introduire une histoire de labyrinthe que l’on
peut qualifier de déconstruite avant l’heure, les
personnages, en plus, étant chinois. Pour les
besoins d’une mission, le personnage principal,
l’espion Yu Tsun, retrouve les traces d’un
astrologue chinois, Ts’ui Pen, qui s’avère être son
arrière-grand-père. Or ce Ts’ui Pen s’était fixé
deux taches impossibles : construire un labyrinthe
infiniment complexe et écrire un roman
extraordinaire et interminable. Finalement, le roman
même se révèle être le labyrinthe, temporel et non
spatial. Le jardin constitué par ce labyrinthe est
une image – forcément incomplète – de l’univers, et
le roman qui en est |
l’expression est forcément
incomplet lui aussi, mais également absurde et incohérent,
faute de permettre au lecteur d’en saisir le dessin dans sa
totalité.
Ce conte est décrit par Borges comme une parabole dont le thème
véritable est le temps dont le nom même n’apparaît pas : il se
cache derrière des métaphores et des périphrases, et dans les
méandres d’un récit où se perd la notion d’un temps uniforme et
absolu comme celui de Newton, au profit d’un réseau de temps
divergents et parallèles, comme des sentiers qui bifurquent.
C’est bien l’impression que l’on ressent à la lecture de
« Pluie » qui semble être inspiré du conte de Borges jusque dans
sa forme, avec poème introductif soulignant le décalage entre le
jardin labyrinthique du roman et l’autre labyrinthe qu’est la
réalité, au présent, vue par la fenêtre. Mais ces voies qui
bifurquent sont aussi diverses manières de concevoir et de lire
une histoire, en partant du début ou de la fin, ou de tout autre
point, comme chez Italo Calvino : Si par une nuit d’hiver un
voyageur…
Au-delà
de la réalité
Les dernières pages prennent des allures de fantasmes
cauchemardesques où l’on finit par perdre tout sens de la
réalité, hormis la pluie. Vieillie, la mère ne reconnaît plus
personne, même pas ses enfants, elle vit un cauchemar éveillé,
insondable comme un puits sans fond, et perd en même temps
l’usage de la parole. Et quand Sin, après son enterrement, tente
de retrouver les lieux de son enfance, retrouver aussi le sens
de ses dernières paroles, la réalité finit de se dissoudre dans
le paysage rongé par l’humidité, mais est-ce bien la réalité ?
Après la pluie, l’herbe repousse, dit l’auteur, mais elle
repousse en recouvrant irrémédiablement le passé. Restent les
rêves.
« Les rêves que l’on fait, on a parfois l'impression que c’est
la réalité. Je m’y perds souvent moi aussi. » Et Ng Kin Chew
nous perd magistralement avec lui.
On
retrouve là l’un des thèmes du « Balloon »
(《气球》)
de
Pema Tseden,
la réalité des marges tibétaines rejoignant dans les
mêmes croyances celle des marges malaisiennes.
On
est d’ailleurs invité à faire ce parallèle : le texte
« Retour » commence par une citation d’un « Conte du
Liaozhai » de Pu Songling : « La Secte du Lotus blanc »
(《聊斋志异·卷九.白莲教》).
|
|

