|
|
Gao Xingjian
高行健
Présentation 介绍
par Brigitte Duzan, 11 juillet
2010
|

Gao Xingjian 高行健 |
|
Ecrivain,
traducteur, critique, dramaturge, metteur en scène,
scénariste, réalisateur ou peintre selon l’exigence du
moment, chinois de naissance mais français d’adoption et
rejetant tout attachement réducteur à une quelconque
patrie ou doctrine, Gao Xingjian semble avoir fait
sienne la fameuse devise de Terence : humani nihil a
me alieno puto, rien de ce qui est humain ne m’est
étranger.
Longtemps prisé
par un petit cénacle de traducteurs et exégètes, mais
largement inconnu du public, Gao Xingjian devint
brusquement, un beau jour d’octobre 2000, l’écrivain
« chinois » dont plus personne ne pouvait ignorer ni le
nom ni l’œuvre, par la grâce d’un prix qui arrivait là
où on ne
l’attendait
pas : le Nobel de littérature. La planète littéraire
vibra sous le choc, le gouvernement chinois sous
l’affront, et la politisation de l’affaire fut
déterminante pour |
la notoriété d’un auteur
qui se veut pourtant résolument apolitique et dont l’œuvre
serait autrement restée peu ou prou confidentielle malgré le
travail promotionnel du cénacle ci-dessus mentionné.
|
1. Chine : traducteur, essayiste et dramaturge
Gao Xingjian
n’avait pourtant rien au départ qui pût le différencier
beaucoup des Chinois de sa génération, et des écrivains
en particulier : né en 1940, il a été marqué par tous
les épisodes dramatiques de la période maoïste qu’il a
vécus comme un cauchemar.
Enfance
heureuse
Il est né à
Ganzhou, préfecture de la province du Jiangxi (江西赣州),
dans le
sud-est de la Chine, région qui, dans la Chine ancienne,
était en dehors de la sphère culturelle de la
civilisation chinoise naissante, rattaché à la
civilisation des peuples Yue (越) ;
c’est certainement, bien qu’on n’en parle guère et que
lui-même affiche un mépris délibéré et
|
|
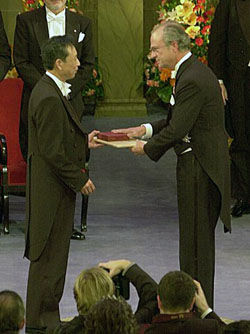
Remise du prix Nobel |
appuyé pour le ‘pays natal’,
un des facteurs qui explique l’intérêt de Gao Xingjian pour les
cultures dites minoritaires en Chine, intérêt que l’on retrouve
au centre de son roman le plus connu, « La montagne de l’âme » (《灵山》).
Son enfance s’est
déroulée pendant la période chaotique de la guerre de résistance
contre le Japon ; il avait deux ans lors de la terrible campagne
Zhejiang-Jiangxi qui laissa la région dévastée et des centaines
de milliers de victimes dans la population civile. Ce n’était
qu’un début.
Son père était employé
de banque et sa mère comédienne amateur, avant de se marier.
Elle mourut très tôt dans des circonstances, accident ou
suicide, restées inexpliquées, mais a eu une influence
déterminante sur la formation de la personnalité de son fils,
lui inculquant sa passion du théâtre et de la littérature, comme
il l’explique au tout début de ses « dialogues sur l’écriture »
avec Denis Bourgeois (1):
« J’étais un enfant
maladif. Les temps étaient très bouleversés, en Chine, à cette
époque. Je n’allais pas à l’école. C’est ma mère qui m’a appris
à lire. Je m’enfermais dans une petite chambre. Je pouvais y
rester toute la journée. Je m’y inventais des histoires, je
peignais aussi, pour moi-même, pour me faire plaisir. »
Il dessinait, écrivait
des histoires, des contes pour enfants, et jouait aussi de la
musique, du violon et des instruments traditionnels chinois. Il
a gardé cet amour de la musique, et, quelque part, ses habitudes
d’enfant : il a raconté qu’il peint et écrit ses premiers
brouillons enfermé, en écoutant de la musique, pour faire le
vide en lui.
|
Il avait neuf
ans lorsque fut fondé la République populaire, et, en
1950, la famille alla s’installer à Nankin. Il entra en
1952 au lycée n° 10, où il put lire énormément de livres
occidentaux traduits en chinois, tout en suivant des
cours de peinture et de sculpture. Il en garde le
souvenir d’une période de rêve. Puis, en 1957, plutôt
que l’Institut national des Beaux-Arts (中央美术学院),
il choisit d’entrer à
l’Université
des Langues étrangères de Pékin (北京外国语大学Běijīng
Wàiguóyǔ Dàxué
ou
北外Běiwài
) (2)
pour y étudier le français et la littérature. Diplômé en
1962, il commença à travailler comme traducteur.
Ecrire pour
survivre
|
|

peinture "le regard" |
En même temps,
cependant, il commença à écrire en secret, des essais, des
pièces de théâtre et des nouvelles. Au début de la Révolution
culturelle, en 1966, il a dit avoir été, au départ, enthousiasmé
par les discours de Mao Zedong, et s’est enrôlé dans un groupe
de Gardes rouges :
« Au début de la
Révolution culturelle, j’ai été garde rouge, j’ai participé à
l’organisation d’un groupe rebelle, contre un groupe soutenu par
le Parti, j’en ai même été un chef. Ensuite, au sein de la
direction, quand j’ai vu ce qu’il en était vraiment, à savoir la
lutte totale pour la prise du pouvoir d’une fraction contre une
autre, je me suis retiré. »
(3)
Il lui en restera un
sentiment de culpabilité qui lui fera enfouir ses souvenirs au
plus profond de lui-même, la mémoire étant désormais interdite
parce que trop douloureuse. C’est cette expérience qui sous-tend
son deuxième roman, « Le livre d’un homme seul » (《一个人的圣经》).
En 1970, il fut
finalement envoyé « en rééducation » à la campagne, dans
l’Anhui, et c’est là, après avoir prudemment brûlé ce qu’il
avait écrit jusque là, qu’il devint véritablement écrivain,
l’écriture se faisant nécessité vitale, pour survivre plus
encore que pour témoigner. C’était une véritable création,
au-delà de l’imaginaire. Mais c’était aussi dangereux : il
cachait ce qu’il écrivait dans des pots remplis de choux qu’il
enterrait ensuite, les sols des maisons étant en terre battue ;
après avoir rebouché, il occultait le tout avec une de ces
lourdes jarres qui servaient de réserves d’eau dans ces zones
sans eau courante.
C’était pour lui une
façon de supporter son existence. Il pensait qu’il finirait sa
vie travailleur agricole,
l’écriture devenait une
fuite, et un refuge. Des années plus tard, dans son discours
prononcé devant
l’Académie suédoise,
qu’il intitula « La raison d’être de la littérature », il revint
sur ce rôle de la littérature, loin des idéologies et des
missions sociales. Dans tous les pays et dans tous les temps,
dit-il, un écrivain qui voulait préserver sa liberté de penser
sans se condamner au silence n’avait qu’un choix : la fuite. Or,
dans la Chine de Mao, même la fuite était impossible, sauf,
justement, dans l’écriture, mais au prix d’un risque mortel. Il
s’agissait de se parler à soi-même, pour se sentir vivant.
Il fut renvoyé en 1975
à Pékin, pour travailler, comme traducteur encore, dans une
revue mensuelle qui s’appelait alors « China reconstructs » (中国建设),
et qui était publiée dans un grand nombre de langues pour vanter
les réussites du socialisme en Chine (4).
Dramaturge
d’avant-garde
|
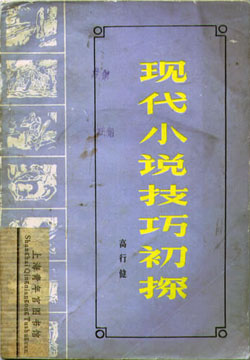
« Premier essai sur
l’art du roman moderne » (《现代小说技巧初探》) |
|
C’est surtout
après la liquidation de la Bande des Quatre que
l’atmosphère commença à se détendre.
En 1977, il
fut transféré au Comité des relations internationales de
l’Association
des Ecrivains chinois (中国作家协会对外联络委员会).
C’est
ainsi que, en mai 1979, il se rendit pour la première
fois à Paris, avec un groupe d’écrivains, dont Ba Jin (巴金),
comme traducteur et interprète du groupe. De retour à
Pékin, il publia un texte inspiré de cette expérience:
« Ba Jin à Paris » (《巴金在巴黎》).
C’est en effet
cette année 1979 qu’il commence à publier ses premiers
textes, essais et nouvelles, dans des magazines
littéraires. En 1980, il devient dramaturge et
scénariste attitré du Théâtre d’Art populaire de Pékin (北京人民艺术剧院),
poste qu’il occupera jusqu’en 1987. C’est pour lui une
période extrêmement féconde. Il commence par publier, en
1981, un essai intitulé « Premier essai sur l’art du
roman moderne » (《现代小说技巧初探》)
qui
|
déclenche aussitôt une violente
polémique, sur la signification et les implications des notions
de « modernisme » et de « réalisme » ; mettant en cause le
« réalisme socialiste », il devient la cible des cercles
conservateurs.
En même temps, il écrit
des pièces de théâtre influencées par des modèles occidentaux,
et en particulier le ‘théâtre de l’absurde’, surtout Beckett et
Ionesco dont il avait lui-même traduit des œuvres, mais aussi
Brecht, Artaud ou Kantor. Mais c’est aussi un théâtre renouant
avec les traditions
ancestrales du jeu de
masques ou du jeu d’ombres et avec certains effets scéniques de
l’opéra chinois.
|
En 1982, sa
pièce « Signal
d’alarme » (《绝对信号》)
est un succès ; elle marque le début du théâtre
expérimental en Chine, et, faisant de lui un auteur
d’avant-garde, suscite une nouvelle polémique. Mais
c’est avec la pièce suivante, « L’arrêt de bus » (《车站》),
mise en scène l’année
suivante avec une pièce de Lu Xun, que les choses se
gâtent. La
pièce dépeint
les sentiments, pensées et attitudes |
|
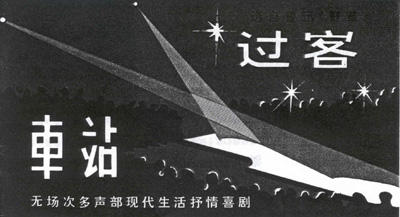
« L’arrêt de bus »
(《车站》) |
de sept
personnages, désignés simplement par leur rôle dans la société,
qui attendent un bus à un arrêt comme on attend Godot, ayant
chacun une raison pour aller en ville ; les bus passent sans
s’arrêter, et, dix ans plus tard, ils sont toujours là. La pièce
fut critiquée dans le cadre du mouvement de lutte contre la
« pollution intellectuelle » qui débuta pratiquement au même
moment, sans doute pour l’impression d’impuissance et
d’absurdité donnée par des personnages laissés en plan sur le
bord de la route et incapables d’aller nulle part ; les futures
représentations furent interdites.
Dramaturge interdit
En même temps, Gao
Xingjian publie des nouvelles, ainsi qu’une série d’articles sur
ses conceptions du théâtre et de la littérature dans la presse
spécialisée. Mais les attaques contre lui se multiplient. On lui
diagnostique en outre un cancer au poumon et, lorsque les
analyses montrent que le diagnostic est erroné, il apprend qu’il
risque d’être arrêté et envoyé dans un camp au Qinghai.
Il décide alors de
quitter Pékin et part faire un long périple de dix mois dans le
sud du pays : ce voyage va lui fournir la majeure partie,
autobiographique, de son roman « La montagne de l’âme »,
commencé en 1982. Il débute dans les forêts du Sichuan, et
continue le long du Yangzi, jusqu’à la côte, visitant au passage
des districts de minorités Qiang, Miao et Yi, sur les franges de
la civilisation chinoise dominante, avec des arrêts dans des
temples bouddhistes et taoïstes qui fournissent de leur côté un
contrepoint au confucianisme. Il s’agit essentiellement d’une
quête intérieure, de paix et de liberté, à replacer dans le
contexte politique de l’époque.
De retour à Pékin, il
écrit encore deux pièces. La première, « L’homme sauvage » (《野人》),
mise en scène en 1985, semble directement inspirée de son
voyage ; elle dépeint en effet un écologiste et un journaliste
qui partent dans des contrées sauvages de la Chine à la
recherche d’un mythique ‘homme sauvage’ mi-humain, mi-singe ;
elle est constituée de scènes dialoguées alternant avec des
épisodes de chant, danse et musique traditionnels chinois. Quant
à la seconde, « L’autre rive » (《彼岸》),
à nouveau annoncée comme du ‘théâtre expérimental’ (实验剧作),
ses répétitions sont interrompues et elle est interdite avant
même la première représentation : le titre évoquant
l’illumination bouddhiste, cette ‘autre rive’ que chacun rêve
d’atteindre, elle met en scène trois personnages, toujours
anonymes, qui entrent en un conflit symbolique sur les notions
de valeurs individuelles et collectives, et qui, ayant traversé
pour rejoindre ‘l’autre rive’, se rendent compte qu’elle
n’existe pas.
C’est la dernière pièce
signée Gao Xingjian à être représentée en Chine continentale.
Convaincu dès lors qu’il va être réduit au silence, il est
décidé à partir. En 1987, il est invité à Fribourg par le Morat
Institut for Künst und Wissenschaft, et de là, en 1988, il passe
en France à l’invitation de la direction régionale d’aide à la
création. Au lendemain des événements de la place Tian’anmen, en
juin 1989, il dénonce à la presse les actions des autorités
chinoises, rend sa carte du Parti, et demande l’asile politique
en France.
Début 1990, il publie
dans « Jintian » (《今天》)
une pièce intitulée « La fuite » (《逃亡》)
qui, traduite
par Goran Malmqvist, est représentée à Stockholm. Elle dépeint
trois personnages réfugiés dans un entrepôt désaffecté, aux
dernières heures de la nuit, alors que l’on entend au loin le
grondement des tanks et des rafales de tirs ; c’est un huis clos
où la tension à fleur de peau, la perte des espérances aussi,
déclenchent l’agressivité, le désir, l’introspection (5). La
pièce entraîne l’interdiction totale des œuvres de Gao Xingjian
en Chine. La police saisit son appartement de Pékin, il est
déclaré persona non grata. Les ponts sont définitivement coupés.
Installe à Bagnolet,
dans la banlieue parisienne, il n’en bougera plus, peignant pour
gagner sa vie, et pouvoir continuer à écrire, librement. Ou
plutôt, plus généralement, à créer, car la liberté, justement,
semble lui donner des ailes : il élargit alors son champ de
réflexion et de création à une infinité de domaines qui en font
un artiste complexe, inclassable.
|
2. Exil : artiste aux multiples facettes
En 1990, il
achève son roman « La montagne de
l’âme » (《灵山》),
après sept ans de travail ; il est publié à Taiwan,
traduit en suédois et publié en Suède deux ans plus tard
, puis traduit en français et publié en France en 1995.
La montagne de l’âme
C’est une sorte
de roman initiatique, une quête mystique, un pèlerinage
aux sources où le personnage principal fait un voyage à
la rencontre de lui-même, un tissu de récits où ce
personnage principal, désigné par trois pronoms
personnels différents, est éclaté en diverses facettes
de son moi qui sont le miroir l’une de l’autre. L’usage
libre des pronoms personnels, dérivé des recherches en
matière théâtrale de Gao Xingjian, permet de rapides
changements de perspective où se brouillent l’imaginaire
et le souvenir, la fiction et le réel. |
|
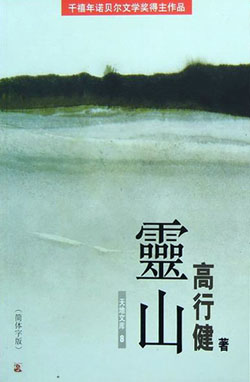
« La montagne de l’âme »
(《灵山》) |
C’est le récit d’une
double fuite, de deux voyages parallèles construits à partir des
souvenirs et impressions laissés par le voyage de l’auteur dans
le sud de la Chine en 1983 : le voyage de « tu » et celui de
« je ». Le premier est un citadin rongé par la nostalgie du
passé et le désir de reconstruire son existence, et parti à la
recherche de cette « montagne de l’âme » dont il a entendu
parler dans un train. « Je » est son autre visage, qui ressemble
comme une goutte d’eau à l’auteur : « écrivain qui ne peut
publier » bouleversé par un faux diagnostic qui l’a poussé à
questionner le sens de son existence, et désormais en quête
d’une « vie authentique » ; il va, un peu au hasard, de
rencontre en rencontre, de récit en récit…
|
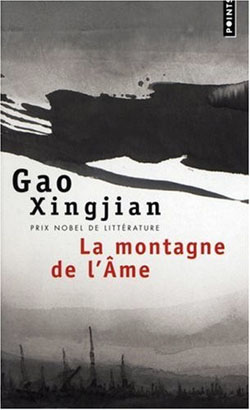
« La montagne de l’âme »
(《灵山》) |
|
Gao Xingjian
reprend ici des concepts taoïstes, et en particulier la
recherche de la sagesse par exploration des paradoxes et
ambiguïtés de la vérité. Il n’est pas anodin que le
voyage se passe en grande partie au Sichuan, ancien pays
de Chu (楚) qui, dès la dynastie
des Zhou, au onzième siècle avant Jésus-Christ, fut une
zone à part, une civilisation différente de celle du
Nord, avec des traditions chamaniques et taoïstes
restées vivaces même après
l’absorption
dans l’empire, utilisant même une écriture différente.
Evidemment, la
montagne de l’âme n’existe pas plus que
l’autre rive,
mais l’important est dans la recherche, qui est
d’abord pour
Gao Xingjian une recherche sur la langue et une
recherche sur la forme. La première, qui rejoint
des préoccupations très actuelles, part de la nécessité
de revivifier la langue par apport d’éléments de la
langue parlée, sa référence explicite étant les
romanciers de la période Ming, et en particulier Feng
Menglong (冯梦龙),
comme spécialiste du récit court en langue vernaculaire.
|
Mais il a reconnu une
autre influence, celle de Georges Pérec, le Pérec de « L’homme
qui dort » qui lui aurait inspiré l’utilisation du « tu » (« Tu
te promènes encore parfois. Tu refais les mêmes chemins. Tu
traverses des champs labourés …»), Marguerite Duras lui ayant
inspiré, quant à elle, le « elle dit », « tu dis » qui lui sont
propres… On a ainsi une mosaïque d’influences qui peinent à se
fondre en un tout cohérent, au moins dans le texte original, car
la traduction permet beaucoup mieux l’identification avec le
modèle.
En fait, Gao Xingjian a
expliqué qu’il se laisse guider par les mots, et les mots
prononcés à haute voix, car il « écrit » en dictant ses textes
qu’il enregistre au magnétophone, il a ainsi qualifié son style
de « courant de langage » (语言流),
plus que de « courant de conscience » (意识流),
allant au-delà du monologue intérieur qui le caractérise.
Le second axe de
recherche, sur la forme, qui est lié au premier, part du refus
nécessaire de la fiction classique, comme il l’a déclaré à Denis
Bourgeois :
« L’ère ouverte par Kafka et Pessoa est une ère du sujet morcelé, en
lambeaux. Celle d’une écriture éclatée à tous les niveaux. Des
lambeaux avec lesquels on a tissé un nouveau rapport à
l’écriture. »
L’écriture recompose la
mémoire, mais au travers de récits éclatés.
La narration n’est pas
seulement éclatée entre un « tu » et un « je », doublés d’un
« il » observé à distance, mais chacune des facettes du
personnage prend la parole en alternance : au « tu » sont
alloués les chapitres impairs 1 à 31, puis pairs 32 à 80, le
« je » apparaissant dans les chapitres correspondants pairs,
puis impairs, le chapitre 52 expliquant inopinément que « tu »
est la création
fictive du « je » dans
la fiction narrative. Ils sont en outre complétés par un
« elle » qui représente
l’ensemble des femmes
qui hantent la vie du personnage principal, objet de tourments
nés des contraintes liées aux conventions sociales et règles
morales. (6)
En outre, tous les
genres de la littérature chinoise sont abordés et utilisés, en
vrac et dans le désordre, y compris des bribes de poèmes, une
sorte d’interview, des chants populaires, des passages
philosophiques, des parodies d’essais linguistiques et des
extraits d’annales historiques, le tout accentuant l’impression
de désagrégation de la narration, ce qui est d’ailleurs le but
avoué : substituer le « mouvement continu de la création » au
fil narratif classique.
La fin donne par
ailleurs l’impression d’un devoir terminé à la hâte : le roman
s’achève brusquement, de façon symbolique au chapitre 81, comme
le livre de Laozi, « le Livre de la voie et de la vertu » (《道德经》),
et il se termine par cette phrase :
« En réalité, je ne comprends rien, strictement rien. C’est comme ça. »
En fait, Gao Xingjian
pensait au départ écrire un livre deux ou trois fois plus long,
un « grand roman asiatique ». Mais son exil temporaire étant
devenu définitif après les événements de Tian’anmen, c’est toute
son existence qui s’en est trouvée remise en cause, ainsi que
ses buts artistiques. La fin de « La montagne de l’âme » est
l’aveu du total désarroi de son auteur, et la marque d’une œuvre
inachevée, gardant les stigmates de l’expérimentation.
Celle-ci fut ensuite
poursuivie avec « Le livre d’un homme seul » (《一个人的圣经》),
écrit entre
1996 et 1998.
Le livre
d’un homme seul
|
Le livre est
une sorte d’exorcisme, tentant de rendre la vision qu’a
gardée l’auteur de la Révolution culturelle à travers
son triple rôle
d’activiste
politique, de victime et d’observateur, pour s’efforcer
d’en finir avec
un terrible sentiment de culpabilité qui lui a fait
jusqu’ici
refuser le souvenir même de cette période. Il s’en sort
avec une autre position de refus, refus du modèle moral
du dissident, de la responsabilité politique, du devoir
de sauver l’autre : « Tu as écrit ce livre pour toi, un
livre sur la fuite, le Livre d'un homme seul, tu es à la
fois ton Seigneur et ton apôtre, tu ne te sacrifies pas
pour les autres et tu ne demandes pas qu'on se sacrifie
pour toi… »
Gao Xingjian
reprend le procédé d’écriture utilisant les pronoms
personnels expérimenté dans son roman précédent, mais le
« je » a ici disparu, symbole de la suppression de
l’identité personnelle, de
l’individu,
dans la Chine de Mao dont il fait resurgir les souvenirs
enfouis. Restent le « tu » du présent, hors de Chine, et
|
|
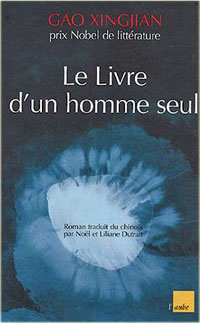
« Le livre d’un homme
seul »
(《一个人的圣经》) |
le « il » du passé, de la
Révolution culturelle, représentant deux mémoires, l’une réelle,
l’autre imaginaire qui invite le « tu » du présent à rêver. Le
jeu resserré des pronoms renforce ici la cohérence du texte.
« Tu » s’efforce de
reconstituer sa mémoire, et de revivre, finalement, par
l’écriture, mais il faut la médiation d’une femme – donc un duo
« tu – elle » - pour l’inciter à surmonter la douleur du
souvenir, et le rejet de la mémoire qui en découle : « Tu veux
fuir la mémoire pour rester le plus longtemps au présent » et
jouir de ce moment présent. Mais le retour sur le passé permet
de rejeter clairement la politique comme entreprise collective,
et finalement de se libérer de tout engagement, et surtout de
toute responsabilité vis-à-vis de
l’histoire.
L’exil, qui était
fuite, devient distanciation pour mieux saisir l’histoire vécue,
renforçant le besoin de retrouver un moi individuel, et
marginal, face à l’engagement utopique et collectif du passé.
Mais c’est un projet personnel, un discours privé ; il s’agit
d’une écriture individuelle, et non consensuelle ou fusionnelle
comme l’écriture romanesque ordinaire qui se cherche un
auditoire : ce que Gao Xingjian a appelé « la littérature
froide ». Il ne concède à l’écrivain d’autre responsabilité que
celle vis-à-vis de la langue.
«
L’auteur n’est pas la conscience de la société et la littérature
est encore moins le reflet de cette société. Elle n’est que
fuite vers les bans de la société. Celui qui se met à l’écart
peut observer en gardant la tête froide. Il ne rend de compte
qu’à lui-même : son regard transcende sa propre personne et il
peut exprimer ce qu’il observe... »
L’exil opère ainsi une
libération, et cette libération stimule la créativité.
Dans un article intitulé
« L’écriture en exil » (7), Gao écrivait en 2000 : « en ce qui
me concerne, l’exil, plus que la nostalgie, fut une sorte de
renaissance de ma créativité. »
Un bouillonnement
créatif
Effectivement, à partir
de 1990, on voit Gao Xingjian multiplier les créations dans tous
les domaines. Il peint, surtout, semble-t-il, parce que ses
peintures, à l’encre de Chine, sont prisées et se vendent bien.
Mais elles viennent aussi illustrer les couvertures de ses
livres, et servir de décors lors des représentations des pièces
de théâtre qu’il continue d’écrire.
|
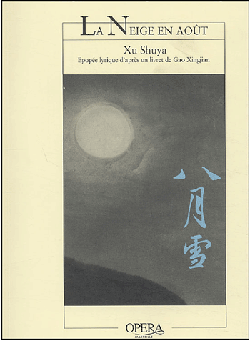
son opéra « Neige en
août » (《八月雪》) |
|
Il aborde
également le cinéma et l’opéra. Dans le cadre de
Marseille 2003, l'Année Gao, il devait présenter à la
fois une pièce de théâtre, « Le quêteur de la mort »,
des peintures, son opéra « Neige en août » (《八月雪》),
qui avait été créé à Taiwan l’année précédente, et son
premier film,
« La
silhouette, sinon l’ombre » (ou « Silhouette/Shadow »),
un film « total », sorte de cinéma-poème où Gao Xingjian
expérimentait à nouveau.
Cette frénésie
créative eut des conséquences dramatiques sur sa santé.
En fait, dès les lendemains de la remise du prix Nobel,
il continua ses projets tout en assumant interviews et
engagements sociaux. C’est alors qu’il était à Taipei
pour diriger les répétitions de son opéra qu’il fut
hospitalisé une première fois ; il se remit à temps pour
diriger la représentation de sa pièce « Quatre quatuors
pour un
week-end » à la Comédie française, mais |
dut ensuite subir une opération
importante en février/mars 2003.
Ce n’est donc qu’en
2005 que l’opéra fut créé à l’opéra de Marseille, et le film fut
terminé en 2006. Il en a depuis lors réalisé un second, un court
métrage sur la base de certains de ses tableaux, un
« film-tableau » intitulé « Après le déluge » qui a récemment
été projeté au festival de Vernon (8).
C’est peut-être ce
bouillonnement créatif qui est le plus intéressant chez Gao
Xingjian, car l’écriture déborde ainsi de ses cadres habituels.
A la fin de sa
conférence sur « La montagne de l’âme » (voir note 6), il
déclarait :
« 如果论家不认为是小说,不是就是了。 »
« Si les
critiques pensent que ce n’est pas un roman, eh bien ce n’en est
pas un, tant pis. »
Il a depuis lors
largement dépassé ces critiques, car tout ce qu’il fait est
inclassable. On peut aimer ses œuvres ou ne pas les aimer, on ne
peut pas les ignorer. Et si l’on se donne la peine de creuser un
peu, on finira toujours par trouver la pépite qui correspond à
ses goûts et à sa sensibilité.
Il est sans doute, non
vraiment un pont entre l’Orient et l’Occident comme on le dit
souvent, mais plutôt un de ces créateurs hybrides et
intemporels, nés du mélange actuel des cultures, pour lesquels,
justement, l’Orient et l’Occident finissent par devenir des
concepts obsolètes, tout comme le concept étroit de littérature.
Notes
(1) Entretiens réalisés
entre 1994 et 1997, et publiés sous le titre « Au plus près du
réel » (éditions de
l’Aube, 1997, repris en
collection de poche en 2001 avec le discours prononcé le 7
décembre 2000 devant l’académie suédoise : « La raison d’être de
la littérature »)
(2) Egalement connue
sous l’appellation anglaise de Beijing Foreign Studies
University (BFSU).
(3) « Au plus près du
réel »
(4)
La revue, créée en
1949, fut rebaptisée « China today »
(今日中国)
en 1990.
(5) Texte de la pièce :
http://books.google.fr/books?id=KrcI0z7tnoIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
(6) Il a expliqué
lui-même les bases de ces recherches dans une longue conférence
donnée à Stockholm en 1991 et publiée ensuite dans « Jintian »
en 1992, « Littérature et métaphysique : à propos de ‘La
montagne de l’âme’ » (文学与玄学·关于《灵山》)
Texte entier :
http://book.kanunu.org/html/2005/0625/130.html
(7)
in « Où va la Chine ? », éditions du
Félin, février 2000.
(8) Pour
« Silhouette/Shadow », voir l’analyse en profondeur de sa
traductrice
Mabel Lee :
http://mclc.osu.edu/rc/pubs/lee.htm
Pour l’opéra, voir la
présentation par le traducteur français Noêl Dutrait (in
Perspectives chinoises 75/2003)
http://perspectiveschinoises.revues.org/60
Ainsi qu’un extrait de
la mise en scène du Théâtre national de Taipei :
Acte 1 scène 3
http://www.youtube.com/watch?v=Lo0fKwOWiN8
Principales
publications en France :
1. Aux éditions de
l’Aube
Romans et nouvelles
(traduits par Noël et Liliane Dutrait)
1995 La Montagne de
l’âme (《灵山》)
1997 Une canne à pêche
pour mon grand-père
(nouvelles) (《给我老爷买鱼竿》)
2000 Le Livre d’un
homme seul (《一个人的圣经》)
Essais
1997 Au plus près du
réel, dialogues avec Denis Bourgeois
2000 La raison d’être
de la littérature
2. Chez d’autres
éditeurs :
Théâtre
Aux éditions
Lansman :
1992 La fuite
1993 Au bord de la vie
1995 Le somnambule
1999 Quatre quatuors
pour un week-end
2000 Gao Xingjian,
théâtre I
Aux éditions MEET, Arcane 17
1994 Dialoguer,
Interloquer
Notes sur les
nouvelles
Les nouvelles de Gao
Xingjian datent des années avant 1987 et son départ de Chine.
Ses deux premières œuvres publiées furent deux romans, le
premier dès 1979, alors qu’il était traducteur pour le Comité
des relations internationales de l’Association des Ecrivains :
《寒夜的星辰》
(Etoiles dans la nuit
glacée).
A partir de 1981, il
publia ensuite toute une série de nouvelles, plusieurs chaque
année, jusqu’en 1991.
1981
《朋友》
Ami
《雨,雪,及其它他》
Pluie, neige et autres
1982
《路上》
Sur la route
《海上》
Sur la mer
1982
《二十五年后》
Vingt cinq ans plus tard
1983
《花环》
La couronne de fleurs
《母亲》
Mère
《河那边》
De ce côté-ci du fleuve
《鞋匠和他的女儿》
Le cordonnier
et sa fille
1984
《花豆》
Huadou
(scénario publié en 1985)
1985
《侮辱》
Insultes
《公园里》
Dans un parc *
《车祸》
L’accident *
《无题》
Sans titre
1986
《给我老爷买鱼竿》
Une canne à
pêche pour mon grand-père *
1989
recueil de nouvelles publié à Taiwan comprenant les précédentes
plus trois inédites :
《你一定要活着》
Tu veux vivre
absolument
《圆恩寺》
Le temple *
《抽筋》
La crampe *
1991
《瞬间》
Instantanés *
* Nouvelles publiées
dans le recueil paru aux éditions de l’Aube sous le titre « Une
canne à pêche pour mon grand-père »
|
Certaines de
ces nouvelles furent écrites en vue de la réalisation de
films, et adaptées en scénarios, mais les films n’ont
ensuite jamais été réalisés. Le premier cas fut celui de
« Huadou » (《花豆》),
d’abord écrit comme scénario de film, en 1982, puis
publié comme nouvelle ensuite en 1984. Il avait dès ce
moment-là établi les principes de base des films qu’il
voulait faire.
Ce fut
également le cas de « Une canne à pêche pour mon
grand-père » (《给我老爷买鱼竿》)
qui fut son second scénario. La nouvelle contient un
certain nombre d’éléments sonores (en particulier la
retransmission du match de football qui marque le retour
progressif à la réalité du personnage principal qui
vient de rêver tout éveillé à son grand-père et à des
scènes de son enfance), éléments sonores qui devaient
faire partie de la bande-son.
Le troisième
cas est « Instantanés » (《瞬间》),
qui est une suite de brefs tableaux apparemment sans
liens entre eux ; le texte fut écrit |
|
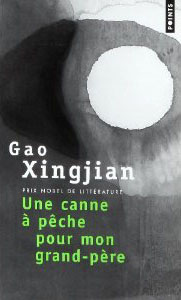
« Une canne à pêche pour
mon grand-père »
(《给我老爷买鱼竿》) |
en 1987 à la demande d’un
producteur français, mais qui fut très déçu en voyant le
« scénario » de Gao Xingjian, car il voulait quelque chose de
chinois propre à flatter le goût de l’exotisme du public
français ! Le texte fut donc publié sous forme de nouvelle en
1991.
Enfin, il écrivit une
dernière nouvelle,
《冥城》la
ville sombre, qu’il proposa comme base de livret d’opéra à
Taipei, mais le caractère
冥míng,
évoquant les
puissances infernales, fut jugé inapproprié ; plutôt que de
changer son titre, Gao Xingjian changea d’idée, et ce fut le
début du projet d’opéra « Neige en août ».
|
|

