|
|
Quelques réflexions
sur la traduction littéraire
De la théorie à la
pratique
par
Brigitte Duzan, 6 novembre 2017
Traduire est une activité empirique qui ne peut éviter la
théorie et nécessite une réflexion, tout particulièrement dans
le cas de la traduction littéraire.
Quelques idées, et quelques questions
|
Partons de quelques idées qui fondent la pensée
du traduire selon Henri Meschonnic
,
et qui permettent de poser quelques questions de
base sur la traduction et sa pratique.
1. L’Europe est née de la traduction (« La
langue de l’Europe, c’est la traduction » a dit
Umberto Eco). La traduction reste aujourd’hui
fondamentale comme moyen de contact entre
cultures, à un moment où l’intensification des
relations internationales entraîne des effets
qui, au-delà des aspects commerciaux et
politiques, posent la question de la définition
de l’identité.
Nous sommes à un moment de l’histoire où
l’universalisation est en train de se
fragmenter, faisant place à la reconnaissance
de l’altérité, de l’autre dans sa
différence, qui passe par la pluralisation
des rapports interculturels.
2. En même temps, l’histoire du traduire
est celle d’une |
|
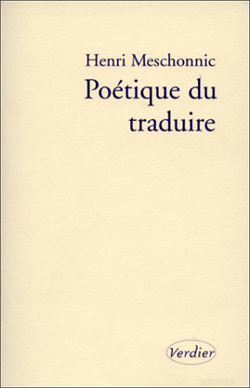 |
tendance croissante à la valorisation du texte, à
l’opposé des origines, en Europe, où la traduction
a d’abord été celle des grands textes sacrés, la forme
extrême du sacré étant l’impossibilité de traduire : le
texte est à rendre, religieusement, mot pour mot.
3. Cette effort de valorisation du texte littéraire entraîne des
conséquences quant à la pratique courante de la traduction. Mais
celle-ci vise à rechercher la fidélité au texte par
l’effacement du traducteur devant le texte. Ce qui implique un
objectif de transparence, visant à faire oublier qu’il s’agit
d’une traduction, par l’illusion du naturel.
Concept de fidélité aujourd’hui remis en cause, et nécessitant
d’être redéfini, pour mieux servir le texte.
De la transparence à l’altérité, de la langue à la littérature
1.
Altérité contre universel
|
a/ La notion de fidélité au texte ne peut plus
se concevoir en termes d’équivalence de langue à
langue, mais doit se poser de texte à texte,
en visant à faire ressortir la différence,
et non à la camoufler. L’idéal est l’altérité et
la pluralité, perçues en termes linguistiques,
culturels et historiques.
« Passeur est une métaphore complaisante. Ce
qui importe n’est pas de faire passer, mais dans
quel état arrive ce qu’on a transporté de
l’autre côté. Dans l’autre langue. Charon aussi
est un passeur. Mais il passe des morts. Qui ont
perdu la mémoire. » (Meschonnic, Poétique du
traduire, p. 17).
b/ On
rejoint icil’idée phare de Barbara Cassin : il
faut « compliquer l’universel », contre
la « pathologie de l’universel » être plutôt
barbare, et « inquiéter le lecteur »
. La
traduction doit faire sentir la force,
l’intelligence de la différence des langues, le
« plus d’une langue » de Derrida (définissant sa
méthode en philosophie) devenant condition
fondamentale de l’homme contre le logos
grec universalisant qui exclut le barbare.
c/ D’où s’ensuit sa thèse « des
intraduisibles comme méthode » : définis
dans le domaine – toujours – du religieux, mais
aussi de la psychanalyse, les intraduisibles
selon Cassin tiennent, dans la traduction
littéraire au quotidien, non tant du passage
d’une langue à une autre, que d’une culture à
une autre. La « méthode » consiste à laisser
tout passage problématique dans un entre-deux
favorisant le déploiement du sens,
l’intraduisible étant alors « du domaine de
la note en bas de page ».
Notes en bas de page à ne pas s’interdire donc,
tout en les limitant à un paratexte explicatif
qui doit rester concis : aide à la lecture et
non gêne à la lecture. |
|
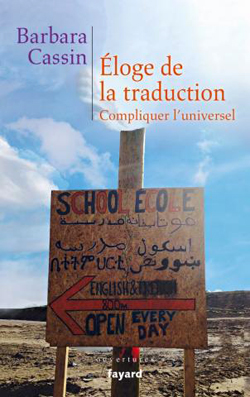
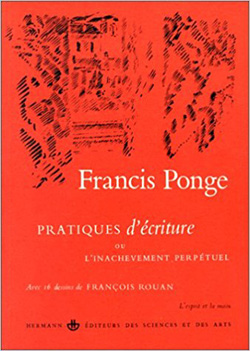 |
2.
Acte de langage et écriture
|
a/
Plus généralement, il faut considérer la
traduction comme un acte de langage à
part entière. Aucune traduction ne peut ni ne
doit se faire passer pour l’original, en tentant
de le faire oublier. C’est ce que Meschonnic
appelle « la traduction effaçante » qui perpétue
le mythe de Babel et son horreur de la diversité
des langues. Devenant acte de langage, la
traduction est aussi écriture, donc
littérature. Ecriture que Francis Ponge
définissait comme « inachèvement perpétuel »
.
Qui est bien le propre, aussi, de la traduction.
On ne
peut traduire la poésie que si l’on est poète, a
dit Estienne Dolet
,
ce qui pose la traduction en termes d’affinité.
Les grandes traductions sont de la grande
littérature. Si l’on cite et lit encore « Les
mille et une nuits » d’Antoine Galland
(1704-1717), c’est que sa traduction a gardé le
charme de l’original, bien que participant des
« belles infidèles » de l’époque.
b/ La solution n’est donc pas dans l’effacement
du traducteur, idée sacro-sainte véhiculée
depuis Saint-Jérôme et reprise encore par Valéry
Larbaud évoquant, dans son « Invocation de
Saint-Jérôme », justement, un traducteur modeste
et effacé pour être plus fidèle, et participant
ainsi de la beauté de l’original. Or, il ne
suffit pas de la disparition du traducteur dans
sa traduction pour bien traduire. Il faut
recréer le texte, par une invention réciproque
du texte et du traducteur comme auteur/sujet.
c/ La distinction traditionnelle
sourciers-ciblistes est donc à dépasser : les
sourciers tournés vers la langue de départ
et soucieux de la forme, les ciblistes
ne regardant que la langue d’arrivée en ne
pensant qu’à préserver le sens. Dualité
forme-sens qui n’est autre que celle entre
signifiant et signifié, division du signe. Or le
sens ne vient jamais seul. L’unité fondamentale
est celle du discours, et de l’ordre du
continu. Donc du rythme en tant
qu’organisation du continu. |
|
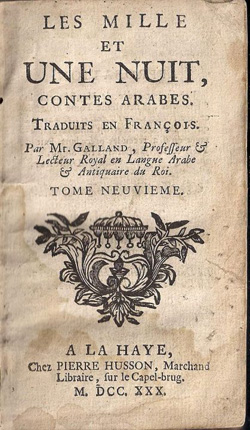
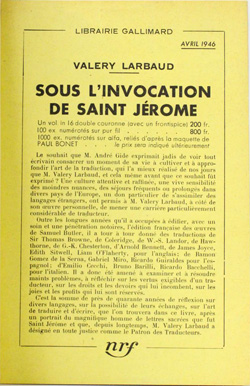 |
3.
Cohérence interne contre sans faute
|
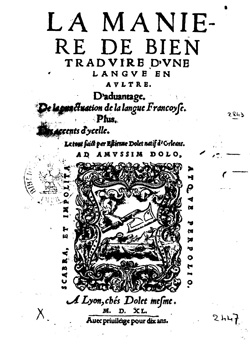 |
|
D’où l’on revient à la question de la
fidélité dans la traduction littéraire, qui
n’est plus dès lors définie par confrontation de
terme à terme, comme on peut le faire dans une
traduction technique, mais en considérant la
cohérence interne du texte dans son
ensemble. La traduction littéraire doit viser la
littérature, non la langue. C’est à partir du
moment où la traduction dépasse la transparence
anonyme que l’on a des traductions réussies, qui
sont belles plutôt que bonnes.
Une traduction sans faute peut être médiocre,
mais on parle « du » Poe de Baudelaire ou de
Mallarmé. Une traduction réussie a la qualité,
voire le génie de l’œuvre originale, comme celle
d’« Au bord de l’eau » par Jacque Dars. C’est
aussi une question d’identification à l’œuvre.
Contrairement à l’adage qui veut que les
traductions doivent être refaites tous les
cinquante ans, ces traductions-là ne se refont
pas. |
|
Au-delà, ou plutôt en-deçà de la théorie qui
pose l’idéal à atteindre et les écueils à
éviter, il reste à voir comment procéder dans la
pratique pour tenter de dépasser le mot à mot,
voire le phrase à phrase balbutiant. C’est là,
dans le cas spécifique de la traduction de
textes littéraires chinois, que vient nous aider
l’essai de Jean-François Billeter : « La
traduction vue de près »
.
Les cinq étapes selon Billeter
Ce qu’il pose d’abord, c’est que la traduction
ne vient pas après la compréhension du
texte, elle est un moyen de le comprendre, « de
progresser méthodiquement dans sa compréhension ».
C’est ce qu’il montre dans les exemples de
traductions de poèmes donnés dans les deux
autres essais du même recueil.
Généralisant à partir de son expérience des
textes chinois anciens, il propose un parcours
de traduction en cinq |
|
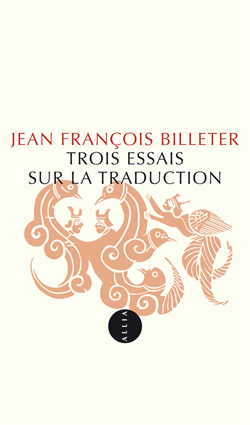 |
étapes
,
que l’on peut ramener à quatre en couplant les deux
dernières :
1.
Tenter de comprendre phrase par phrase
Phase préparatoire qui permet de cerner les difficultés de
compréhension, en laissant les options ouvertes.
Il s’agit ici de se poser des questions, de s’arrêter sur ce
qu’on ne comprend pas et de le noter.
2.
Imaginer ce qui est dit dans chaque phrase
Sans chercher tout de suite à « bien traduire ».
Comprendre est affaire d’imagination (Wittgenstein : nous
comprenons quand se fait en nous une synthèse d’éléments à
l’origine sans rapport entre eux).
3.
Dire ce que l’on voit, de la façon la plus juste et la plus
naturelle
Pour bien traduire, dit Billeter, il faut d’abord voir la
chose, pour l’exprimer à nouveau. L’imagination prend
alors un tour concret. Il ne s’agit pas de traduire, mais d’écrire
(au sens de Meschonnic). Avec un double corollaire :
- à ce stade intervient, en une sorte d’osmose avec l’auteur,
l’appréciation de l’usage qu’il a fait de sa langue – en
l’occurrence le chinois – et des contraintes qu’elle imposait.
Contraintes lexicales ou grammaticales auxquelles il a dû se
plier et dont on peut s’affranchir en français.
- devant exprimant la pensée de son auteur, le traducteur doit
se concentrer sur la forme, et les moyens d’expression à
sa disposition pour rendre le texte (et non le mot).
4.
Retravailler le texte en le reformulant au besoin
Et en s’assurant que la traduction produit le même effet que
l’original.
Il s’agit ici de revoir l’enchaînement des phrases, veiller au
rythme, alléger le style en éliminant les mots superflus, et
chercher le ton juste (en particulier dans les
dialogues). Il est aussi utile de veiller à l’euphonie, car il
reste toujours un « écho de la langue » même dans une lecture
silencieuse, et ce qui heurte l’oreille gêne la lecture. Cette
étape équivaut à l’interprétation en musique.
Finalement, comment juger d’une telle interprétation ? Par
l’effet qu’elle produit sur nous : par sa beauté, nous
dit Billeter. Beauté qu’il explique par une note de Simone
Weil sur la poésie : « Le poème est beau quand on ne souhaite
pas qu’il soit autre. »
Billeter conclut par une citation des « Notes on Translation »
d’Arthur Waley, qui reprend ce que dit Meschonnic sur
l’effacement du traducteur : répondant à un ami qui avait dit du
traducteur qu’il devait s’effacer derrière les textes, et que
ceux-ci parleraient alors d’eux-mêmes :
« I have always found that it was I, not the texts that had to
do the talking »
(J’ai toujours trouvé que c’est à moi de parler, et non au
texte)
BD
05/11/2017
(Ecrit pour servir
d'introduction à l'atelier de traduction du 9 novembre 2017 à
l'Université libre de Bruxelles)
|
|

